
Project Gutenberg's Les derniers paysans - Tome 1, by Émile Souvestre This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Les derniers paysans - Tome 1 Author: Émile Souvestre Release Date: June 28, 2015 [EBook #49312] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES DERNIERS PAYSANS - TOME 1 *** Produced by Laurent Vogel, Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
LES
DERNIERS PAYSANS

| TABLE DES CHAPITRES. |
Chez les mêmes Editeurs.
BIBLIOTHÈQUE CONTEMPORAINE
Format in-18 Anglais.
| 1re Série à 2 francs le volume. | ||
| vol. | ||
| Alex. Dumas. | Le Vicomte de Bragelonne. | 6 |
| — | Mém. d’un Médecin (Balsamo) | 5 |
| — | Les Quarante-Cinq | 3 |
| — | Le Comte de Monte-Cristo | 6 |
| — | Le Capitaine Paul | 1 |
| — | Le Chev. d’Harmental | 2 |
| — | Les Trois Mousquetaires | 2 |
| — | Vingt ans après | 3 |
| — | La Reine Margot | 2 |
| — | La Dame de Monsoreau | 3 |
| — | Jacques Ortis | 1 |
| — | Le Chev. de Maison-Rouge | 1 |
| — | Georges | 1 |
| — | Fernande | 1 |
| — | Pauline et Pascal Bruno | 1 |
| — | Souvenirs d’Antony | 1 |
| — | Sylvandire | 1 |
| — | Le Maître d’Armes | 1 |
| — | Une Fille du Régent | 1 |
| — | La Guerre des Femmes | 2 |
| — | Isabel de Bavière | 2 |
| — | Amaury | 1 |
| — | Cécile | 1 |
| — | Les Frères Corses | 1 |
| — | Impressions de Voyage: | |
| — | — Suisse | 3 |
| — | — Le Corricolo | 2 |
| — | — Midi de la France | 2 |
| — | Collier de la reine (s. presse) | 3 |
| — | Souv. Dramatiq. (s. presse) | 3 |
| — | Théâtre nouveau. ( » ) | 2 |
| — | Ascanio. ( » ) | 2 |
| E. de Girardin. | Études politiques (Nouvelle édition) | 1 |
| — | Questions administratives et financières | 1 |
| — | Le Pour et le Contre | 1 |
| — | Bon Sens, bonne Foi | 1 |
| — | Le Droit au travail au Luxembourg et à l’Assemblée Nationale, avec une Introduction | 2 |
| Paul Féval. | Le Fils du diable | 4 |
| — | Les Mystères de Londres | 3 |
| — | Les Amours de Paris | 2 |
| Michel Masson. | Les Contes de l’Atelier | 2 |
| Louis Reybaud. | Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des Républiques | 4 |
| Jules Sandeau. | Catherine | 1 |
| — | Nouvelles | 1 |
| — | Un Roman (sous presse) | 1 |
| Alphonse Karr. | Un Roman (sous presse) | 2 |
| — | Récits sur la Plage (sous presse) | 2 |
| Jules Janin. | Un Roman nouv. (s. presse) | 2 |
| Eugène Sue. | Les Sept Péchés capitaux: | |
| — | l’Orgueil | 2 |
| — | L’Envie, la Colère | 2 |
| — | La Luxure, la Paresse | 1 |
| — | La Gourmandise, l’Avarice | 1 |
| Em. Souvestre. | Un Philosophe sous les toits | 1 |
| — | Confessions d’un ouvrier | 1 |
| — | Derniers Paysans (s. presse) | 2 |
| Champfleury. | Contes | 1 |
| Fréd. Soulié. | Le Veau d’Or (sous presse) | 4 |
| F. Lamennais. | De la Société première | 1 |
| L.-P. d’Orléans, | Mon Journal. Evénements ex-roi des Franç. de 1815 | 2 |
| L. Vitet. | Les Etats d’Orléans.—Scènes historiques | 1 |
| Bar.-Laribière. | Histoire de l’Assemblée Nationale constituante | 2 |
| Eugène Scribe. | Un Roman (sous presse) | 1 |
| Emile Thomas. | Hist. des Atel. nationaux | 1 |
| Ernest Alby. | Histoire des prisonniers français en Afrique | 2 |
| Albert Aubert. | Illusions de jeunesse | 1 |
| 2e Série à 3 francs le volume. | ||
| Lamartine. | Trois mois au Pouvoir | 1 |
| George Sand. | La Petite Fadette | 1 |
| Ponsard. | Œuvres complètes | 1 |
| Oct. Feuillet. | Scènes et Proverb. (s. presse) | 1 |
| D’Haussonville. | Histoire de la politique extérieure du gouvernement français, 1830-1848 | 2 |
| Henry Murger. | Scènes de la Bohême | 1 |
| — | Scènes de la Vie de jeunesse | 1 |
| — | Le Pays latin (sous presse) | 1 |
| Cuvillier-Fleury. | Portraits politiques et révolutionnaires | 1 |
| Henri Blaze. | Ecrivains et Poëtes de l’Allemagne | 1 |
Paris.—Imp. de Mme Ve Dondey-Dupré, rue Saint-Louis, 46, au Marais.
PAR
ÉMILE SOUVESTRE
I
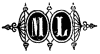
PARIS
MICHEL LÉVY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
RUE VIVIENNE, 2 bis.
1851
A MON AMI
ÉDOUARD CHARTON,
Conseiller d’Etat.
ANGERS. IMP. DE COSNIER ET LACHÈSE
La vie isolée des paysans et leur éducation toute traditionnelle, ont longtemps conservé dans nos campagnes les croyances, les usages et jusqu’aux costumes du passé; mais là comme partout, le vent du siècle commence à souffler; les institutions et les découvertes modernes ont rompu la barrière qui séparait les champs de la ville. Enlevé par la conscription à sa charrue, le jeune laboureur est devenu, pour un temps, marin ou soldat; la vapeur qui attache les ailes de la foudre aux merveilles de la civilisation, les a lancées jusqu’aux plus lointaines provinces; les retentissements de la presse arrivent de proche en proche au haut des montagnes ou au fond des vallées, et la vie politique, subitement éveillée, court comme une étincelle électrique du village à la ferme solitaire. Les paysans d’autrefois vont disparaître pour faire place à une population nouvelle!
L’auteur de ce livre, élevé parmi eux, et longtemps témoin de leurs mœurs exceptionnelles, a cru qu’il n’était point sans intérêt d’en recueillir les dernières expressions. Il a choisi dans ses souvenirs les scènes, les lieux, les personnages qui lui paraissaient refléter plus vivement les naïves fantaisies du passé. Les six Pastorales dans lesquelles il a groupé ces derniers aspects de la vie agreste, sont comme six paysages étudiés au soleil couchant de la poésie populaire; on y trouvera tout le monde fantastique créé par cette muse des champs et des forêts, qui, après tout, n’a fait que traduire, dans une mythologie enfantine, les éternelles aspirations de l’humanité elle-même. Que demandent, en effet, tous nos rêves?
A conquérir le bonheur terrestre;
A vivre par delà le cercueil;
A comprendre la merveilleuse création au milieu de laquelle Dieu nous a placés.
Or, le premier de ces instincts a créé les sorciers, les fées, les lutins, tous les êtres surnaturels qui ont renversé les barrières entre le fait et la pensée;
Le second a fait naître les croyances aux trésors cachés, aux talismans, aux dons merveilleux;
Le troisième a brisé les portes de la mort et rendu l’immortalité palpable, en donnant une apparence aux âmes disparues;
Le dernier a établi une solidarité mystérieuse entre nous et la nature; il a cherché une signification au cri de l’oiseau, au langage, au bruit du vent; une explication à tous les murmures du ciel, de la terre et des eaux.
L’imagination populaire a ainsi placé l’homme au centre d’un monde invisible qui le secourt ou le menace tour à tour. C’est dans ce monde, dont le paysan seul a conservé la conscience, que nous avons voulu le montrer. L’admirable peintre auquel on doit Jeanne, la Mare au Diable, la Petite Fadette, a révélé, dans des tableaux incomparables, le côté de poésie sentimentale des campagnes; nous essayons quelques esquisses qui en indiquent le côté fantastique. Au-dessous et bien loin des pages de Raphaël, il reste encore une modeste place pour la gravure au trait de l’artiste obscur qui, à défaut de plus haut mérite, a celui d’avoir vu et senti.
Le charme que prennent les faits et les idées dans les lointaines perspectives du passé est un phénomène connu de tout le monde, mais qui, pour quelques hommes, va jusqu’à la fascination. Attirés, non vers un résultat particulier de la société antique, mais vers l’antiquité elle-même, ils aiment ce qui a été, comme d’autres ce qui sera. Pour les uns et pour les autres, en effet, c’est la même aspiration passionnée vers l’idéal: regretter le passé ou appeler l’avenir, n’est-ce point toujours protester contre le présent?
Toutefois l’ardeur de ceux pour qui la rouille des âges est un aimant, a quelque chose de plus patient et de plus tenace. Semblables à ce vieux garde-chasse qui, en promenant les voyageurs à travers les débris du château de Woodstock, leur explique les salles détruites, leur vante les tapisseries absentes et se découvre au nom des illustres maîtres depuis longtemps réduits en poussière, ils se font les pieux gardiens des siècles écoulés et mettent toute leur joie à en retrouver les traces. Ne leur demandez ni ce qui se passe aujourd’hui ni ce qui se prépare pour demain; mais interrogez-les sur les croyances, les proverbes ou les contes des ancêtres: chaque pierre moussue dressée aux bords des chemins sera pour eux l’occasion d’une histoire, chaque vieux refrain chanté dans les pâtures réveillera un souvenir; archivistes de la tradition vivante, ils vous feront parcourir le recueil de cette poésie populaire dont ils ont su recomposer, feuille à feuille, un curieux exemplaire.
Traversant, il y a peu d’années, la Normandie, j’avais pu, grâce à une heureuse recommandation, lier connaissance avec un de ces hommes précieux. C’était un ancien soldat de l’Empire, établi comme percepteur dans une bourgade du Cotentin. Bien qu’il n’eût jamais dépassé le grade de maréchal-des-logis, la flatterie communale lui avait décerné le grade de capitaine, qu’il avait d’abord accepté par distraction, puis subi par bonhomie.
—Ils ont trouvé que cela faisait honneur à la paroisse, me disait-il naïvement.—En réalité, le titre imaginaire avait insensiblement absorbé le nom propre, et le percepteur avait fini par ne plus s’appeler que capitaine. Du reste, l’homme justifiait le grade, et la fiction semblait plus vraisemblable que la vérité.
La carrière militaire de notre percepteur avait commencé dans les rangs de ces héroïques soldats de la République, dont Napoléon sut faire, plus tard, de si hardis ouvriers en royauté. Il avait joué avec eux toutes les grandes scènes du drame de l’Empire; mais c’était un homme de la même famille que notre Corret de La Tour-d’Auvergne et que Paul-Louis Courier: là où les autres gagnaient un bâton de maréchal, il avait, lui, grande peine à obtenir une paire de souliers. Aussi vit-il tous ses anciens camarades devenir grands et célèbres, tandis qu’il continuait a manger son pain de munition à la fumée de leur gloire. Il avait été sergent avec Bernadotte et compagnon de chambrée de Murat; mais, ainsi qu’il le disait souvent, la guerre est un placement à fonds perdus que chacun grossit de ses efforts, de ses fatigues, de son sang, et dont les plus heureux touchent seuls le revenu.
Notre maréchal-des-logis se résigna sans peine à n’y rien prétendre; sa vie avait un autre but. Pour lui, la guerre n’était qu’un pèlerinage à travers les antiquités de l’Europe. Si l’on s’égorgeait un peu en chemin, cela pouvait passer pour un simple accident de voyage, comme l’ondée de pluie ou le coup de soleil; cela n’empêchait pas de voir, d’entendre, de comparer surtout; car le souvenir de son coin de Normandie poursuivait le capitaine. Il y rattachait chacune de ses découvertes par l’opposition ou par la ressemblance: son canton était pour lui ce qu’est le petit peuple juif dans l’Histoire universelle de Bossuet, le centre même du monde. Il avait conquis l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, au seul point de vue du Cotentin. Partout il avait fouillé les bibliothèques, visité les monuments historiques, recueilli les traditions. Il en était résulté une érudition très étendue ramenée à un cercle très restreint, et puisant son originalité dans cette opposition même. De plus, ballotté entre sa passion rétrospective et son bon sens contemporain, le capitaine s’efforçait de défendre les crédulités du passé sans pouvoir les partager; il appelait toute son érudition au secours de l’ignorance, et insurgeait perpétuellement la fantaisie contre sa propre raison. De là des contradictions d’autant plus plaisantes, que, comme tous les gens inconséquents, il prétendait au monopole de la logique: la logique, à ses yeux, était-ce qu’il voulait démontrer.
Nous avions parcouru ensemble une partie de la péninsule qui va de Carentan au cap La Hogue. Après avoir suivi quelque temps les méandres de la Dive et traversé ses riches herbages encadrés de haies vives, nous avions gagné Montebourg, nous dirigeant, au nord, vers Quinéville, où je voulais voir la ruine connue sous le nom de Grande-Cheminée. Lorsque nous atteignîmes la hauteur que couronne le village, mon guide me montra une petite butte de gazon d’où le regard s’étendait jusqu’à La Hogue et Falihou. C’était là que le roi Jacques II avait vu, en 1692, quarante-quatre navires français, commandés par Tourville, combattre un jour entier quatre-vingt-huit vaisseaux ennemis, et, vaincus enfin, non par le nombre, mais par l’inconstance du vent, couvrir la plage de leurs épaves enflammées. Le capitaine, animé par ce souvenir glorieux, commençait déjà l’histoire maritime des Normands, et me prouvait que l’Amérique avait été découverte, avant Christophe Colomb, par des matelots du Cotentin, embarqués sur un navire dieppois, lorsqu’un jeune paysan l’accosta en le saluant.
—Eh! c’est Etienne Ferret! s’écria-t-il, bonjour Ferret, que viens-tu faire à Quinéville?
—Pardon, excuse, répliqua le jeune gars, c’est pas que j’y vienne, mais j’y demeure.
—Au fait, je me souviens maintenant, reprit mon conducteur, le curé m’a parlé de toi; tu es garçon de charrue au Chêne-Vert, et il paraît que tu épouses la petite pastoure de la ferme.
—Oui, ils disent ça dans le pays, répliqua Ferret avec un demi-sourire.
—Je ne t’avais pas revu depuis notre rencontre à Caumont, fit observer le capitaine; pourquoi donc as-tu quitté ton ancien maître?
—C’est pas moi, dit Etienne, c’est bien plutôt lui qui m’a quitté.
—Il est mort?
—Pas tout-à-fait, mais autant vaut. C’était, comme on dit dans notre paroisse, un pauvre homme de la noblesse à Martin Firou: Va te coucher, tu souperas demain. Quand il avait pris la ferme des Motteux, il n’avait la bourse pleine que de bonne volonté: c’est pas assez pour graisser la terre et payer les gages. Aussi, un beau jour, les gens de justice sont arrivés avec du timbré, ils vous ont mis la main sur tout, et il a fallu passer le haisset. J’ai été dans la banqueroute pour trois écus.
—Tu supposeras que tu les as bus en maître cidre; mais que sont devenus les pauvres gens des Motteux?
—Le capitaine devine bien qu’ils n’avaient pas à choisir. Ils devaient beaucoup dans le pays, sans compter mes trois écus; aussi le ci-devant fermier et ses fils ont coupé dans le taillis des branches de fesse-larron en guise de monture, et ils sont tous partis pour Milsipipi.
Ce dernier mot me fit redresser la tête.
—Vous ne comprenez pas? dit le percepteur en riant; dans le patois du Bessin, partir pour Milsipipi, c’est aller chercher fortune au loin. Encore une réminiscence de nos expéditions maritimes. Ce sont les Normands qui, après avoir peuplé le Canada, ont établi les premières colonies à l’embouchure du père des eaux. La tradition orale a conservé le souvenir du fait en estropiant le mot. Il y aurait tout un travail à entreprendre sur les expressions usuelles; le langage du peuple contient une partie de ses archives historiques.
—Malheureusement nous ne savons plus y lire, répliquai-je; on a retenu le son, on a oublié l’origine.
—C’est à nous de la retrouver, en suivant à la piste toutes les traces que les siècles ont laissées dans la tradition populaire, dit le capitaine; mais les savants méprisent la tradition à cause des erreurs dont elle est enveloppée: c’est toujours la fable de la jeune guenon rejetant la noix verte qu’elle n’a point su éplucher:
Au lieu d’interroger les réminiscences confiées à la mémoire, qui, si elles ne rendent pas exactement les faits, en transmettent au moins le mouvement, on cherche l’histoire dans les procès-verbaux, comme on chercherait une prairie dans la botte de foin. On trouve la vie trop complexe, trop mouvante, et, pour plus de commodité, on étudie la mort. Tous les historiens du duché de Normandie, par exemple, ont voulu examiner les actes et les chartes qui faisaient connaître les circonstances de la conquête anglaise; aucun n’a cherché le caractère intime du conquérant dans ce que le peuple raconte du vieux Guillemot.
Le paysan, qui marchait à quelques pas devant nous, se retourna brusquement à ce mot.
—Voyez-vous comme ils reconnaissent le nom de leur gros duc? continua le percepteur en souriant; Guillemot est chez nous ce qu’est le roi René chez nos voisins d’Anjou: l’omnis homo de la chronique populaire.
Et il se mit à chantonner:
—Tu sais ce que c’est que cette chanson-là, hein, Ferret?
—C’est la complainte de la Croix pleureuse....
—Où l’on raconte la fureur de Guillemot contre la duchesse Mathilde, qui avait eu l’imprudence de lui demander l’établissement d’un impôt sur les bâtards.
—J’ai chanté ça bien des fois dans les friches quand je gardais le bétail, dit Ferret; mais que le capitaine m’excuse, j’ai mal compris tout à l’heure. Quand il a nommé le vieux Guillemot, j’ai cru qu’il parlait du sorcier du Petit-Haule.
—Parbleu! tu as raison, s’écria-t-il; nous devons être dans son voisinage.
—Sa maison est sur notre route.
—C’est un drôle que je connais de vieille date, continua le capitaine en se tournant vers moi. Il a autrefois habité près de Formigny, et je sais sur son compte certaines histoires... Mais ici on a une confiance aveugle dans sa science; on prétend qu’il réunit en lui tous les pouvoirs du grand carrefour: c’est le nom que l’on donne à la magie noire.
—Sans compter, dit Ferret, qu’il possède, soit disant, le cordeau merveilleux avec quoi on fait passer le blé d’un champ dans un autre champ, et le lait d’une vache à la vache voisine.
—N’a-t-il pas également le mauvais œil qui donne la fièvre? demandai-je.
—Et les bonnes paroles qui la guérissent, répliqua le paysan. L’an passé, il a si bien charmé un homme de Trevières qui sentait déjà le dernier froid dans ses cheveux, qu’il a renvoyé sa maladie à un buisson, et que le buisson en est mort.
Je ne pus m’empêcher de sourire.
—Oui, oui, cela paraît ridicule, dit le capitaine en hochant la tête, et cependant, chez tous les peuples et à toutes les époques, on a reconnu l’existence des sorciers. Les Grecs et les Romains y croyaient. Tibulle parle d’une magicienne qui, par ses chants, attirait les moissons d’un autre domaine: Cantus vicinis fruges traducit ab agris. L’Evangile de Nicodème nous apprend que Jésus-Christ se livrait, dans son enfance, à des opérations magiques en modelant avec de la terre de potier des oiseaux qu’il animait. Innocent VIII dit textuellement dans un de ses édits pontificaux: «Nous avons appris qu’un grand nombre de personnes des deux sexes ont l’audace d’entrer en commerce intime avec le diable, et, par leurs sorcelleries, frappent également les hommes, les bêtes, les moissons des champs, les raisins des vignobles, les fruits des arbres et les herbes des pâturages.» A Port-Royal, on avait les mêmes opinions. Marguerite Périer, nièce de Pascal, raconte, dans ses mémoires, qu’une sorcière jeta un sort sur son oncle lorsqu’il était enfant, et faillit le faire périr. Aujourd’hui tout cela nous paraît ridicule; mais nous avons ri également de la seconde vue des prophètes, récemment expliquée par le magnétisme, et des alchimistes qui faisaient de l’or, quand nos savants sont sur le point de faire du diamant. Les croyances des vieux âges finissent toujours par se justifier. Les prétendues erreurs du passé ne sont, le plus souvent, que les ignorances du présent; nos progrès témoignent seulement de nos oublis; quand nous croyons découvrir une Amérique, il se trouve toujours que nos ancêtres l’avaient peuplée mille ans auparavant.
Ainsi retombé dans sa thèse favorite, le percepteur continua à entasser les citations et les arguments pour me prouver que les anciens avaient tout connu, tout approfondi, et que rire de leur crédulité, c’était, presque toujours, jouer le rôle de cet aveugle qui raillait les clairvoyants de croire au soleil. Je connaissais déjà assez bien l’innocente manie du vieux soldat pour savoir qu’une adhésion complaisante l’arrêtait court: un peu de contradiction lui était nécessaire en guise d’éperon. Je me mis donc à le combattre, mais sans trop de chaleur, comme un homme qui veut bien qu’on le persuade, et je finis par proposer une visite au sorcier du Petit-Haule. Comme sa cabane était sur notre route, le capitaine accepta sur-le-champ et pria Ferret de nous conduire.
Ce dernier accueillit la demande avec une répugnance visible. Soit que les raisonnements de mon compagnon eussent confirmé ses terreurs superstitieuses, soit qu’il eût quelque motif particulier d’éviter Guillemot, il ne céda à notre insistance qu’après avoir épuisé tous les moyens de nous retenir.
Nous tournâmes à gauche par un chemin creux qui nous éloignait de la mer. Des touffes de houx, au feuillage sombre, bordaient les deux fossés. A chaque percée, nous apercevions les derniers rayons du soleil couchant qui semblaient barrer l’horizon comme une muraille rougeâtre; le reste du ciel était d’un gris d’acier, et l’on commençait à sentir l’âpreté de la bise. Le chemin, creusé en lit de torrent, semblait parfois sortir de ses berges pour traverser des plateaux découverts où l’on apercevait à peine quelques hameaux épars et de faibles traces de culture. Plus nous avancions, plus le paysage devenait aride et désert. Nous arrivâmes enfin à un carrefour au milieu duquel gisaient les débris d’une croix de pierre. Notre guide nous dit qu’elle portait dans le pays le nom de Croix des Garoux. C’était là que les malheureux condamnés à porter la haire, ou peau de loup, qui les oblige à courir le varou, venaient recevoir, chaque nuit, la correction d’une main invisible; car, en Normandie, les garoux ne sont point comme ailleurs, des sorciers qui se transfigurent pour porter chez leurs voisins la terreur ou le ravage, mais des damnés qui sont restés éveillés dans leur fosse, comme les vampires de la Valachie, et qui, après avoir dévoré le mouchoir arrosé de cire vierge qui couvre le visage des morts, sortent malgré eux de la tombe et reçoivent du démon la haire magique. Ferret nous apprit que le seul moyen de les arracher à ce terrible supplice était d’aller droit à eux lorsque le hasard les mettait sur votre chemin, et de les frapper au front de trois coups de couteau en mémoire de la Trinité.
Le capitaine ne manqua pas de me prouver, à cette occasion, que l’existence des hommes-loups avait été confirmée par le témoignage de tous les siècles. Après m’avoir cité le mythologique Lycaon, il me parla de Déménitus qui, au dire de Varron, fut changé en loup pour avoir mangé la chair d’un sacrifice, et de la famille Autacus, qui n’avait qu’à passer un certain fleuve pour subir la même transformation. Il nomma ensuite les juges, les théologiens, les inquisiteurs, qui, pendant cinq siècles, pendirent ou brûlèrent des lycanthropes, lesquels se déclarèrent eux-mêmes justement brûlés ou pendus. Cependant, comme je n’opposais rien à ces preuves, il finit par douter un peu. En ne cherchant pas à démontrer qu’il avait tort, je le désintéressais en quelque sorte d’avoir raison.
—Après tout, dit-il, je ne donne pas la chose comme positivement certaine. Il serait possible qu’il y eût seulement une leçon dans l’histoire de ces hommes coupables changés en bêtes féroces. Le garouage peut être le symbole des remords. Il représenterait, dans certains scélérats, l’incarnation des instincts, l’âme devenue visible. Les vieilles lois normandes disaient dans leurs imprécations contre les criminels: wargus habeatur (qu’il soit regardé comme un loup). Le peuple prend aisément l’image pour la réalité; du loup symbolique il aura fait un loup véritable.
—Ajoutez, repris-je, qu’il regarde les analogies comme des filiations. A une certaine époque, les campagnes, dépeuplées par les ravages des aventuriers, se couvrirent de bandes de loups, et les paysans, trouvant dans leurs nouveaux ennemis la férocité des anciens, pensèrent que ce devaient être ces aventuriers transformés.
Toutes ces fables prouvent l’activité intellectuelle du peuple. Entouré d’un monde de mystères, qu’il veut sonder à tout prix, il invente l’explication qu’il ignore, il ramène à lui la création entière. Là est l’origine de toutes les mythologies: on y trouverait également celle des sorciers. Le peuple a attribué à leur puissance secrète les effets dont il n’apercevait point les causes; il a trouvé du soulagement à se supposer un ennemi invisible; c’était du moins quelqu’un à accuser et haïr. Aussi les sorciers ne me semblent-ils point seulement les auxiliaires de nos aspirations vers l’impossible, ce sont encore plus les victimes expiatoires de notre orgueil. Sans eux, nous aurions l’air de ne pas comprendre; ils justifient l’inconnu.
—Il y a du vrai dans ce que vous dites, reprit le capitaine; bien que vous fassiez bon marché de la magie en elle-même. Une science constatée par le témoignage de tant de générations ne peut être jugée légèrement. Du reste, vous avez raison en regardant les sorciers comme les parias de nos campagnes. Pauvres, vieux et sans famille, ils effraient tout le monde, parce que personne ne les aime. Le peuple sent instinctivement que l’homme isolé est hors des voies humaines, qu’il faut qu’il soit un saint ou un damné; de là l’horreur pour ces ermites du diable, comme je les ai entendu appeler en Provence. Chacun leur fait tout le mal qu’il peut, leur souhaite tout celui qu’il n’ose leur faire; ils le savent bien et ne laissent échapper aucune occasion de se venger.
—Non, non, dit Ferret qui, un peu dérouté par notre discussion psychologique, venait pourtant d’en comprendre la conclusion; il ne fait pas bon les avoir contre soi, à preuve Ferou, qui, pour s’être permis de battre le chien de Guillemot, a vu sa plus belle génisse mangée et ses seigles grêlés.
—Il paraît que l’homme du Petit-Haule a reçu plusieurs dons, me fit observer le capitaine. En France, nos paysans, suivant qu’ils sont cultivateurs ou bergers, se gardent plus spécialement des meneurs de loups ou des conducteurs de nuées. Ils redoutent les premiers, parce qu’ils font la chasse aux troupeaux, aidés des bêtes fauves qui leur obéissent; les seconds, parce qu’ils commandent aux trombes d’emporter les moissons de leurs ennemis dans une région invisible, nommée Magonie, où ils ont leurs greniers d’abondance. Ces derniers sont ce que les capitulaires de Charlemagne appellent des tempestaires. Les Romains reconnaissaient leur puissance, comme le prouvent les vers de Tibulle:
Heureusement l’on a, pour les combattre, l’épine blanche, préservatif certain contre les malignes influences, depuis que ses branches ont servi de couronne au Christ.
—Vous oubliez les cloches, repris-je, les cloches qui sont les voix baptisées, comme disent les Vendéens. La paroisse de Notre-Dame-en-Beauce en avait une, appelée Marie, qui bravait les conjurations de tous les meneurs de nuées. Un jour, trois des plus puissants se réunirent pour ravager le canton. Ils appelèrent, des quatre aires du ciel, la foudre, la pluie, la grêle et les vents, et en formèrent un nuage de la grosseur d’une montagne, sur lequel ils montèrent, afin de le mieux conduire. En voyant arriver cette masse noire, brodée d’éclairs, les plus hardis se cachaient d’épouvante; mais ils la virent tout-à-coup s’arrêter, et ils entendirent les voix des sorciers qui lui criaient de marcher.—Je ne puis pas, maîtres! répondit la nuée.—Pourquoi cela?—Parce que Marie parle! La cloche venait, en effet, d’élever sa voix sonore, qui avait ôté toute leur force aux conjurations. Après de vains efforts pour franchir l’espace gardé par le son béni, il fallut que la nuée fît un détour jusqu’à ce qu’elle eût cessé d’entendre la cloche; mais alors elle était au-dessus d’une lande aride, et elle put crever sans nuire à personne.
—La Beauce est, en effet, le pays des tempestaires, dit le capitaine, et de ce que les hommes du Midi appellent des armaciés, c’est-à-dire sorciers à double vue; je me rappelle qu’autrefois on m’en montra un, entre Chartres et Alençon, qui répandait la terreur dans plus de dix paroisses: il pouvait quitter, selon sa fantaisie, son enveloppe charnelle, voyager par l’espace en condition d’âme invisible et nul n’échappait à ses maléfices. Il se rendait maître de la volonté d’une fille rien qu’en touchant un de ses rubans.
Ferret tressaillit à ces derniers mots, et demanda au capitaine avec embarras, s’il croyait vraiment que les sorciers pussent obtenir de leur maître un tel privilége.
—N’est-ce pas la tradition du Cotentin, comme celle de la Beauce? demanda le capitaine.
—Peut-être, dit Etienne, qui, fidèle à l’habitude normande, hasardait rarement une affirmative; mais il doit y avoir des préservatifs?
—Pardieu! tu les connais aussi bien que moi, répliqua le percepteur; les filles prudentes qui veulent échapper à l’influence du sorcier n’ont qu’à mettre leurs bas à l’envers.
—Mais quand ce n’est pas le dimanche, objecta Ferret, elles n’ont que leurs sabots.
—Alors il faut qu’elles jettent bien vite le ruban touché.
Le paysan secoua la tête.
—Une jeune fille tient à ses rubans, murmura-t-il. C’est une grande croix pour des chrétiens d’avoir des jeteurs de sort dans le pays. Avec un autre homme, on a des chances, on combat chair contre chair; mais, avec les sorciers, il n’y a rien à faire; s’ils n’entrent point par le haisset, ils entrent par le viquet.
—Reconnaissez-vous le vieux proverbe normand, me dit le percepteur. Le haisset et le viquet sont la petite barrière qui tient lieu de porte et le guichet qui sert de fenêtre; le dernier mot est resté dans le vocabulaire anglais, wicket. Les Normands ont porté leur langue, leur philosophie et leurs coutumes depuis la Tamise jusqu’au Saint-Laurent; on est sûr de les trouver, dans l’histoire, en tout endroit où il y a chance de conquêter et de gaigner. Henri IV disait, en parlant d’une terre stérile, qu’il fallait y semer des Gascons, parce qu’ils poussaient partout; on pourrait dire, avec autant de justice, des terres fécondes que, quoi qu’on y sème, il y poussera infailliblement des Normands.
Le soleil baissait rapidement, et des brumes chassées par le vent du soir commençaient à envahir l’horizon. On voyait les oiseaux de mer tourbillonner par troupes au-dessus du promontoire en poussant les cris brefs et perçants que nos pêcheurs ponentais appellent le chant de la pluie. Nous étions arrivés près d’une hauteur que la route contournait et au sommet de laquelle Ferret nous montra une maison isolée: c’était celle de Guillemot. La silhouette sombre de cette maison, dominant la colline dépouillée, se détachait vigoureusement sur un ciel pâle, et je commençais à en distinguer les détails, lorsque Etienne qui regardait depuis quelques instants, étendit une main au-dessus de ses yeux afin de mieux voir.
—Qu’y a-t-il? demanda le capitaine.
—Dieu me sauve! c’est elle! dit Ferret troublé, c’est Françoise!
—La pastoure du Chêne-Vert! où cela?
—A la porte de Guillemot; la voilà qui se lève... Je reconnaissais sa jupe noire et son tablier rouge.... elle court au haut du sentier... elle fait signe.... Ah! Jésus Dieu! voyez là-bas, là-bas, le sorcier!
Je tournai les yeux vers le point indiqué et je demeurai frappé d’un singulier spectacle. Au milieu des brumes qui rampaient sur les pentes, un rayon de soleil couchant formait une sorte de traînée brillante dans laquelle s’avançait l’homme du Petit-Haule. Enveloppé d’un de ces cabans fauves en usage parmi les marins de la côte, il marchait courbé en avant, les mains sous les aisselles. A mesure qu’il montait, la brume se repliait derrière lui et effaçait la voie lumineuse, comme s’il eût traîné à sa suite les pluvieuses nuées. Il atteignit bientôt la cîme du coteau où Françoise était accourue à sa rencontre. Tous deux restèrent alors isolés dans une sorte de nimbe, tandis que le reste de la hauteur était noyé sous le brouillard. La jeune pastoure parlait avec véhémence, joignant par instants les mains comme pour une prière, puis les portant à son front avec une expression de désespoir. Guillemot écoutait sans faire un mouvement. Deux ou trois fois il nous sembla cependant, à l’immobilité de la jeune fille, qu’il parlait à son tour; mais ces paroles étaient sans doute douloureuses, car nous la vîmes étendre les bras avec l’angoisse suppliante d’une condamnée, puis cacher sa tête dans son tablier. Le sorcier continua sa route vers la cabane, où il disparut. Ferret, qui était resté jusqu’alors à la même place, les regards fixes, les lèvres tremblantes et tout le corps penché en avant comme prêt à s’élancer, jeta une espèce de cri et prit sa course vers le Petit-Haule.
—Ne le perdons point de vue, me dit vivement le capitaine, il y a ici quelque chose qui va mal.
Nous pressâmes le pas pour le rejoindre, mais il avait déjà tourné le sentier. Après avoir franchi rapidement la montée, nous courûmes à la maison de Guillemot. Celui-ci était tranquillement assis près du foyer éteint, en face de Françoise, dont le visage était marbré par les larmes, la poitrine haletante et les yeux baissés. Ferret se tenait entre eux, promenant de l’un à l’autre ses regards incertains et ardents.
—On ne pleure pas si fort pour une chèvre perdue, s’écriait Etienne au moment où nous parûmes sur le seuil, et ce n’est pas ici qu’on viendra la chercher.
—Le jeune gars sait alors où elle est! dit sèchement Guillemot.
—Je sais que la chèvre n’a pu venir du Chêne-Vert au Petit-Haule.
—Qu’importe, si c’est au Petit-Haule qu’on donne le moyen de la retrouver?
—Ainsi c’est pour avoir la parole qui guide que Françoise est venue? demanda Ferret en regardant fixement la jeune fille.
Celle-ci, dont notre arrivée avait encore augmenté la confusion, ne répondit point sur-le-champ; mais, faisant enfin un effort:
—Je voulais parler pour cela... et pour autre chose... balbutia-t-elle.
—Pour quelle chose? répéta Etienne, dont le regard semblait rivé sur la jeune fille.
Elle essaya de répondre, mais sa voix resta étouffée dans les larmes qu’elle retenait.
Le capitaine s’entremit.
—Prétendrais-tu par hasard forcer une jeune fille à te répéter tout ce qu’elle peut demander aux liseurs de sort! dit-il gaiement à Ferret; ne sais-tu pas que les sorciers sont comme les prêtres? Pour eux, elles ouvrent leur cœur à deux vantaux, tandis que les amoureux ont tout au plus droit d’y regarder par le trou de la serrure.
—Quand on n’a rien à craindre, on n’a rien à cacher, dit le jeune homme avec une persistance mêlée de dureté; une honnête fille ne doit point avoir de secrets.
—Ce n’est pas alors comme les honnêtes gars! fit observer Guillemot ironiquement.
—Que Françoise répète ce qu’elle disait tout-à-l’heure à l’homme du Petit-Haule, reprit Ferret, qui feignit de ne pas entendre.
—Répète donc alors toi-même ce que tu disais, il y a un an, à la fille du clos Gallois, répliqua le sorcier avec intention.
Ferret tressaillit et se retourna vers Guillemot; mais ne pouvant supporter son regard, il baissa la tête en rougissant. Le souvenir qu’on venait de lui rappeler avait, sans doute, pour lui une signification particulière, car il demeura un instant comme partagé entre l’embarras et la surprise; une expression de colère, puis d’inquiétude, traversa ses traits; on eût dit que la peur de cette science mystérieuse, dont la révélation du sorcier semblait une confirmation nouvelle, contrebalançait chez lui la rancune: celle-ci parut pourtant l’emporter.
—Quand je parle à Françoise, dit-il, ce n’est point à l’homme du Petit-Haule de répondre.
—Chacun a droit de prendre la parole sous le toit qui lui appartient, répliqua froidement Guillemot.
—Alors nous causerons ailleurs, reprit vivement Etienne; venez, Françoise, le toit du ciel n’appartient à personne.
Il avait fait un mouvement vers la porte; la jeune fille parut près de le suivre, mais un coup d’œil du sorcier la retint. Evidemment sa volonté luttait entre deux influences contraires: elle demeura en proie à une indécision qui se traduisit d’abord par une alternative de rougeur et de pâleur subites, puis par un tremblement nerveux qui l’obligea de s’asseoir sur la pierre du foyer; mais elle n’y resta qu’un instant. Sa main alla presque aussitôt chercher la muraille; elle se redressa avec effort, jeta au sorcier un regard de douleur suprême, courut vers une petite porte de derrière et se précipita hors de la cabane. Ferret, qui était d’abord resté immobile d’étonnement, s’élança à sa poursuite.
Tout cela s’était passé si rapidement, que nous n’avions eu le temps de rien dire, ni de rien prévenir. Je courus à la porte, Etienne et la jeune fille avaient disparu. J’allais franchir le seuil pour me mettre à leur poursuite, quand le capitaine m’arrêta.
—Il y a des ravines de ce côté-là, dit-il, et, dans l’obscurité, vous risqueriez de vous y rompre le cou.
—Mais que signifient cette douleur et cette fuite? m’écriai-je.
Il secoua la tête.
—J’ai peur de m’en douter, reprit-il; avez-vous remarqué cette petite quand elle est tombée là assise? Il m’a semblé que sa taille était autrefois plus svelte et plus fine...... Au reste, Guillemot, qui paraît être dans sa confidence, pourrait nous éclairer à ce sujet.
—Le capitaine a dit lui-même que les sorciers étaient comme les prêtres, répliqua l’homme du Petit-Haule, et les prêtres n’ont pas le droit de répéter les péchés qu’on leur a confiés.
—Mais ils ont le droit d’avouer les leurs, fit observer mon compagnon en le regardant fixement; savez-vous, maître mire, que moi aussi j’ai étudié le Dragon rouge, et que je peux lire, au besoin, aussi bien que vous dans le passé!
—Que le capitaine dise ce qu’il a vu, répondit Guillemot d’un air soupçonneux.
—J’y ai vu l’histoire d’un sorcier de Vauduit, reprit le percepteur, lequel, au dire des bonnes gens, jetait un sort sur toutes les pastoures du canton de Formigny, et les avait à sa discrétion; mais d’autres, moins crédules, l’accusaient de les endormir avec des drogues pour les surprendre ensuite sans défense. On commença même une instruction contre lui, et il trouva prudent de quitter le pays. Comme Françoise garde seule le troupeau sur les friches, il a pu lui arriver ici ce qui est arrivé là-bas à d’autres: elle n’a d’abord rien dit par honte; maintenant que tout va être connu, elle vient crier miséricorde à celui qui a fait le mal. Qu’en pense le sorcier du Petit-Haule? N’ai-je pas bien deviné, et n’est-ce point ainsi qu’il faut expliquer la chèvre perdue?
J’observais Guillemot pendant que le percepteur parlait; son œil avait exprimé une attention croissante, mais sans qu’aucun tressaillement trahît son trouble. A l’explication de la visite de Françoise au Petit-Haule, sa main droite, qui secouait les cendres de sa pipe éteinte, s’était seulement arrêtée; du reste, il ne changea point de posture, ne releva point les yeux et se contenta de répondre brièvement:
—Le capitaine est donc plus savant que tous les maîtres du grand carrefour!
—C’est que les maîtres du grand carrefour ne regardent pas assez du côté de Valognes, où sont les juges et le procureur du roi, reprit mon compagnon; quand le diable se brouille avec la justice, il est rare qu’il ait l’avantage. Maître Guillemot sait mieux que personne que ceux qui sont obligés de passer entre les articles du code trouvent la route difficile.
—C’est alors comme ceux de Sainte-Mère-Eglise, dit le sorcier d’un ton brusque, et le capitaine fera bien de ne pas s’attarder afin d’éviter les ornières.
Il s’était levé à ces mots, et fit un pas vers la porte comme pour nous reconduire. Bien que le congé fût donné d’une manière un peu brutale, l’avis était prudent; rien ne nous retenait d’ailleurs au Petit-Haule; nous dîmes rapidement adieu à notre singulier hôte; et, sortant à notre tour par la porte de derrière, nous suivîmes un sentier étroit qui nous conduisit en ligne droite au bas de la colline.
L’étrange scène dont je venais d’être témoin avait excité au plus haut point ma curiosité. Je me faisais donner de nouvelles explications par mon conducteur, lorsqu’un homme se dressa tout-à-coup dans l’ombre de la ravine que nous suivions; je reconnus Etienne Ferret. Il nous aperçut à son tour, et vint nous rejoindre.
—Eh bien! l’as-tu retrouvée? demanda le capitaine.
—Non, dit le paysan; j’ai couru jusqu’au bas sans rien voir. Cependant elle n’a pu fuir si vite! Le coteau n’a pas une brousse pour la cacher. Faut qu’elle soit partie sur un coup de vent ou rentrée sous terre. Mais l’homme du Petit-Haule en rendra compte.
Je remarquais qu’en parlant ainsi, Ferret avait la voix haletante et les yeux hagards; il était très pâle. Le capitaine et moi nous nous efforçâmes de le calmer; mais il y avait dans son exaltation un mélange de soupçon, d’épouvante et de colère, qui lui donnait une expression si bizarre, que nous nous laissâmes aller, malgré nous, à l’observer au lieu de la combattre. Etienne avait complétement oublié cette réserve qui fait du paysan normand une sorte de problème perpétuel à résoudre. Il marchait entre nous en racontant avec une volubilité passionnée pourquoi il s’était attaché à Françoise en la voyant à la ferme maltraitée par tout le monde, quelles propositions de mariage il lui avait faites, et avec queles pleurs de joie elle les avait reçues. Il nous détaillait ses projets d’établissement dans la métairie qui lui avait été promise vers Bricbec, et où il devait entrer au retour des nouvelles feuilles; puis, revenant à la jeune pastoure, il nous disait comment elle avait commencé à changer il y avait trois mois, comment elle était devenue toujours plus triste sans qu’il pût en deviner la cause, jusqu’à ce qu’il l’eût trouvée plusieurs fois sur la route du Petit-Haule, où l’attirait la maligne puissance de Guillemot. Enfin, s’exaltant encore plus à cette dernière pensée, il se mit à murmurer des menaces de vengeance qui s’éteignirent tout à coup dans les larmes.
Je fus sincèrement touché de cette douleur naïve, et je m’efforçai de consoler le jeune paysan; mais le capitaine, qui avait pour principe que les consolateurs sont comme les médecins qui, au lieu de guérir la maladie, la constatent, m’interrompit pour nous faire remarquer que la nuit était venue, et qu’il importait de presser le pas. Il adressa en même temps plusieurs questions à Ferret sur la direction qu’il fallait prendre, afin de couper au plus court, espérant ainsi le distraire de sa préoccupation; mais tel était le trouble de ce dernier, qu’il ne put donner aucune indication satisfaisante.
Cependant les dernières lueurs du soir avaient complétement disparu; l’absence des étoiles qui ne se montraient pas encore, laissaient le ciel dans une profonde obscurité. Nous apercevions à peine, de loin en loin, quelques touffes d’arbres dessinant leurs masses plus sombres dans la nuit, ou quelques flaques d’eau, formées par le dernier orage, qui semaient la campagne de taches plus pâles. La route dominait des terrains à demi-noyés, ou nous entendions le vent frissonner dans les glaïeuls. Etienne était retombé dans un silence qu’interrompaient, de loin en loin, des soupirs ou quelques paroles entrecoupées. Nous côtoyions depuis un instant un de ces marécages connus en Normandie sous le nom de Rosières, quand une petite forme blanchâtre et mouvante se montra tout à coup à notre droite, et parut traverser vivement la route.
—Avez-vous vu? s’écria Ferret, en s’arrêtant tout court; c’est une létiche.
Je savais que ce nom était donné, par les paysans du Calvados et de la Manche, à l’hermine de France que ses rares apparitions ont transformée en animal merveilleux, et dans laquelle l’imagination populaire a voulu voir une gracieuse métamorphose des enfants morts sans baptême; mais, avant que j’eusse pu répondre, le capitaine nous montra une vingtaine de petites formes pareilles qui, après s’être élevées sur le marais, grandirent subitement en prenant l’apparence d’une flamme bleuâtre et se mirent à danser sur la cîme des roseaux.
—Tu vois que tes létiches sont des follets, dit-il à Etienne, nous sommes ici dans leur royaume, et si les follets sont, comme on le prétend, des prêtres qui ont violé le sixième commandement, il faut reconnaître que le clergé du pays compte peu de Joseph. Les anciens voyaient dans un follet isolé l’ombre d’Hélène, toujours de mauvais présage, et dans deux follets les ombres de Castor et de Pollux, symbole de prospérité; mais je voudrais savoir ce qu’ils auraient vu dans ce quadrille d’ardens qui semblent nous inviter à leur bal.
Le marais qui s’étendait à nos pieds était encore enveloppé d’ombre, mais les premières étoiles qui commençaient à s’épanouir dans le ciel versaient sur la route une pâle clarté, et l’on pouvait lire sur les traits d’Etienne, qui s’était arrêté comme nous, l’émotion âpre et enfiévrée que lui causait ce singulier spectacle. Nous regardions depuis quelques instants, lorsqu’une flamme, plus brillante et plus élevée, jaillit au milieu des joncs. Ferret fit involontairement un mouvement en arrière.
—Pardieu! s’écria le capitaine, voici la reine de la fête; ce doit être au moins la Fourolle.
—N’est-ce point le nom des sorcières-follets? demandai-je.
—Oui, balbutia Ferret; il y en a qui se donnent au démon pour avoir une place parmi les ardens, d’autres se damnent avec les prêtres ou les jeteurs de sort, et alors, pendant sept ans, leur âme est condamnée à courir ainsi toutes les nuits! Il y a déjà dans le pays la fourolle Renée, la fourolle Catherine... Oh! voyez, voyez, comme celle-ci marche, comme elle a l’air de nous appeler.
En parlant ainsi, Etienne fasciné avait descendu la berge et suivait la fourolle le long des roseaux; tout à coup il s’arrêta, nous le vîmes se baisser et disparaître; nous allions courir à lui quand il se releva avec un cri: il tenait à la main le tablier rouge de Françoise!
Nous cherchâmes en vain la jeune pastoure aux bords du marécage, sur la route et dans une saulaie qui s’étendait un peu plus loin, tout était désert. Le paysan inquiet nous quitta pour retourner à la ferme. Comme rien ne me retenait à Sainte-Mère-Eglise, je repartis le lendemain sans avoir connu le résultat de sa recherche; mais le hasard m’ayant fait rencontrer, deux ans plus tard, le capitaine, j’appris de lui que Françoise avait été retrouvée noyée sous les glaïeuls de l’étang.
Quant à Guillemot, il avait quitté le Cotentin et gagné les bords de la Sarthe, où il vit peut-être encore, craint comme tous ses pareils, de crédules paysans, qui le haïssent et le consultent. Quiconque a parcouru nos campagnes connaît, en effet, l’autorité qu’exercent partout ces vagabonds solitaires, auxquels la superstition suppose une mission surnaturelle. Quelle qu’ait été, dans cette première moitié du siècle, l’énergie de la réaction contre les traditions du passé, la croyance des sorciers s’est à peine affaiblie. Les rois et les prêtres s’en vont, mais les sorciers survivent. C’est que la foi en ceux qui peuvent nous affranchir du possible est encore moins le témoignage de notre ignorance que de nos rêves. Depuis l’alchimiste du moyen âge, qui promettait la pierre philosophale, jusqu’au spéculateur Law, retrouvant l’Eden aux bords du Mississipi, c’est toujours la même facilité à supposer ce qui flatte, et à prendre ses désirs pour des preuves. Aujourd’hui même, au foyer du scepticisme, n’avons-nous pas encore nos sorciers qui, plus puissants que les autres, ne promettent point le bonheur et la richesse à quelques hommes, mais la réforme de toutes les misères humaines et la félicité éternelle du genre humain?
Notre diligence venait de s’arrêter devant la maison du relais, et le postillon frappait avec le manche de son fouet à la porte de l’écurie, où tout semblait dormir.
—Eh bien! c’est comme ça que le Normand nous attend? criait-il; hé! grand saint lâche, comptes-tu nous laisser geler ici?
La demande est d’autant plus permise, qu’à notre départ de Paris le thermomètre marquait sept degrés au-dessous de zéro, et qu’il avait dû baisser encore depuis. La terre était couverte de neige; un vent mêlé de verglas fouettait la voiture, où le froid se faisait sentir d’autant plus cruellement que nous n’étions que deux voyageurs. Arraché à ma somnolence par les cris du postillon, j’abaissai avec précaution une des glaces rendue opaque par les cristallisations de la neige, et je hasardai ma tête hors de la portière.
—Où sommes-nous, postillon? demandai-je.
—A Troissereux, Monsieur, répondit-il.
—Combien de lieues encore jusqu’à Boulogne?
Une espèce de grognement, qui partit du fond de la diligence, m’empêcha d’entendre la réponse. C’était mon compagnon de route, que l’air piquant du dehors venait de réveiller en sursaut.
—Eh bien! s’écria-t-il tout à coup avec un accent provençal des mieux timbrés, qui donc ouvre là? Dieu me damne! Monsieur, avez-vous l’intention de vous chauffer au clair de lune.
Je relevai la vitre en m’excusant; le Provençal frissonna de tout son corps.
—Quel temps! reprit-il, autant vaudrait une campagne de Russie! et penser que dans mon pays ils se promènent maintenant en veste de nankin avec une rose à la boutonnière! Vous croyez avoir ici un soleil, vous autres, ce n’est pas même une lanterne. Pour connaître la vie, il faut habiter le Midi; il faut voir ses vignes, sa chasse aux ortolans, ses fabriques de savon, ses femmes. Ah! quelle contrée des dieux, Monsieur! Aussi nous avons à Marseille un antiquaire qui a prouvé que le pommier du paradis terrestre devait être planté entre la Camargue et Tarascon.
Je fis observer que l’on pouvait s’étonner, dans ce cas, qu’il n’y eût laissé aucune repousse.
—Eh! que voulez-vous? dit plaisamment mon compagnon, Adam n’aura point su qu’il fallait garder les pépins.
Je ne pus m’empêcher de sourire. La prétention de l’antiquaire marseillais n’avait rien, du reste, qui dût surprendre. Un ami de Latour-d’Auvergne, Le Brigand, n’avait-il pas réclamé le même honneur pour sa province, en concluant, des noms mêmes de nos premiers parents, que dans le paradis terrestre on parlait bas-breton[1]! Plaisantes imaginations que nous pouvons railler, mais qui semblent l’expression naïve de nos plus intimes instincts. Qui de nous, en effet, ne trouve aux lieux où il est né un charme mystérieux qui les distingue de tous les autres? En y respirant ces restes de parfums qui ne s’exhalent point ailleurs, comment ne pas croire que là était autrefois le séjour particulier de la paix, de l’innocence et de la joie? Chacun, hélas! a derrière lui un paradis terrestre d’où il a été chassé, comme notre premier père, par ce triste archange auquel les hommes ont donné le nom d’expérience.
Ces réflexions, qui traversaient lentement mon cerveau engourdi, m’avaient fait oublier mon compagnon de route, qui continuait son dithyrambe provençal. Il y mettait naturellement ce beau désordre que Boileau signale comme un effet de l’art, car l’improvisation méridionale a de continuels changements de niveau; ce n’est pas un fleuve, ce sont des cascades. Ajoutez que les idées semblent avoir de l’accent comme la voix: elles vous rappellent toujours l’histoire du perruquier de Sterne, qui, pour affirmer qu’une boucle de cheveux ne se défriserait point, s’écriait qu’on pouvait la tremper dans le grand Océan; sous cette enflure bruyante, il y a quelquefois l’original et le grandiose, presque toujours la couleur et le mouvement.
J’appris bientôt (sans avoir eu l’embarras de faire une seule question) que mon compagnon de voyage était un de ces missionnaires du commerce qui ont réalisé le symbole de Mercure volant, et courent, une trousse d’échantillons à la main, à la conquête du monde. Pour le moment, le Provençal se bornait à la conquête de la France septentrionale, où il s’occupait, selon son expression, d’écouler des vins et des huiles. Je sus, par sa conversation, qu’il avait parcouru, pendant dix ans, les moindres villages de la Provence, du Languedoc, du Dauphiné et des pays basques. Mon voyageur était un de ces esprits ouverts et actifs, jamais à court d’expédients, et qui, sachant le fond de la vie comme Figaro savait le fond de la langue anglaise, se tirent toujours d’embarras à force de bonne volonté. Ses incessantes pérégrinations l’avaient parfois rapproché d’hommes de savoir ou d’expérience, et il en avait retenu quelque chose; on sentait par instant que le morceau d’argile avait habité avec des roses.
Après m’avoir parlé de son commerce, des troubadours et de la Cannebière, il fit un de ces soubresauts, qu’il prenait pour des transitions, et se mit à me raconter ce qui lui était arrivé la veille à Beaumont. Il y avait rencontré une douzaine de ces comédiens ambulants, qui exploitent nos bourgades, sans cesse arrêtés par la faim et chassés par les dettes: derniers bohémiens de la civilisation, qui continuent au XIXe siècle le Roman comique de Scarron, traitant la vie comme Scapin traitait son maître, avec force lazzis et coups de bâton. La troupe foraine avait annoncé Robert-le-Diable. Le public était réuni, les cinq musiciens amateurs attendaient à leurs pupîtres, et la duègne, préposée au bureau de location, venait de rejoindre ses camarades pour se transformer en nonne de Sainte-Rosalie, lorsque deux huissiers étaient arrivés d’Allonnes avec un jugement de saisie et de prise de corps. Le directeur, subitement averti, avait quitté le trou du souffleur en s’écriant, comme un héros trop célèbre: Sauvons la caisse! Il avait vivement attelé le fourgon, et s’était enfui avec toute la troupe en costume moyen âge, oubliant derrière lui le mémoire de l’aubergiste, mais emportant la recette. Ce départ précipité avait empêché mon compagnon de se lier plus intimement avec la jeune Dugazon, qu’il avait reconnue pour une de ses compatriotes. Le récit du voyageur, émaillé de loin en loin de quelques-unes de ces exagérations provençales qui sont à la gasconnade ce que le poème épique est au fabliau, m’avait d’abord amusé; mais insensiblement la fatigue et le froid reprirent le dessus, et je cessais d’écouter. Bientôt le méridional, vaincu lui-même, s’enveloppa la tête dans son manteau, cacha ses pieds sous les coussins de la banquette, et s’assoupit en grelottant.
L’heure ordinaire du repos était également venue pour moi, et les habitudes sont des créanciers qu’on ne peut ajourner impunément. Endormi par la fatigue et réveillé par le froid, je restais flottant entre deux influences contraires. La diligence avançait lentement avec des intermittences de haltes et d’efforts qui exaspéraient ma gêne jusqu’à la souffrance. J’apercevais vaguement, à travers le vitrage glacé, des buissons chargés de neige, bordant la route comme des fantômes accroupis, des arbres qui dressaient à chaque carrefour leurs rameaux noirs, semblables à des bras de gibets, de grandes friches auxquelles la neige, entrecoupée de bruyères encore vertes, donnait l’aspect d’un cimetière à l’heure où les morts viennent étendre leurs linceuls sur les tombes. Le tintement des clochettes de l’attelage, le bourdonnement de la voiture vide et ébranlée par les cahots, le grincement des essieux fatigués, formaient je ne sais quelle harmonie pénible et monotone qui ajoutait à l’effet de ces lugubres images. Tout à coup la voix du postillon s’éleva dans la nuit. Le chant de cet homme, que je ne voyais pas et qui semblait venir d’en haut, complétait, pour ainsi dire, mon hallucination. Il psalmodiait d’un accent plaintif et prolongé une de nos traditions villageoises, espèces de sagas inédites dont chaque jour emporte un lambeau avec les vieilles mœurs et les vieilles crédulités. C’était l’histoire d’une fille-fée condamnée à subir, pendant certaines heures, une métamorphose qui la laissait sans défense et sans pouvoir. La fable et l’air avaient bercé ma première enfance; tous deux m’arrivaient à travers mon demi-sommeil sans l’interrompre: c’était comme un lointain écho du passé, et ma mémoire achevait d’elle-même les mots et les modulations commencés.
Cette étrange poésie, en me reportant à mes souvenirs d’enfance, m’en rendait peu à peu toutes les sensations. A mesure que le malaise et le sommeil obscurcissaient mes perceptions, le monde fantastique au milieu duquel mes premières années s’étaient écoulées, et que l’expérience avait plus tard effacé, reparaissait comme des milliers d’étoiles qui émergent dans l’espace à mesure que la nuit s’épaissit.
Chaque fois que je rouvrais les yeux, je rencontrais quelque pont jeté sur un ruisseau, et dont la silhouette me rappelait quelque conte populaire. Il y a, en effet, dans ces routes lancées sur les eaux, je ne sais quoi de hardi qui saisit ceux qui ignorent; c’est comme une victoire sur la création. En reliant l’un à l’autre des bords opposés, l’homme a l’air de défier le vide et l’espace, ces éternels ennemis de sa puissance bornée; il accomplit une première conquête qui semble en faire espérer une autre plus importante, et promettre ce grand pont dont, au dire de la tradition, l’arc-en-ciel n’est que l’ombre! car les cieux et la terre sont aussi deux rives entre lesquelles coule le fleuve de nos misères, et que tous les efforts de notre imagination tendent à réunir. Puis, quels lieux plus favorables aux vertiges que ces arches dressées au fond des vallées, parmi les saules que la lune revêt chaque nuit de suaires, et auxquels la brise donne le mouvement! Comment passer sans émotion sur ces chemins suspendus et sonores sous lesquels glapissent les remous, tandis que les algues enroulent aux éperons de pierre leurs replis, semblables à des dragons aquatiques, et que l’on voit briller, au loin, les larges fleurs du nénuphar, qui s’ouvrent sur les eaux comme des yeux de fantôme?
La route devenait de plus en plus difficile: bien que ferré à glace, notre attelage glissait sur le verglas, et le voile blanc qui enveloppait tout ne permettait point de distinguer la route. Deux ou trois fois déjà nos roues avaient rencontré les dépôts de cailloux amoncelés sur les accotements du chemin. La neige qui commençait à tomber, en aveuglant nos chevaux, rendit notre marche encore plus incertaine. Le postillon s’arrêta plusieurs fois, cherchant à reconnaître, dans la nuit, le pont jeté sur le Thérain; mais la neige, toujours plus épaisse, ne laissait voir ni les poteaux par lesquels il était annoncé, ni les arbres qui dessinaient le cours de la petite rivière. Les eaux, enchaînées par la glace, ne pouvaient non plus nous guider par leur rumeur. Nous avancions lentement et avec une sorte d’incertitude craintive. Enfin, notre conducteur aperçut à travers la nuée de neige, la double balustrade du pont. Il cessa de retenir les rênes, fouetta ses chevaux avec un sifflement d’encouragement, et la lourde diligence s’élança plus rapide; mais, presqu’au même instant un choc terrible nous enleva des banquettes; le postillon poussa un cri, et la voiture, fléchissant à gauche, versa sur le parapet. Une des grandes roues venait de se briser contre la seconde borne.
Les premiers moments furent employés, comme d’habitude, en malédictions et en reproches: les voyageurs criaient après le conducteur, le conducteur jurait contre le postillon, et le postillon battait ses chevaux; mais, la première colère passée, chacun prit son parti. On nous retira de notre prison roulante, désormais condamnée à l’immobilité. Examen fait, il se trouva que la roue était assez gravement endommagée pour exiger la présence d’un charron. Nous étions à environ une lieue de Saint-Omer-en-Chaussée et de Troissereux, nous ne pouvions attendre sur la route que l’ouvrier fût venu, et on décida que le conducteur irait chercher le charron sur l’un des chevaux, tandis que le postillon gagnerait l’abri le plus voisin, avec les voyageurs et le reste de l’attelage. Nous vîmes en effet le premier enfourcher le porteur et disparaître au galop dans la nuit, tandis que le second tournait à droite, précédé des trois chevaux qui lui restaient, et nous faisait prendre un chemin de traverse au milieu des friches.
Mon compagnon et moi, nous le suivions en frissonnant sous un vent glacé. Tout avait autour de nous un aspect funèbre. Nous marchions sans entendre le bruit de nos pas, enveloppés dans un linceul de neige qui se déroulait silencieusement à nos pieds. Par instants, nous traversions des taillis dont les repousses, blanchies par le gîvre, se dressaient comme de gigantesques ossements et s’entrechoquaient avec un cliquetis lugubre. Nous arrivâmes à une clairière où le gazon, dépouillé de neige, formait une sorte de cercle dont le vert jaune se dessinait sur la blancheur des frimas. Notre guide nous montra ce cercle avec un sourire qui tenait le milieu entre la bravade et la peur.
—C’est le rond des fades, nous dit-il en évitant de le traverser; ceux des environs assurent qu’elles viennent danser, à la nouvelle lune, avec les farfadets et le Goubelino. Il y en a qui les ont vus de loin; mais il ne faut pas les déranger, vu que ce sont des mauvaises qui vous tordent un homme comme une hart de fagot. On dit aussi qu’elles enlèvent des enfants à la manière de celles de mon pays, où nous avons la bête Havette, qui se cache au creux des fontaines, et la mère Nique, armée d’un bâton pour corriger les marmots.
—Sans parler des fées qui habitent les environs de Dieppe, repris-je.
—Au haut de la grande côte, près du village de Puys, interrompit le postillon. C’est là que se tient la foire de la cité de Limes, où les dames blanches mettent en vente des herbes magiques, des rayons de soleil montés en bague et des lueurs de lune roulées comme de la toile de Laval. Elles vous invitent à acheter avec autant de mignonneries que les dentellières de Caen, et, si vous approchez, elles vous lancent dans la mer. J’ai eu un cousin qu’on a trouvé mort ainsi au bas de la falaise.
Je fis remarquer à mon compagnon de voyage comment les mythologies norses, païennes et celtiques se trouvaient mêlées dans nos traditions populaires. Qu’étaient, en effet, toutes ces fées ravissant les nouveau-nés à leurs mères, et attirant les imprudents dans leurs piéges, sinon les sœurs des nymphes que Théocrite appelle déesses redoutables aux habitants des campagnes, parce qu’elles enlèvent les enfants près des sources et qu’elles entraînent les jeunes bergers au fond de leurs grottes humides? Comment ne pas reconnaître, dans ces rondes de nuit, auxquelles préside un génie, le danses des Alfes scandinaves conduites par le stram-man ou homme du fleuve? Enfin, ces dangereuses marchandes de talismans et de trésors ne rappelaient-elles point les Barrigènes gauloises vendant aux matelots la richesse, la jeunesse, la santé et les beaux jours?
—Vous pouvez ajouter, me dit le Provençal, que dans nos contrées, cette triple origine est encore plus visible. Chez nous les Blanquettes changent de forme à volonté et apaisent ou excitent les tempêtes, ainsi que le faisaient les prêtresses celtiques; elles dansent au clair de lune comme les vierges de l’Edda, en faisant croître à chaque pas une touffe de fenouil, présidant au sort de chaque homme à la manière des parques antiques. Toutes les maisons reçoivent leur visite dans la nuit qui précède le nouvel an. Avant de se coucher, chaque ménagère dresse une table dans une pièce écartée, elle la couvre de sa nappe la plus fine et la plus blanche, elle y dépose un pain de trois livres, un couteau à manche blanc, un peu de vin, un verre et une bougie bénie qu’elle allume avec une branche de lavande empruntée au brandon de la St-Jean, puis elle ferme la porte et se retire, comme on dit, à pas de renard. Le dernier coup de minuit sonné, les Blanquettes arrivent brillantes et légères comme des rayons de soleil; chacune d’elles porte deux enfants; l’un, qu’elle tient sur le bras droit, est couronné de roses et chante comme l’orgue: c’est le bonheur; l’autre, assis sur le bras gauche, est couronné de joubarbe arrachée des toits avant la floraison[3] et pleure des larmes plus grosses que des perles: c’est le malheur, selon que les Blanquettes sont contentes ou chagrines des préparatifs faits pour les recevoir, elles déposent un instant sur la table l’un ou l’autre enfant, et décident ainsi du sort de la maison pendant toute l’année; le lendemain la famille vient vérifier le couvert des blanquettes. Si tout est en ordre, on en conclut qu’elles sont parties satisfaites; le plus vieux prend le pain, le rompt, et, après l’avoir trempé dans le vin, le distribue aux assistants pour partager entre eux le bonheur! c’est alors seulement que l’on se souhaite bon an et joyeux paradis.
Tout en causant, nous avions continué à marcher; nous ne tardâmes pas à apercevoir une maison précédée d’une cour, et qui donnait sur une route qu’il fallut traverser. Je reconnus, au premier coup-d’œil, une de ces hôtelleries campagnardes où s’arrêtent les maquignons et les rouliers. Le postillon qui, depuis le moment où nous l’avions aperçue, faisait claquer son fouet pour annoncer notre arrivée, parut surpris de ne voir personne sortir à sa rencontre. La porte d’entrée était ouverte à deux battants, la cour déserte. Une grande carriole, trop haute pour s’abriter sous le hangar, avait été appuyée le long du mur de clôture. Notre guide regarda autour de lui.
—Eh bien! pas de maîtres et pas de chiens? dit-il, on entre donc ici comme au champ de foire?
Je fis observer que tout le monde était sans doute endormi.
—Non, non, reprit-il, les gens ne se couchent qu’à la mi-nuit; faut que Guiraud soit absent avec son gendre. La belle-fille est accouchée d’avant-hier, et la mère grand est sourde comme un pavé; mais que fait donc la petite Toinette?
—Voici quelqu’un, dit mon compagnon.
Une lumière venait, en effet, de paraître sur le seuil de l’auberge, et nous la vîmes s’avancer en sautillant au milieu de l’obscurité. Une voix se fit entendre avant que l’on pût distinguer la personne.
—Est-ce vous, nos gens! cria-t-elle de loin.
—Allons donc, moisson d’Arbanie[4], dit le postillon, j’ai cru qu’il n’y avait personne dans votre logane[5].
—Tiens, Jean-Marie! reprit la voix; il m’avait semblé que c’étaient ceux de la maison qui sont allés à Beauvais. Comment donc que vous êtes par ici avec vos chevaux?
—Per jou[6]! tu n’as qu’à le demander au petit pont qui a voulu manger un morceau de ma roue, répliqua Jean-Marie; un peu plus nous allions choir un beau mitan du Thérain.
—Ah! Jésus! ainsi vous avez versé?
—Et ça te fait rire, pas vrai, grecque[7] que tu es, vu que ça t’amène des voyageurs.
—Ah bien! comme si on en manquait au Lion-Rouge, dit Toinette d’un ton de fierté un peu dédaigneuse; il y en a déjà dix dans les deux chambres; leur carriole est là près du hangar.
En relevant la lanterne de corne qu’elle avait posée sur la neige, elle nous montra le chemin.
La lumière qu’elle tenait à la hauteur de son épaule l’enveloppait d’un rayonnement qui me la fit remarquer. C’était une fillette à la poitrine étroite et aux mouvements saccadés, dont le visage avait l’expression de hardiesse naïve qui marque, pour ainsi dire, la transition entre l’enfant et la jeune fille. Elle nous fit entrer dans une grande pièce éclairée par une de ces chandelles rugueuses et fluettes que l’auteur des Contes d’Espagne appelle poétiquement de maigres suifs. Une vieille femme filait assise dans l’étroite auréole de lumière. Dès l’entrée son aspect me frappa. L’âge avait fait disparaître de son visage toute la mobilité de la vie. Le regard était fixe, les lèvres fermées, le front sillonné de plis rigides et encadré d’une toile rousse qui semblait jaunie par les siècles. On eût dit quelque momie égyptienne à demi-sortie de ses bandelettes funèbres. Le corps raidi, elle tournait d’une main le rouet, tandis que l’autre tirait le lin de la quenouille. Ce double mouvement toujours pareil avait quelque chose de plus saisissant que l’immobilité même; il semblait voir la mort forcée de se mouvoir pour imiter la vie.
La fileuse ne parut point s’apercevoir de notre arrivée, et nous effleurâmes son rouet sans qu’elle y prît garde. Toinette nous avertit qu’elle avait cessé d’entendre et de voir. Pour lui rendre le passage suprême moins difficile, Dieu la faisait mourir à plusieurs fois; il l’habituait au sépulcre en l’enveloppant d’une nuit et d’un silence éternels.
Je contemplais avec curiosité les restes de cette enveloppe charnelle, maison démeublée dont la céleste habitante allait partir; je cherchais quelque trace de ce qui avait été jeune, vivant et beau, sur cette tombe d’un passé qui n’avait même point laissé d’épitaphe. Tout à coup les lèvres qui semblaient scellées s’ouvrirent; une voix confuse et inégale appela notre conductrice.
—Tona!
Tona courut à la vieille femme, appuya la bouche contre sa joue et répondit:
—Me voici, mère-grand.
—Les autres ne viennent-ils pas d’entrer? demanda la fileuse.
—Non, grand’mère, ce sont des voyageurs.
—J’ai senti leur air passer sur moi; dis-leur que Dieu les protége, Tona!
—Ils sont là et ils vous écoutent, mère-grand.
—Ah! tu as raison; il n’y a que moi qui ai les oreilles fermées! murmura la fileuse en soupirant.
Je regardai Toinette avec surprise.
—Mais elle entend! m’écriai-je.
—Quand je lui parle, répondit l’enfant; aucune autre voix ne peut lui arriver, c’est un don que Dieu m’a fait comme à sa filleule!
Je souris de cette croyance naïve. Le don, ainsi que l’appelait Toinette, avait en effet, une origine immortelle, car il lui venait de sa pieuse tendresse. Cette tendresse seule avait pu lui apprendre à approcher ses lèvres de la joue de l’aïeule, en ralentissant les modulations de la voix, afin que le souffle pût, en quelque sorte, y écrire les paroles prononcées[8]; le miracle lui venait du cœur.
Dans ce moment, le postillon rentra. Il venait de conduire ses chevaux à l’écurie et se plaignit de n’y avoir trouvé personne.
—Rougeot n’y est-il pas? demanda Toinette étonnée.
—Ah! bien oui, répliqua Jean-Marie, le galapian est encore de ripaille! En voilà un chrétien qui ne mourra pas de mal labeur! les jours de grande fatigue, il a neuf doigts qui se reposent.
—Et pourtant sa besogne est faite, dit la jeune fille.
—Si c’est possible! reprit le postillon émerveillé; il a donc toujours à son service le farfadet?
—Ce n’est point pour Rougeot que vient le farfadet, dit Toinette avec une sorte de vivacité; demandez plutôt à la mère-grand.
Et s’approchant de la fileuse:
—Pas vrai, grand’mère, que dans la famille il y a toujours eu le lutin?
—Guillaumet, répéta la vieille femme, sur les traits de laquelle passa comme un souffle de vie; oui, oui, c’est un vieux serviteur: il faut avoir soin de lui, Tona.
—Soyez tranquille, mère-grand, toutes les nuits je laisse la petite porte ouverte et la clé au garde-manger.
—Vous l’avez aperçu? demanda mon compagnon.
—Oh! non, dit la fillette, grand’mère nous a avertis que, si on cherchait à le regarder, il s’enfuyait, et que sa vue pouvait faire mourir; mais on l’entend balayer, cirer les tables ou tirer l’eau du puits.
—Faut pas mettre Guillaumet en colère! reprit la fileuse qui n’avait rien entendu de ce qu’on venait de dire et qui continuait sa pensée; les lutins ne sont pas chrétiens, vois-tu, fioule, et ils n’ont pas appris à pardonner.
—La grand’mère en aurait-elle fait l’épreuve? demandai-je, curieux de provoquer les confidences de la vieille femme.
Toinette transmit la question.
—Pas moi, pas moi, répondit-elle; quand Guillaumet était de méchante humeur, qu’il semait les cendres sur les planchers ou jetait des pailles dans le lait, je ne disais mot, et il reprenait son bon caractère. Ah! ah! ah! avec les farfadets c’est comme avec les maris, il faut laisser passer le nuage; l’ondée finie, ils sont pris de honte, et pour racheter chaque goutte de pluie, ils vous envoient trois rayons de soleil.
Ces derniers mots me prouvaient que l’âge n’avait point effacé du souvenir de la grand’mère les traditions du pays, et qu’en l’interrogeant, je pourrais beaucoup apprendre. Déjà, plusieurs fois, j’avais fouillé avec fruit dans ces mémoires à demi-éteintes, comme dans de vieilles éditions lacérées par le temps; mais je ne pouvais lui adresser de questions que par l’entremise de sa petite-fille, et celle-ci venait de nous quitter, attirée par les cris du nouveau-né, qui occupait avec sa mère une chambre dont nous n’étions séparés que par une petite cour. Je la vis bientôt revenir avec des langes qu’elle suspendit au foyer. La fileuse lui demanda des nouvelles de l’accouchée.
—La mère va bien, dit Toinette; mais elle donnerait une année de sa vie pour une heure de dormir, et le petit frère crie comme un aigle.
—Apporte-le, dit la vieille femme, je l’accâlinerai dans mon giron.
—C’est inutile pour l’heure, mère-grand, dit la fillette; il a pris le somme.
—Je ne dis pas que j’ai porté le berceau dans la chambre jaune, ajouta-t-elle en souriant; grand’mère aurait peur des fades qui viennent tourmenter les nouveaux-nés.
Ceci me servit naturellement de transition pour prier Toinette d’interroger la fileuse sur les superstitions populaires du canton. La jeune fille transmit fidèlement mes questions; mais les réponses de la vieille impatientée furent courtes. Mon compagnon, qui vit mon désappointement, haussa les épaules.
—Que Dieu vous bénisse! dit-il ironiquement; vous voulez tirer de l’huile d’un olivier mort.
—Ah! croyez-vous cela? dit Toinette; eh bien! vous allez voir si la mère-grand ne se rappelle pas quand elle veut!
Et s’approchant de la fileuse comme elle l’avait déjà fait:
—Pas vrai que le monde n’est plus comme quand vous étiez jeune, mère-grand? dit-elle d’une voix caressante.
La vieille hocha la tête, et répondit par une exclamation plaintive.
Le Provençal se retourna.
—Sur mon honneur la momie a soupiré! s’écria-t-il.
—Ah! c’était alors la bonne époque, reprit la jeune fille du même ton insinuant; vos amoureux plantaient des mais garnis de rubans devant vos portes; on faisait danser des rondes d’épreuve aux nouveaux venus pour savoir s’ils étaient braves; vous aviez de belles veillées où les anciens apprenaient le moyen d’échapper aux sorciers et de se faire bien venir des bonnes filandières.
Le rouet de la vieille s’était arrêté; elle écoutait la voix de l’enfant comme si elle eût entendu la voix même de sa jeunesse. Les rides de son visage s’agitaient et semblaient sourire, ses paupières s’entr’ouvraient; l’œil éteint cherchait la lumière. Nous regardions avec une curiosité étonnée cette espèce de résurrection que venait d’accomplir la parole de Toinette. La vieille femme porta la main à son front pour se rappeler, et ses doigts se mirent à jouer avec une mèche de cheveux blancs que ses coiffes laissaient échapper. Il y avait dans ce geste rêveur je ne sais quelle réminiscence de jeune fille dont je fus ému.
—Oui, oui, murmura la fileuse, qui semblait parler tout haut, à la manière des enfants ou des vieillards; comme le pays était beau alors! et quelles gens affables! Toujours un sourire quand on passait, et:—Bonjour la grande Cyrille! bonjours la jolie fille! Ah! ah! ils savaient vivre dans ce temps-là! Et pourtant Gertrude et moi nous étions les plus recherchées. Pauvre Gertrude, qui devait finir si tristement! Mais aussi son frère avait déniché sous le toit la poule de Dieu (l’hirondelle), et elle avait écrasé le cri-cri (grillon) de la cheminée. Quand on fait du mal aux petites créatures qui vivent sous notre protection, les bons anges pleurent et quittent le logis.
Ici, la voix de la grand’mère devint plus basse, elle continua quelque temps, en mots inintelligibles, sa divagation rétrospective; puis nous l’entendîmes gui parlait du rêve Saint-Benoît.
—N’est-ce pas lui, grand’mère, qui fait voir en songe l’homme qu’on épousera? demanda Toinette.
—Je l’ai vu, moi, reprit la vieille en souriant d’un air de triomphe; mais j’avais suivi toutes les prescriptions. La chandelle éteinte, j’avais mis mon pied nu sur le bord du lit en prononçant les quatre vers d’appel, et je m’étais couchée sans penser à rien autre chose qu’à celui qui devait dormir sur mon oreiller. Aussi, vers le milieu de la nuit, j’ai vu clairement, en songe, Jérôme, le postillon d’Achy.
—Et quand faut-il faire l’épreuve, grand’mère? demanda Toinette avec un intérêt attentif qui trahissait déjà de vagues souhaits.
—La veille de Noël, répliqua la fileuse; mais, pour réussir, il faut n’avoir contre soi ni fée, ni esprit, sans quoi ils rompent l’appel. Voilà ce qu’ils oublient tous maintenant, vois-tu, fioule; ils ne savent pas que les esprits sont autour de nous, sous toutes les figures, pour éprouver notre bon cœur ou notre méchanceté, et les bonnes filandières surtout ne quittent guère les chrétiens et les récompensent selon leur mérite. De mon temps elles ont enrichi plus d’une famille; aussi les pauvres gens les attendaient toujours, et ça rendait leur pain noir moins dur.
—Hélas! pourquoi donc, grand’mère, ne les voit-on plus? dit Toinette d’un accent plaintif.
—Les fades ont l’âme fière, répondit la fileuse; elles ne se montrent qu’à ceux qui les appellent avec confiance de cœur. Et comme on ne croyait plus en elles, la plupart ont quitté le pays avec leurs maris, les farfadets.
—Et cependant il nous en reste un, fit observer Toinette.
La vieille étendit la main avec une sorte de solennité.
—Tant que la mère-grand habitera le Lion-Rouge, dit-elle, les esprits viendront la voir; mais, quand ils auront entendu le marteau clouer son dernier lit, tous partiront avec leur vieille amie.
A ces mots, elle redressa sa quenouille, et le rouet recommença à faire entendre son ronflement monotone. Je regardai mon compagnon.
—Elle ne dit que trop vrai, repris-je; les vieilles générations emportent, en disparaissant, toutes les naïves croyances du passé, sans qu’il nous soit permis d’y substituer les rêves de l’avenir. Je viens de traverser les campagnes, et partout on m’a montré des grottes qu’habitaient autrefois les lutins ou les fées, en m’affirmant que leurs entrées se rétrécissaient chaque année, et que bientôt elles seraient closes pour jamais. N’est-ce point une symbolique-prophétie, et la tradition populaire elle-même ne semble-t-elle pas annoncer que la porte des illusions, ouverte jusqu’ici sur le monde, se referme lentement? Hélas! que vont devenir nos générations d’essai entre cet antique soleil qui se couche et ce jeune soleil qui n’est pas encore levé?
—Elles feront comme nous, reprit le Provençal, elles attendront qu’on ait remis une roue neuve à leur diligence; seulement elles ne feront pas la sottise d’attendre à jeun, et je propose de les imiter en soupant.
Jean-Marie déclara que nous n’en aurions point le temps, et commençait à prouver son assertion par un syllogisme invincible, quand mon compagnon cria de mettre pour lui un troisième couvert, ce qui dérouta subitement la logique du postillon et amena une conclusion contraire aux prémisses. Toinette se hâta de dresser la table devant le foyer, où flambait une de ces bourrées de traînes ramassées à la lisière des taillis. Elle déploya une nappe de grosse toile à franges et apporta des assiettes ornées de figures et de légendes rimées. Celle qui m’échut en partage reproduisait l’histoire d’Henriette et Damon, cette odyssée de l’amour parfait, c’est-à-dire malheureux et fidèle. Le Berquin populaire qui avait rimé l’amoureuse légende y racontait, avec une simplicité enfantine, le premier aveu des deux amants et la visite de Damon au père d’Henriette.
Le père refuse, en déclarant que sa fille doit entrer au couvent, afin de laisser tout l’héritage à son frère, et Damon part désespéré. Il est absent depuis plusieurs mois, lorsque le baron reçoit une lettre qui lui annonce la mort de son fils. Il court aussitôt en faire part à Henriette, qu’il veut retirer de son monastère; mais celle-ci a appris que Damon avait péri près de Castella, en Italie, et elle s’écrie à son tour qu’elle veut prendre le voile:
Elle va prononcer ses vœux, lorsqu’on annonce
Les nonnes veulent le voir, et Henriette reconnaît Damon, qui lui raconte ses aventures chez les infidèles, et sa délivrance par les religieux mathurins. Le père, qui est enfin touché, consent à unir les deux amants; mais, au bout de sept mois de bonheur, Damon meurt de mort subite, et la complainte finit par cette naïve réflexion qui pourrait servir d’épigraphe à la vie humaine elle-même:
Je relisais avec un demi-sourire cette ballade, où la puérilité de la forme n’avait pu détruire complétement la grâce touchante du fond, et, songeant à tant de générations dont les voix l’avaient chantée, je me demandais quelle inspiration de génie pouvait se vanter d’avoir éveillé autant de rêves et troublé autant de cœurs que ce romancero de village transmis de la mère à la fille comme un évangile d’amour.
Les cris du nouveau-né m’arrachèrent à ma rêverie. Depuis longtemps déjà, ils se faisaient entendre; mais Toinette, tout en se hâtant, voulait achever de mettre le couvert avant d’aller à l’enfant.
—Un instant, cri-cri, un instant, murmurait-elle; quand on est destiné à recevoir les gens, faut s’habituer à être servi le dernier.
—En voilà un huard qui n’aime pas qu’on landore! fit observer le postillon en riant; prends-y garde, Tona, car, comme dit le proverbe:
—Soyez tranquille, reprit-elle, les pauvres gens n’ont qu’à vivre pour prendre des leçons de patience.
Mais l’enfant n’avait point encore eu le temps de faire cet apprentissage; aussi ses cris devinrent-ils plus perçants. La grand-mère sembla prêter l’oreille. Soit que la voix frêle et claire du nouveau-né pénétrât plus facilement la sourde muraille qui l’enveloppait, soit qu’il y ait dans les femmes qui ont été mères un sens caché, que l’âge ni l’infirmité ne peuvent émousser, elle se redressa en s’écriant:
—L’enfant appelle!
—J’y vais, grand’mère, dit Toinette en achevant précipitamment les derniers apprêts.
—L’enfant est seul! répéta la fileuse d’un accent inquiet; sur votre salut, Tona, prenez garde qu’il ne soit mal doué par votre faute!
La jeune fille, effrayée du ton de la grand’mère, saisit une lumière, ouvrit la porte et traversa rapidement la petite cour. Je la suivis du regard au milieu de l’obscurité, et je la vis entrer dans une pièce du rez-de-chaussée, dont les fenêtres s’éclairèrent; mais, presqu’au même instant, un grand cri se fit entendre, et elle reparut sur le seuil, les traits bouleversés, les bras étendus et semblant reculer devant une vision.
Nous nous levâmes tous trois d’un même mouvement, et nous courûmes à la porte en demandant ce qu’il y avait.
—Elle est là, dans la chambre jaune! bégaya Toinette.
—L’accouchée? demandai-je.
—Non, non, la fade!
Et, comme nous faisions un pas pour y courir, Toinette nous arrêta d’un geste et fit signe de se taire. Un chant de berceuse venait de s’élever au milieu de la nuit. Ce n’était pas une mélodie précise, mais plutôt quelques-unes de ces modulations caressantes que les femmes improvisent pour leurs divagations maternelles. Il me sembla distinguer des mots d’une langue étrangère:
Mon compagnon tressaillit comme s’il eût reconnu ces paroles; mais Toinette lui saisit le bras:
—Regardez! murmura-t-elle d’une voix étouffée.
Sa main nous désignait la fenêtre éclairée; derrière le vitrage, une femme venait d’apparaître tenant dans ses bras le nouveau-né qu’elle berçait en chantant. Ses longs cheveux noirs tombaient sur ses épaules; elle avait les bras nus, et portait une espèce de basquine brillante de paillettes et de broderies. D’abord noyée dans la pénombre, la vision s’approcha bientôt de la croisée, où sa silhouette se détacha nettement encadrée dans la baie lumineuse. Le Provençal poussa une exclamation:
—Eh! Dieu me damne, c’est elle! s’écria-t-il.
—Qui cela? demandai-je.
—Ma Dugazon Languedocienne de Beaumont.
—Que dites-vous? Sous ce costume?
—Ne vous ai-je pas raconté qu’ils étaient tous partis hier soir sans avoir le temps de changer d’habits? La petite est encore une princesse de Sicile.
—Alors toute la troupe est donc ici? m’écriai-je.
—Ce sont les voyageurs arrivés avant nous, fit observer Jean-Marie.
—Et qui étaient tous empaquetés dans des châles et des manteaux, ajouta Toinette frappée d’un trait de lumière; justement leurs chambres sont là derrière.
—Pardieu! voilà le mystère, reprit le Provençal en riant, la princesse aura entendu les cris du marmot, et, en créature compâtissante, sera venue pour les apaiser. Attendez-moi là, je vais vous amener la fée.
Il courut à la chambre jaune, et nous le vîmes reparaître un instant après avec la jeune femme, qui riait aux éclats de la méprise. Le reste de la troupe, attiré par le bruit, vint bientôt nous rejoindre. Mon compagnon, ravi du hasard qui lui ramenait inopinément la jolie Languedocienne, déclara que nous souperions tous ensemble, et ordonna à Toinette de mettre l’auberge au pillage. La vue d’un menu des plus modestes, mais sur lequel ils n’avaient point sans doute compté, mit nos invités de belle humeur, et l’entretien prit un ton de gaieté bohémienne tout-à-fait divertissant.
C’était la première fois que je me trouvais en contact avec une de ces bandes errantes, pauvres hirondelles de l’art qui, moins heureuses que leurs sœurs du ciel, volent sans cesse après un printemps qui leur échappe et cherchent vainement un toit pour suspendre leurs nids. En voyant ces derniers vestiges de mœurs oubliées, je me figurais les comédiens de campagne avec lesquels Molière avait autrefois parcouru nos provinces, dressant, comme Thespis, des théâtres improvisés et ressuscitant un art perdu. Animés par le souper et par la vue d’un punch auquel le Provençal venait de mettre le feu, nos convives parlèrent de leurs excursions vagabondes, de leurs courtes prospérités, de leurs misères renaissantes. La Languedocienne surtout, que les soins galants de mon compagnon disposait à la confiance, se laissa aller à raconter une partie de son histoire. C’était un de ces romans mille fois refaits et toujours à refaire, qu’écrivent tour à tour l’insouciance, la jeunesse et la pauvreté. Elle nous le confiait avec des bouffées de folie et d’attendrissement dont les reflets passaient sur son visage comme passent sur un ciel changeant les rayons de soleil et les nuées. Elle avait autrefois habité chez un oncle, près de Céret, et parlait avec de naïfs ravissements de ses plaisirs de jeune fille: courses dans la montagne, contrapas dansées sur la place des villages, promenades de noces conduites par les joncglas, au son du galoubet et du tambourin.
Mon compagnon, qui avait passé plusieurs années dans le Roussillon, lui donnait la réplique et s’associait à tous ses enthousiasmes. Elle arriva à parler de la reine des danses méridionales, le ball, et il s’écria qu’il l’avait autrefois dansée en veste et en bonnet catalans; elle en marqua la mesure sur son verre, et il se leva en indiquant les poses; enfin, cédant tous deux à cet entraînement qui fait de la danse, dans les pays du soleil, une irrésistible contagion, ils se saisirent par la main et commencèrent les passes gracieuses de la baillas des Pyrénées. Ces passes consistent principalement en voltes, en retraites et en poursuites cadencées, qu’entrecoupent les fameux pas de la camada rodona et de l’espardanyeta[10]. La danseuse place ensuite sa main gauche dans la main droite du danseur, la balance trois fois, s’élance, d’un bond, et va s’asseoir sur l’autre main.
Cette danse hardie était entremêlée de cliquetis de doigts, de frappements de talons, de cris élancés, qui lui donnaient quelque chose d’élégant et de rustique tout à la fois; on se sentait emporter malgré soi par ces mouvements d’une spontanéité agreste; on s’associait d’instinct à cette joie en action. En contemplant, au-centre de l’aube lumineuse que répandaient les chandelles et le foyer, ce couple dansant de vieilles baillas, presque oubliées, et, au fond, plongée dans l’ombre, la grand’mère qui continuait de filer, étrangère à tout ce qui se passait, il me semblait voir les images de la tradition riante du Midi et de la tradition mélancolique du Nord s’éteignant toutes deux, l’une dans la lumière et le bruit, l’autre dans les ténèbres et le silence.
Le bruit d’un cheval qui arrivait au galop interrompit le ball. C’était le conducteur de la diligence qui arrivait. Il nous avertit que la voiture était remise sur ses roues, et il fallut songer à repartir.
Cette séparation parut coûter beaucoup à mon compagnon; un instant, il sembla hésiter; mais il était appelé à Abbeville par des recouvrements à échéance. Il épuisa, pour se dédommager, tout son vocabulaire de malédictions marseillaises, aux grands éclats de rire de la Languedocienne, qui, soit discrétion, soit indifférence, ne fit rien pour le retenir. Cependant, lorsqu’il la prit à part et qu’il se mit à lui parler vivement à demi-voix, elle devint tout à coup sérieuse. Quelques mots, qui arrivèrent jusqu’à moi, me firent supposer que le Provençal, ne pouvant adopter l’itinéraire de la jeune fille, lui proposait de suivre le sien; mais elle secoua la tête, et, lui montrant avec une subite mélancolie le fourgon que ses camarades se préparaient à atteler, elle lui répondit par les paroles solennelles que prononcent ses compatriotes lorsqu’ils viennent recevoir, sur le seuil, la jeune épouse de leur fils:—Ad pé d’aquet, ma hillo, quet caou biouré et mouri! (c’est à ce foyer, mon enfant, que tu dois vivre et mourir!)
Le Provençal lui serra la main sans insister; et nous rentrâmes à l’auberge pour prendre nos manteaux. La mère-grand, à qui j’adressai un adieu transmis par Toinette, nous accompagna jusqu’à la porte de souhaits d’heureux voyage, dans lesquels se mêlaient naïvement les superstitions antiques et les superstitions chrétiennes.
—Que Dieu leur fasse rencontrer une croix de bon présage ou une pie qui vole à droite! dit-elle en ayant l’air de se parler à elle-même; dans ma jeunesse, un voyageur ne quittait pas le Lion-Rouge sans prendre au vaisselier une feuille de laurier béni. Aussi le père en avait planté toute une haie dans le verger; mais nos gens l’ont arrachée pour agrandir le champ de luzerne, car maintenant on fait tous les jours la part plus petite au bon Dieu.
Je cherchai à détourner la vieille femme de cette pente chagrine, en la remerciant de ses récits des anciens temps et en exprimant l’espérance de pouvoir les entendre plus longuement au retour. Elle fit de la main un geste mélancolique.
—Tous les jours que je vis encore sont des délais accordés par la Trinité, me dit-elle gravement; l’aubépine qu’on avait plantée le jour de ma naissance à la porte est morte l’automne dernier; il n’y a plus ici de fleurs de mon temps; les gens et moi ne nous regardons plus du même coté! Tout ce que je demande, c’est que l’on ait le temps de tisser le fil de mes dernières quenouillées pour m’en faire un drap mortuaire.
—Elle a raison, dis-je en sortant au Provençal, sa présence semble un anachronisme vivant. Au foyer villageois, de même qu’au foyer des villes, tout est changé; c’est un théâtre dont le temps a fait tomber les décorations et a fermé toutes les fausses trappes. Le drame domestique s’y joue désormais, comme les proverbes, entre deux paravents. La muse de la famille, à laquelle nous devons les contes de nos veillées, est devenue sourde et aveugle comme la grand’mère, et, comme elle, on la voit filer son linceul.
Nous avions repris le sentier qui conduisait à la grande route. Le vent avait cessé de souffler, le froid était devenu moins vif. Les pâles lueurs d’une aurore d’hiver s’épanouissaient lentement à l’horizon. On commençait à revoir les ondulations de la campagne, les bouquets d’arbres et les hameaux épars, dessinant, dans le crépuscule, leurs formes confuses. Quelques chants de coqs perçaient la brume matinale, et, de loin en loin, des gémissements d’oiseaux engourdis se faisaient entendre au creux des fossés presque enfouis sous la neige. Avant de tourner le chemin qui conduisait à la grande route nous jetâmes un regard derrière nous, et, à travers la demi-obscurité, nous aperçûmes les comédiens groupés dans la cour du Lion-Rouge; ils achevaient leurs préparatifs de départ; mon compagnon soupira.
—Ne saviez-vous pas que cela devait finir ainsi? lui dis-je en souriant; nous avions commencé par les illusions, il fallait finir par les regrets. Regardez là-bas la grand’mère debout sur le seuil près de la princesse de Sicile. Ce sont là deux poésies que nous laissons derrière nous; notre nuit s’est écoulée, pour moi au milieu des féeries du vieil âge, pour vous au milieu de celles de la jeunesse; nous avons le même sort; après le rêve vient la réalité.
Et si vous vous en plaigniez à votre Languedocienne, elle vous répondrait par la phrase proverbiale de son pays: Cos coumte Ramoun[11]
On appelle Sillon une longue colline qui sépare du reste de la Bretagne tout le territoire compris entre l’embouchure de la Loire et celle de la Vilaine. La route de Nantes à Vannes suit la crète de ce rempart naturel. Vous avez alors, à droite, la Bretagne française, médaille effacée où l’œil le plus attentif chercherait en vain à distinguer une empreinte, tandis qu’à gauche s’étend jusqu’à la mer une contrée dont le paysage et la population ne ressemblent à nuls autres. Avant d’y entrer, vous n’aviez rencontré que des paysans de petite taille, aux membres noueux, à la figure pâle et d’un calme sombre; maintenant, vous trouvez des hommes grands, souples, colorés et riants. Là-bas la vie semblait se concentrer sous une forme solide, mais fruste; ici elle s’épanouit dans toute sa splendeur: à la race celtique a succédé la race scandinave.
Ceci est en effet une colonie des hommes du Nord. Débarqués là au Ve siècle, les Saxons y sont demeurés depuis sans se confondre avec les tribus voisines. Leurs familles agrandies sont devenues des paroisses dont presque tous les habitants portent les mêmes noms et ne se distinguent que par des sobriquets.
C’est surtout dans la Bryère et au pays des salines que la physionomie de la race étrangère est restée visible. Là les anciens coureurs de mer ont conservé un peu de leur humeur aventureuse. L’été fini, vous les voyez partir sur leurs futreaux[12] ou à la suite de leurs mules; ceux-là se dirigent vers Nantes, La Rochelle, Bordeaux, pour vendre la tourbe des marais; ceux-ci vont dans l’Ouest essayer la troque du sel. Le plus souvent la femme accompagne son mari. Assise sur la maîtresse mule, qui marche en avant ornée de houppes bariolées et de la grosse sonaille qui dirige la caravane, elle file ou tricote la laine rapportée des fermes de la Bretagne et de la Vendée, tandis que le saulnier suit en chantant quelque vieux cantique. Parfois un semestrier qui retourne au pays ou un piéton éclopé prend place sur un des doublons et s’associe, pendant quelques heures ou quelques jours, au voyage du négociant nomade.
C’est à la suite d’une de ces caravanes que j’avais commencé une excursion depuis longtemps projetée vers les côtes guérandaises, et je chevauchais le long du Sillon avec une douzaine de mules qui s’en retournaient au bourg de Saillé. Sauf quelques charges de grains et d’épiceries, toutes revenaient à vide sous la conduite du saulnier Pierre-Louis, surnommé le Grenadier. C’était un vaillant gars, au visage ouvert et de haute mine, qui prenait la vie en bonne part, récoltait de chaque jour tout ce qu’il en pouvait tirer, et s’endormait le soir sans s’inquiéter comment le soleil se relèverait le lendemain.
Pierre-Louis n’avait que deux mules dans le convoi avec lequel il était parti six semaines auparavant: les autres appartenaient, ainsi que leurs sommes de sel, à des voisins auxquels il devait en rendre compte; mais le voyage, malheureux pour tous, l’avait été particulièrement pour lui. Une de ses bêtes s’était perdue près de Chemillé; la seconde, estropiée en chemin, avait dû être vendue, comme il le disait, au prix des fers et de la peau. Il revenait ruiné, mais sans en paraître plus triste. Vêtu de sa souquenille et de ses grandes guêtres de toile blanche, le fouet noué en bandoulière, son chapeau à larges bords relevé du côté où ne brillait point le soleil, il suivait l’accotement de la route, les deux mains dans la poche ménagée sur le devant de sa blouse en manière de manchon, ou ciselant avec son couteau des baguettes de coudrier qu’il distribuait aux enfants du village.
Oisif ou occupé, Pierre-Louis sifflait toujours; tantôt c’était un air champêtre embelli de mille cadences, tantôt un fragment d’hymne d’église aux notes pleines et monotones, plus souvent des modulations improvisées dont le rhythme et le ton semblaient s’harmoniser avec toutes les rumeurs de la route. Ici elles imitaient le gazouillement des oiseaux, là elles devenaient susurrantes avec le bruit des sources, plus loin, confuses et prolongées comme le murmure du vent dans les brandes; partout enfin, quel que fût son caractère, le mélodieux sifflement du saulnier, en traduisant à son insu sa propre sensation, servait à compléter les aspects du site; il était devenu pour moi, avec le tintement de la sonaille, un accompagnement obligé du voyage. S’il se taisait, je sentais comme un vide subit dans ce qui m’entourait; mon oreille cherchait quelque chose, j’éprouvais enfin la même impression que le promeneur habitué au bruit d’une cascade quand la vanne du moulin se baisse tout-à-coup et étouffe la voix berceuse des eaux.
Dans ce cas, pour compensation, je renouais ordinairement l’entretien avec la saulnière, jeune et belle paysanne qui venait de faire son premier voyage de troque. Obligée de suivre son mari, elle avait dû laisser à Saillé un enfant en sevrage. A chaque village dépassé, elle supputait la distance amoindrie, et son grand œil noir fouillait l’horizon avec une ardeur avide. Pourtant chez elle, l’impatience même était souriante comme tout le reste; la tristesse ne semblait point avoir de prise sur cette puissante et sereine beauté. En la voyant, on se rappelait involontairement les ciels du Midi, d’un bleu si riche, que les nuages, au lieu de les voiler, semblent s’y fondre. Ses traits reflétaient, aussi bien que ceux de Pierre-Louis, ce contentement qui est la grâce du bonheur, mais avec un calme plus noble. Evidemment l’homme était gai par insouciance, la femme par soumission.
Nous avions côtoyé l’ombreuse vallée de la Chésine, et nous venions d’atteindre une longue chaîne de crètes dépouillées, quand la saulnière me fit remarquer les moulins du Sillon dont les ailes tournaient rapidement, bien que partout ailleurs nous les eussions vues immobiles. Je voulus expliquer ce contraste par la hauteur même des sommets; mais Pierre-Louis m’affirma que c’était un don de la Vierge, qui ne pouvait être annulé que par l’influence du Kourigan noir. De nouvelles explications me firent comprendre que ce dernier, également connu sous le nom de petit Charbonnier, était un génie à part; dans lequel l’imagination saxonne semblait avoir personnifié le malheur. Elle en avait fait le frère aîné de la mort! Jeanne me le représenta comme une sorte d’huissier funèbre que l’on rencontrait à chaque détour de la vie, moins pour avertir d’un désastre que pour le signifier. Elle même l’avait rencontré plusieurs fois, ainsi que Pierre-Louis, et toujours quelque chagrin avait suivi son apparition. A ce voyage encore, dans la soirée de leur départ, tous deux l’avaient aperçu à travers les haies qui bordaient la route; il les avaient accompagnés quelque temps, puis, traversant le chemin comme pour y laisser une trace de mauvais sort, il avait disparu en poussant un cri qui ressemblait en même temps à un éclat de rire et à une plainte.
Après avoir traversé Savenay, nous nous dirigeâmes vers Saint-Joachim. Quelque affaire du saulnier avec le parrain chez lequel Jeanne avait été élevée nécessitait ce détour par la grande Bryère.
Le pays que nous traversions avait évidemment formé autrefois une immense embouchure par laquelle la Loire précipitait ses eaux vers l’Océan. Entrecoupant alors de ses canaux tout l’espace compris entre Paimbœuf et le Sillon, le fleuve avait peu à peu grossi les atterrissements de sa rive droite. Là étaient venus s’entasser les sables et les limons changés aujourd’hui en prairies; le remous y avait conduit les arbres arrachés par l’inondation, et que l’on trouvait encore enfouis sous le sol qui leur avait donné la couleur de l’ébène; c’était la Loire enfin qui avait fait naître, puis détruit les forêts marécageuses dont la décomposition formait maintenant cette gigantesque tourbière de plus de vingt lieues de contour, connue sous le nom de grande Bryère.
Les traces de ce long effort des eaux étaient partout visibles autour de nous. La plaine entière avait l’aspect d’un lac récemment desséché. Sur l’aride fond de la tourbière s’élevaient de loin en loin, comme des corbeilles, des groupes d’îles verdoyantes que des chaussées reliaient l’un à l’autre. L’aspect de ces îles avait quelque chose de paisible, de sauvage qui reposait le regard. Au milieu de touffes d’ormeaux se dressaient des toits de chaume tellement déformés par les graments, les liserons et les saxifrages, qu’on les eût pris, à distance, pour des rocs creusés; les allouettes de mer et les cobrégeaux (courlis gris) tournoyaient autour de ces oasis rustiques avec des cris joyeusement aigus, et sur le penchant des îlots, paissaient des brebis d’un noir rougeâtre dont les bêlements se répondaient. Les lueurs du soir commençaient à teindre l’horizon; nous tournions le plateau parsemé de hameaux et de bocages. Tout-à-coup, au versant des îles verdoyantes que nous venions de côtoyer, se déploya la grande Bryère.
Qu’on se figure un désert, non de sable, mais d’éponge calcinée, au-dessus duquel flotte perpétuellement une brume lourde et fétide. Le terrain cahoteux forme des monticules et des vallées; mais vous montez en vain, les hauteurs n’ont pas de brises plus fraîches; vous avez beau descendre, les vallées n’ont pas d’ombrages plus verts. Toujours vous retrouvez la même teinte, la même atmosphère, la même stérilité. Partout s’étend un linceul roux tacheté de carex rigides; c’est l’uniformité dans son plus implacable ennui. Le sol pulvérulent fuit sous les pieds et en garde l’empreinte; les flaques d’eau, sans chatoiements, ressemblent à des mares d’encre; on dirait les lacs infernaux décrits par Virgile. Évidemment les flots de l’Averne ont passé là; et l’entrée du Tartare doit être proche.
Nous apercevions, de temps en temps, quelques paysans occupés à couper la tourbe. Vêtus de berlinge brun, leurs longs cheveux pendant jusque sur leurs épaules, le visage imprégné de poussière et de fumée, ils semblaient eux-mêmes faire partie de la tourbière; on eût dit qu’ils sortaient de ce sol noirâtre comme la nation de Cadmus des champs thébains.
Cependant notre caravane continuait sa route. Derrière notre belle saulnière, portant son élégant costume à couleurs éclatantes, venaient les mules, la tête ornée de branches vertes cueillies sur le chemin, puis Pierre-Louis, vêtu de toile fine et blanche. Il marchait en sifflant une mélodie champêtre qu’accompagnaient les tintements des grelots et les claquements cadencés de son fouet. Tout cet ensemble avait quelque chose de frais et de galant qui contrastait singulièrement avec notre entourage; c’était comme un rayon de lumière, de grâce et de gaieté traversant les ténèbres de l’ennui. Je ne pus m’empêcher de le dire à Jeanne; elle répondit par un hochement de tête méditatif.
—Oui, reprit-elle à demi-voix, la Bryère, ne rit pas à ceux qui la voient pour la première fois; mais elle ressemble aux femmes vieillies dans le ménage, qui ont plus de mérite que de beauté. Cette vilaine campagne, voyez-vous, fait vivre quasiment onze paroisses.
—Vous l’avez habitée long-temps? demandai-je.
—Quatorze années, dit la jeune femme en promenant sur l’aride désert un regard brillant, et ce ne sont pas les plus mauvais jours de ma vie. J’avais une coiffe de toile rousse et une jupe de berlinge, mais pas de soucis! On a beau dire, allez, le bon Dieu n’a encore rien inventé de mieux que la jeunesse.
—Ainsi vous regrettez le passé?
—Je ne regrette rien, monsieur, je me rappelle, voilà tout. Ah! fallait voir les belles corvées que nous faisions dans la Bryère, quand je venais pour y enlever la pélette[13] avec Gratien.
—C’était le fils de votre tuteur?
—Faites excuse; Gratien est un pauvre abandonné de l’hospice de Savenay que la parraine (la femme du parrain) avait pris en nourriture et qui est resté depuis au logis. Je l’ai quasiment vu grandir comme un frérot (jeune frère); il n’y avait pas de plus laid gars dans toute la paroisse, mais aussi c’était la meilleure créature du bon Dieu. Depuis, par malheur, quelque mauvais esprit lui a jeté un sort et l’a fait foléyer. Il n’est pour ainsi dire jamais au logis, et depuis mon mariage je ne l’ai point revu.
Elle me fit ensuite l’histoire de ces premières années passées dans la Bryère. C’était là qu’elle avait grandi, essayé ses forces, là qu’elle s’était comprise et qu’elle avait entrevu les mille horizons ouverts par l’espérance. Elle m’expliqua tout cela sans le savoir elle-même, en me racontant naïvement son passé. Pour me dire ce qu’elle avait senti, elle me dit ce qu’elle avait fait.
Son parrain, Michel Marou, coupait tous les ans dans la Bryère plusieurs milliers de mottes qu’il embarquait à l’étier de Méans, et qu’il conduisait lui-même en Loire. Le futreau dérapait chargé de sa montagne de tourbe; l’unique voile était hissée au mât, et l’on disait adieu au foyer pour plusieurs mois. Michel, Jeanne et Gratien composaient tout l’équipage. Tous trois remontaient lentement le fleuve, dont les vagues rasaient le bord de la barque surchargée et leur rejaillissaient au visage. A chaque bourg, le futreau était amarré à un saule, et l’on essayait de vendre ou d’échanger la tourbe, mais sans quitter le bateau. Son arrière-pont était devenu leur foyer flottant; l’habitude avait rendu suffisante l’étroite cabane où vivaient ces bohémiens des eaux.
Cependant leur navigation était parfois difficile et périlleuse. Quand la Loire couvrait ses rives, que les forêts de peupliers enfouies sous le débordement n’apparaissaient plus au loin que comme des champs de roseaux, que les eaux troubles et bouillonnantes se précipitaient en vingt courans furieux, roulant les arbres déracinés, les chaumes épars, les barges submergées, alors souvent la barque du Bryéron luttait en vain contre la vague, et flottait emportée à la grâce de Dieu. D’autres fois les glaces de l’hiver emprisonnaient le futreau pendant un mois entier près du bord; mais, si l’air venait à s’attiédir brusquement, un long craquement retentissait au haut du fleuve; on voyait un cavalier passer bride abattue sur la rive en jetant le cri terrible: la débâcle! et les glaçons détachés arrivaient de toutes parts comme des roches flottantes, broyant tout sur leur passage, avalanches d’autant plus redoutables qu’elles cachaient ce qu’elles avaient détruit, et emportaient mystérieusement vers la mer les cadavres et les ruines.
La jeune femme avait vu tous ces désastres et couru tous ces dangers; mais, l’épreuve subie, tout était oublié. Au premier rayon de soleil brillant sur le futreau à demi noyé, au premier oiseau gazouillant sur les branches du bouleau encore couvert de givre, la confiance renaissait à bord; les vêtements mouillés étaient suspendus aux cordages, la fumée du foyer remontait vers le ciel; Michel hissait la voile, Gratien jetait son filet dans le fleuve, et Jeanne reprenait sa quenouille avec sa chanson accoutumée.
La saulnière avait vécu ainsi quatre années, libre de désirs et de soucis. Un hasard lui fit rencontrer, à l’étier de Méans, Pierre-Louis, qui la prit à gré, et, contre l’usage de ceux de Saillé, ne craignit point d’épouser une femme née hors de sa paroisse. Bien qu’elle ne se plaignît point du saulnier, je crus comprendre que sa légèreté joviale avait eu pour résultat de dissiper la dot de la jeune femme et son propre patrimoine.
Nous en étions là, quand la rencontre de Michel Marou lui-même rompit l’entretien. Le parrain de Jeanne était dans la Bryère avec sa sœur, occupé à enlever la pélette. La saulnière les reconnut de loin, et mit sa monture au trot pour les rejoindre. Toutes les mules suivirent à la file, si bien que j’arrivai au moment où elle embrassait Michel et la vieille Bryéronne.
L’accueil de ceux-ci fut plutôt embarrassé que tendre. Comme tous les paysans, ils semblaient arrêtés dans leur expansion par une sorte de honte qui ôtait sa grâce au contentement. Tous deux restaient debout devant les nouveaux venus, ne sachant que rire et s’étonner de les voir. Enfin pourtant ils se décidèrent à prendre avec eux le chemin du logis. Jeanne avait laissé là sa mule et pris à pied, avec la vieille sœur, un sentier de traverse; moi-même je forçai ma monture à rompre les rangs et à ralentir le pas, afin de voir plus à loisir l’étrange paysage qu’éclairait alors le soleil couchant. Michel et le saulnier me précédaient de quelques pas, engagés dans une conversation dont plusieurs phrases m’arrivaient par intervalles, mais que j’entendais sans y prendre garde. Cependant le nom de Gratien éveilla, pour ainsi dire, mon oreille et attira mon attention.
—Est-il reparti? demandait Pierre-Louis, dont l’inquiétude perçait même sous l’accent moqueur de sa voix.
—Depuis deux jours, répliqua le Bryéron; il va et vient, comme ça, sans pouvoir dire pourquoi: on croirait un cobrégeau que la brise de mer amène et remporte.
—Mais la brise de mer, c’est toujours Jeanne?
—Toujours; il est aussi affolé d’elle que quand tu l’as épousée, et, si on prononce son nom devant lui, eût-il le morceau de pain près des lèvres, il se sauve comme le guillemot qui a entendu un coup de fusil.
Pierre-Louis éclata de rire.
—En voilà une rage! reprit-il ironiquement; la plus vilaine chouette du pays, s’enamourer d’une jolie fille comme Jeanne! Si elle se doutait de la chose, il y aurait de quoi la faire rire jusqu’au jugement dernier.
—Ne crois pas ça, dit Michel plus vivement, et surtout souviens-toi de ne lui en rien dire; tu m’en as juré ta promesse....
—Je l’ai tenue, foi d’homme! répliqua le saulnier; mais avez-vous peur qu’une pareille nouvelle tourne la tête de ma femme? Voilà-t-il pas de quoi la rendre glorieuse?
—Pas glorieuse, mais triste; tu ne connais pas la fille comme moi, Pierre-Louis. Au reste, en voilà assez; causons de tes affaires....
Ici les deux interlocuteurs parlèrent plus bas et marchèrent plus vite. Pour continuer à les entendre, il eût fallu presser le pas; mais je m’intéressais médiocrement à la suite de cet entretien. L’espèce de secret que je venais de surprendre excitait bien autrement ma curiosité, et je résolus de me servir de ce que j’avais appris pour découvrir ce qui me restait à savoir. Je cherchai pour cela des yeux la saulnière. Elle avait coupé au plus court à travers la Bryère, et je la distinguai gravissant un des monticules qui se dressent çà et là dans la plaine aride. Je forçai ma monture à prendre le trot, afin de la rejoindre; malheureusement la chose était moins facile que je ne l’avais supposé. Je rencontrais à chaque instant des flaques d’eau croupissantes qu’il fallait contourner, ou des coupes de tourbière interrompant brusquement le chemin. La nuit descendait d’ailleurs rapidement, et, par un contraste singulier, semblait plus profonde dans la Bryère qu’à quelques centaines de pas. Tandis que plusieurs îles se détachaient devant moi, si vivement éclairées par le soleil couchant qu’on pouvait y distinguer les moindres détails, l’espèce de vallée que je suivais était plongée dans une épaisse obscurité. Il me sembla même qu’un nuage de fumée se mêlait à l’ombre de la nuit; une odeur âcre me prenait à la gorge, ma respiration devint plus difficile, l’air me semblait brûlant. Bientôt ma monture elle-même fut en proie à un visible malaise: elle dansait sur ses jarrets, et reniflait avec angoisse; enfin elle tourna brusquement, voulut revenir en arrière, mais, retrouvant sans doute le même obstacle invisible, elle se jeta à droite tout effarée, rebroussa encore chemin, puis, comme emportée par une douleur furieuse, se mit à galoper en tous sens et à pousser des hennissements.
J’avais fait de vains efforts pour m’en rendre maître; rétive à la bride et à l’éperon, elle s’arrêtait par instants, se dressait sur ses pieds de derrière, puis retombait pour partir plus égarée. Forcément penché sur la selle, je m’aperçus enfin qu’une cendre blanchâtre recouvrait partout le sol, et qu’une fumée légère s’en échappait. Les sabots de la mule enfonçaient à chaque instant dans cette arène livide et en ressortaient vivement; en faisant jaillir des étincelles. A l’instant même, un souvenir me traversa la mémoire. On m’avait dit que la flammèche envolée du brasier d’un pâtre ou de la pipe d’un fumeur suffisait parfois pour mettre le feu à la tourbière, et que la sourde intensité de l’incendie déjouait tous les efforts des Bryérons; l’hiver seul pouvait l’éteindre. Je n’en pouvais plus douter, j’étais pris dans un de ces brûlis latents sans que la nuit me permît de distinguer ma route pour y échapper.
Sérieusement effrayé, j’allais jeter un cri de détresse, quand je fus prévenu par les voix de Michel et du saulnier, qui, ramenés près de moi par les détours du sentier, venaient de m’apercevoir. Tous deux comprirent à l’instant le danger, car ils coururent à ma rencontre et s’arrêtèrent à une petite distance en m’appelant. Je fis un effort désespéré pour contraindre la mule à se diriger de leur côté; mais, arrivé devant une mare étroite et sombre qui nous séparait, l’animal refusa de la franchir. Je n’étais qu’à une vingtaine de pas des deux paysans, qui continuaient à me crier: «Par ici!» et je ne pouvais décider ma rétive monture à avancer. Je la sentis même bientôt qui se dérobait sous moi et se préparait à reprendre sa course vers la tourbière en feu; Pierre-Louis, après l’avoir inutilement appelée par son nom et encouragée, saisit la perche que le Bryéron tenait à la main comme un bâton de route, il en enfonça le bout le plus mince dans la mare, prit son élan en s’appuyant à l’autre extrémité, et tomba sur la croupe même de la mule. Passant alors ses deux bras sous les miens, il s’empara de la bride, appuya les talons aux flancs de ma monture avec des cris familiers et la précipita, pour ainsi dire, dans la ravine.
A peine l’animal eut-il senti la fraîcheur de l’eau qu’il s’arrêta avec une sorte de soupir de soulagement. Son cou était blanc de sueur, et tout son corps tremblait. Pierre-Louis se pencha vers lui.
—Là, là, Belotte, dit-il en la flattant de la main et de la voix; ce n’est rien, ma fille, un bain de pieds va te guérir.
Je me retournai vers le saulnier avec un véritable élan de reconnaissance.
—Ma foi! vous êtes arrivé à temps, m’écriai-je en lui serrant la main, et vous venez de me rendre un service que je n’oublierai pas.
—N’oubliez pas surtout que, quand on ne sait pas conduire sa bête, il faut qu’elle vous conduise, dit le saulnier brusquement; c’était bien la peine de quitter le train de mules pour venir se jeter dans le brûlis! Voilà Belotte qui arrivera boiteuse au pays et qui me vaudra quelque affront.
Je le rassurai en déclarant que je prenais sur moi toute la responsabilité de l’accident.
—N’importe! dit Pierre-Louis, qui ne pouvait garder longtemps son humeur; Monsieur devrait savoir qu’on ne se promène pas dans la Bryère comme sur les places de Nantes. Dans ce pays-ci, voyez-vous, il faut avoir un œil au maître doigt de chaque pied, vu qu’il y a sur le chemin plus de mauvais pas que de couëttes de plumes; mais tout de même, nous voilà dehors pour le quart-d’heure, et maintenant ça ira!
J’avais déjà remarqué en chemin que c’était le mot favori du saulnier. Fallait-il remplacer une sangle brisée, se mettre à l’abri de la pluie ou du soleil, se détourner d’une route devenue impraticable, Pierre-Louis trouvait une corde, un sac ou un sentier de traverse, et répétait son mot philosophique: Ça ira! Cette fois, du reste, il l’avait justement appliqué, car la mule venait de sortir de la mare sans trop de peine. Je mis pied à terre, et abandonnant la bride au saulnier, je me retournai vers la tourbière en feu.
A la petite distance où nous nous trouvions, rien n’annonçait l’incendie qu’une fumée tamisée et pâle, rendue plus visible par l’obscurité. Michel me dit que ces accidents étaient heureusement assez rares, et que les pluies fréquentes apportées par les vents du sud-ouest arrêtaient presque toujours le fléau à sa naissance. Cependant on avait souvenir d’un embrâsement terrible, qui s’était insensiblement étendu à plusieurs centaines d’arpents, et avait menacé d’envahir la plaine tout entière. Il avait fallu sonner les cloches dans les onze paroisses riveraines; tous ceux qui pouvaient manier la bêche ou la pioche étaient venus, et l’on avait cerné l’incendie par une fosse d’une lieue de circuit. La mare que je venais de traverser en avait fait partie. Tout en me donnant ces détails, le Bryéron tâchait de retirer la perche que Pierre-Louis avait laissée enfoncée dans le lit tourbeux de la ravine; mais elle résistait à ses efforts, je dus lui prêter la main.
—Monsieur voit que la Bryère aime ce qu’elle tient, me dit Michel en souriant; qui laisserait là ma ningle seulement quelques jours la verrait disparaître jusqu’au bout. Rien n’est ici comme ailleurs. Il se passe quelque chose sous notre terre, savez-vous! On a beau manger la tourbe avec la bêche, elle reste toujours au même niveau, et la Bryère monte à mesure.
Je demandai si l’on donnait dans le pays quelque explication de ce phénomène.
—Pardieu! c’est la faute aux fils de Japhet, interrompit le saulnier en riant; Monsieur ne sait donc pas l’histoire? Il paraîtrait qu’au temps d’autrefois la Bryère avait comme qui dirait un rez-de-chaussée et une cave. Le tout appartenait aux kourigans et à la famille de Japhet, et chacun occupait à son tour le dessus ou le dessous; mais les hommes, qui étaient déjà des maugrebins, profitèrent du moment où ils demeuraient au meilleur étage pour murer dans la cave leurs voisins, si bien que tous sont restés là depuis, sauf le petit charbonnier, qui s’est enfui par la cheminée, et qui est devenu notre génie de malheur. Si la Bryère monte, c’est que les kourigans la soulèvent pour venir réclamer leur étage, et si les perches descendent, c’est qu’ils attirent à eux tout ce qui s’enfonce dans la terre.
Je couchai chez le Bryéron, dans un de ces lits de plumes dressés sur un double rang de fagots auxquels il faut monter comme à l’assaut, et qui, selon l’expression du pays, ne laissent que la passée sous le baldaquin. Le lendemain, nous nous remîmes en route dès la pointe du jour, et nous traversâmes la Bryère sans nouvelle aventure. Jeanne me parut seulement plus soucieuse que la veille. J’essayai en vain de lui parler; l’entretien tombait toujours, comme un volant qu’on ne vous renvoie pas. En désespoir de cause, je me retournai vers Pierre-Louis, dont la jovialité n’avait subi aucune atteinte, et j’allai le rejoindre avec ma mule à la queue du convoi.
—Eh bien! voilà un temps impérial, me dit le saulnier en me montrant le soleil qui montait à l’horizon dans toute sa magnificence; le bon Dieu illumine pour notre retour.
—Cela ne rend pas Jeanne plus gaie, répliquai-je à demi-voix.
Pierra-Louis jeta un regard vers la saulnière.
—Ah! monsieur a vu ça, dit-il; c’est vrai qu’elle a ce matin du noir dans le cœur! Ça vient de ce qu’elle a eu un signe.... Le petit charbonnier lui est encore apparu.
—Quand cela?
—Hier; après souper; monsieur était déjà couché: elle a voulu sortir dans le courtil pour faire sa visite aux avettes, mais, comme elle arrivait près des ruches, elle a vu le kourigan noir, qui se tenait tout contre.
—Et comment l’a-t-elle reconnu?
—Pardieu! à sa courte taille, à son costume noiraud et à son grand feutre qui lui tombe sur le nez, sans compter que ça se sent. Il n’y a pas dans tout le pays un enfant sorti du chariot à roulettes[14] qui, sans avoir jamais vu le méchant garçon, ne puisse dire: le voilà!
—Lui a-t-il parlé?
—Non! en l’apercevant, elle a jeté un cri et elle est restée en place, tremblante comme une feuille au vent; alors le kourigan a grommelé tout bas quelque chose qu’elle n’a pu entendre, puis il a disparu, et Jeanne est rentrée au logis plus pâle qu’un linceul. J’ai voulu lui relever le cœur; mais, pas moins, il y a de quoi faire penser, et ceci est une mauvaise annonce.
Nous étions sortis de la Bryère. Le pays dans lequel nous venions d’entrer prenait insensiblement un caractère non moins étrange, bien que complétement différent. Nous avions d’abord traversé d’immenses prairies encadrées de rideaux de saules, derrière lesquels on voyait glisser les hautes voiles des chalands de la Loire, puis l’étier de Méans, l’ancien Brivates portus de Ptolémée, couvert de chaloupes, de futreaux et de barges, qui attendaient les récoltes du pays; enfin, les campagnes de Saint-Nazaire, sur lesquelles ondoyait un océan de blonds épis. Là déjà les champs de sable avaient commencé; bientôt ils nous entourèrent; nous arrivions au terrain d’Escoublac.
Ici, comme dans la Bryère, vous trouvez un sol cahoteux et tourmenté. Des collines de sable balayées par le vent descendent, tantôt en talus abrupts et unis comme une pierre sciée, tantôt en cascades rugueuses comme un rocher. Des vallées, creusées en tous sens, sont parsemées de bancs de coquillages et de réservoirs d’eau saumâtre dans lesquels se reflète le ciel, et où semblent naviguer les nuages. Une ondée de sable fin tourbillonne perpétuellement sur ces champs déserts, où se dressent, çà et là, quelques chardons et quelques joncs marins. Du reste, ni habitations, ni cultures! On n’entend que le cri des alouettes de mer qui s’abattent par troupes sur ce sol aride, où leur plumage grisâtre empêche même de les distinguer. A la cîme de la colline la plus haute, un arbre élève son maigre feuillage, le seul de ce Sahara maritime: c’est l’arbre du cimetière de l’ancien bourg d’Escoublac. Ses racines poussent dans les tombes enfouies, mais les restes qu’elles renfermaient en ont été arrachés par la tempête. La même rafale qui avait promené si longtemps ces marins sur les mers continue à les rouler sur le sable qui recouvre leur berceau. Vous apercevez partout leurs ossements dispersés sur les pentes, et vous les sentez craquer sous vos pieds.
Mon conducteur avait consenti à se détourner un moment de sa route, pour visiter l’emplacement du village enseveli. Nous parcourions une plaine où le sol ondulé avait pris l’apparence des vagues; on eût dit une mer subitement pétrifiée par quelque enchantement. Pierre-Louis me montra, sur la hauteur, la place où lui-même avait vu, dans son enfance, la flèche de l’église dont la pointe alors perçait encore le linceul de sable; depuis, tout avait disparu.
Cependant notre caravane avait atteint un pli de terrain abrité, où quelques herbes marines brodaient l’arène de leur pâle verdure. Au pied du tertre qui protégeait ce coin privilégié, un enfoncement avait été creusé de main d’homme, et une pierre roulée en guise de siége. Sur le devant s’étendait une petite grève de sable durci par l’humidité. Jeanne, qui avait mis pied à terre, lâcha la bride de sa mule, et s’avança vers la grotte pour mieux voir le paysage; elle tenait à la main une branche d’osier encore garnie de feuilles qui lui servait de houssine, et elle en frappait le sol d’un air distrait. Tout à coup je la vis tressaillir et s’arrêter avec une exclamation de surprise épouvantée.
—Qu’y a-t-il? demandai-je en m’approchant.
—Voyez! dit-elle.
Et sa baguette, qui tremblait dans la main, me montrait le sol sur lequel étaient tracés quelques caractères mal formés imitant l’écriture moulée. Pierre-Louis s’approcha.
—Dieu me sauve! c’est ton nom! s’écria-t-il troublé.
—En effet, repris-je en regardant à mon tour, il y a bien Jeanne; mais que voyez-vous là qui puisse vous effrayer?
—Non, ce n’est rien, dit le saulnier, qui cherchait évidemment à surmonter une première impression; rien que des contes de vieilles femmes! A les entendre, quand on trouve, comme ça, son nom écrit dans les endroits où il ne vient personne, c’est un ajournement du mauvais esprit... du petit charbonnier, quoi!... Mais on ne croit pas à ces choses-là..... Le nom de Jeanne peut avoir été mis à cette place par n’importe qui.... peut-être bien par Monsieur lui-même.
En hasardant cette supposition, le saulnier me jeta un regard moitié interrogateur, moitié suppliant, qui semblait une invitation à l’appuyer: il cherchait un prétexte d’explication qui pût tromper la jeune femme et lui-même; mais Jeanne répondit de manière à prévenir tout mensonge. Elle nous avait suivis jusqu’alors, et savait que nous ne nous étions point approchés du placis où son nom se trouvait tracé. La marque de nos pas avait d’ailleurs écrit tous nos mouvements. Comme elle me les montrait, mes yeux remarquèrent sur le sable une empreinte singulière qui ne semblait laissée ni par le pied d’un homme ni par celui d’un animal connu. De forme triangulaire, cette empreinte était, pour ainsi dire, frangée par une rangée de griffes ou de doigts vaguement indiqués. Mes deux compagnons l’aperçurent aussi bien que moi, et se la montrèrent en silence. Je compris, au trouble de la saulnière et à l’empressement avec lequel Pierre-Louis rassemblait ses mules, que cette dernière indication levait tous les doutes. Le saulnier me pria assez brusquement de reprendre ma monture, et nous sortîmes des dunes.
J’aurais voulu m’expliquer ces pistes bizarres autour du nom de Jeanne; mais, quand je voulus interroger cette dernière, elle me répondit avec une réserve pleine de répugnance. Le saulnier lui-même avait momentanément perdu son insouciante gaieté: il marchait derrière nous, la tête basse et les mains sous les aisselles, sans prendre garde à ses mules, qui, par instants, rompaient la file pour arracher aux buissons quelques jeunes repousses de ronces ou d’églantiers.
Ceci me frappa sans me surprendre. J’avais déjà pu remarquer plus d’une fois combien facilement l’imagination de ces coureurs de route inclinait au merveilleux. Livrés à toutes les illusions que peuvent créer l’ignorance et le désir, ils suivent les chemins déserts en interrogeant les lueurs et les ombres, les silences et les rumeurs. Peu à peu la fascination de la solitude les trouble; ils sentent leur raison vaciller et mille images confuses se former dans les ténèbres. Bercés par le pas lent des mules et à demi endormis au son de leurs grelots monotones, ils voient les arbres courir à leurs côtés comme des fantômes; le vent qui siffle dans les rochers devient une voix qui les appelle; le bruissement de l’eau, une plainte de trépassés. Tous les incidents de l’obscurité se transforment en mystères saisissants. Un monde imaginaire se substitue, de plus en plus, au monde réel; ils aperçoivent ce qu’ils ont imaginé, ils entendent ce qu’on leur a raconté. En vain demandent-ils à leur gourde de voyage l’assurance et la lucidité qui leur échappe, chaque gorgée d’eau-de-feu évoque un nouvel essaim de visions, jusqu’à ce qu’étourdis d’ivresse, ils glissent de leur monture et s’endorment sur le gazon de quelque carrefour. Là, continuant leur voyage dans le sommeil, ils passent de plain-pied de la réalité au rêve. C’est alors que les muletiers qui traversent les mielles[15] de la Normandie rencontrent, dans leurs songes, le moine trompeur, assis sur la pierre du chemin avec ses piles d’or attirantes, ses cartes qui gagnent toujours, et proposant au passant de lui jouer son âme; c’est alors qu’ils voient la mule d’égarement qui se laisse monter par le premier venu, puis disparaît pour toujours avec lui, ou qu’ils entendent le grelot maudit tintant au-dessus des vagues et attirant les voyageurs aux abîmes. Les saulniers de la Loire n’échappent pas plus que ceux de la Manche à ces hallucinations décevantes. Eux aussi, l’inconnu les enveloppe et les épouvante. Vous leur opposerez en vain tous les raisonnements: l’imagination populaire a bâti son poème au-dessus de la région que ceux-ci peuvent atteindre; tout au plus les amènerez-vous à un doute de complaisance qui est encore l’expression de la foi.
Cependant nous avions atteint une campagne soigneusement cultivée, et dont on commençait à enlever les moissons. On entendait de tous côtés des chants dont je ne remarquai d’abord que la mélodie traînante; en approchant, je m’aperçus que les paroles en étaient improvisées et adressées à l’attelage, qui semblait les comprendre. Si la voix fatiguée cessait de se faire entendre ou seulement fléchissait, on voyait le joug s’abaisser, les pas s’allanguir; mais que le chant reprît, les bœufs relevaient la tête en faisant un nouvel effort.
Je ralentis la marche de ma monture pour écouter un jeune paysan dont le chariot, chargé de gerbes, côtoyait, au-delà du fossé, la route que nous suivions. Il répétait, dans un mode plaintif et sur le ton élevé ordinaire aux chanteurs de la campagne, un de ces ranz champêtres dont les paroles, immédiatement recueillies, me sont souvent revenues à la mémoire. L’improvisateur les adressait à son attelage.
Certes, on peut dire ici comme pour la chanson d’Alceste:
Mais ce cantique joyeux du pauvre laboureur sentant qu’il ramenait à la ferme, avec ses gerbes, les chants des femmes et la gaieté des enfants, cette espèce de confidence faite à ses humbles compagnons de peine, dont il avouait ingénuement que sa prospérité était le gain, tout cela embelli par un beau soleil d’août, un paysage paisible, et surtout par la grâce de l’imprévu, me causa alors une émotion que je ne puis me rappeler sans qu’il m’en revienne quelque chose. Il y avait tant d’harmonie entre les sourires du ciel, l’abondance de la terre et la naïve allégresse du poète campagnard, que le tout se confondait, pour ainsi dire, et que la rusticité du dernier disparaissait noyée dans la grande poésie de l’ensemble.
Pierre-Louis, qui s’était aperçu que j’écoutais, se rapprocha.
—En voilà un vrai bœuier, me dit-il, et qui sait bien arauder sa couplée! Cette chanson-là, voyez-vous, ça vaut tous les aiguillons quand on veut faire marcher les dormeurs. Il n’y a rien comme la voix d’un chrétien pour les bêtes que Dieu nous a données à service; ça leur soutient le cœur. Si je ne sifflais pas mes mules, leurs sommes de sel auraient doublé de poids.
Pendant tout ce temps, Jeanne était restée étrangère à l’entretien, et comme indifférente à ce qui l’entourait. Son regard, toujours tourné vers l’horizon, dévorait l’espace. Elle s’agitait sur sa monture; elle la frappait à chaque instant de sa baguette de saule pour presser son allure; ses traits avaient pris une animation presque fiévreuse. Nous commencions à croiser des gens que Pierre-Louis connaissait et avec lesquels il échangeait, en passant, quelques paroles amicales; mais Jeanne n’écoutait pas et allait toujours. Enfin le saulnier, qui était venu la rejoindre en tête de la caravane, mit tout à coup la main sur la bride de sa monture.
—Qu’y a-t-il? demanda la saulnière en tressaillant.
—Tu ne vois donc point, là-bas? dit Pierre-Louis, qui lui montrait l’horizon.
—Un clocher?
—Celui du pays!
Elle poussa un cri, laissa tomber sa baguette et joignit les mains.
—Mon enfant! mon pauvre petit enfant! balbutia-elle.
Un flot de larmes lui montait aux paupières et inonda bientôt ses joues. Pierre-Louis fut ému de son émotion.
—Un peu de patience! un peu de patience! ma pauvre créature, dit-il en la regardant avec amitié, voilà que nous allons arriver... Voyons, Noirette, ferme, ma fille! Allongeons le pas pour contenter la saulnière.
Soit que la mule comprît la prière de Pierre-Louis, soit que l’approche du pays eût réveillé sa vigueur, elle prit une allure plus vive. Jeanne ne disait rien et continuait à essuyer ses yeux. Dans ce moment nous fûmes croisés par un train de mules dont le conducteur reconnut mes deux compagnons. Il les salua, mais avec je ne sais quel air embarrassé qui me frappa.
—Il n’y a rien de nouveau au bourg? demanda le saulnier.
—Rien que le mariage de Jean Coup-de Trique, répliqua son interlocuteur.
—Et... mon petit Pierre? demanda Jeanne avec angoisse.
—Vous le verrez, répliqua le muletier, qui, sans attendre de nouvelles questions, prit congé et rejoignit en courant son convoi.
La saulnière parut encore plus agitée, et elle força sa mule à prendre le trot. Je la suivis avec une inquiétude dont je ne pouvais me rendre compte; en entendant les cloches sonner, je demandai malgré moi si c’était un glas.
—Non, me répondit Jeanne, c’est l’Angelus.
Nous venions d’atteindre les premières maisons du bourg; une femme, qui filait sur une porte, reconnut Jeanne et courut à elle.
—Ah! pauvre mignonne! vous arrivez à temps, s’écria-t-elle.
—A temps, pourquoi? demanda la saulnière.
—Vous ne savez donc pas? reprit la vieille femme déconcertée.
—Quoi? quoi? répéta Jeanne haletante.
—Eh bien!... votre fiot!....
—Mon petit Pierre?....
—Il a la fièvre rouge!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous trouvâmes l’enfant au plus fort d’une maladie éruptive qui me parut avoir un très mauvais caractère. On avait fait venir un médecin qui avait laissé une ordonnance sans donner grand espoir. La fièvre rouge décimait alors tout le pays de Guérande, et il était peu de maisons où elle n’eût laissé quelque berceau vide.
Jeanne en fut aussitôt instruite par les voisines accourues autour de l’enfant malade. Etrangères à ces tendres précautions qui tâchent de nous épargner l’inquiétude en nous cachant le danger, elles lui firent boire d’un seul trait la coupe d’amertume. Il fallut écouter les noms de toutes les mères dont les fils avaient été conduits au cimetière, entendre pleurer d’avance celui qui vivait encore, et supporter de vulgaires encouragements qui ôtaient l’espoir sans consoler. J’admirai la manière dont Jeanne endura ce coup. Après le premier étourdissement de la douleur, elle sembla retrouver son calme dans la grandeur même de l’épreuve. Elle essuya ses yeux, étouffa ses sanglots; une sorte d’énergie sereine éclaira son visage. Ecartant les parents qui entouraient le berceau du malade, elle se mit à lui donner les soins nécessaires et à reprendre, pour ainsi dire, possession de sa maternité. Il était facile de voir qu’elle comprenait son malheur, mais qu’au lieu de le déplorer, elle voulait le combattre, et qu’elle ajournait les larmes. Au milieu des irritantes lamentations des femmes qui l’entouraient, elle s’informait avec une patiente douceur de la durée de la maladie, de toutes ses circonstances, des prescriptions du médecin; elle accomplissait sans rien dire celles qui avaient été négligées, revenait vers l’enfant au moindre gémissement, employait pour l’apaiser ces mille câlineries que savent inventer les mères, et s’efforçait de le réaccoutumer à ses caresses et à sa voix.
La conduite de Pierre-Louis avait été toute différente. Après s’être associé aux plaintes bruyantes des voisines, il avait fini par s’asseoir à quelques pas, accusant son voyage, poussant des soupirs ou des malédictions, et épuisant toutes les expressions banales d’une douleur qui veut en finir avec elle-même. Ce tumulte de désespoir ne tarda pas, en effet, à s’apaiser. Il s’approcha du berceau, et trompé, moitié de bonne foi, moitié parce qu’il le voulait, à la vue de l’enfant, dont les traits étaient allumés par la fièvre, il déclara qu’il paraissait mieux.
—Que le bon Dieu le veuille! dit Jeanne avec une douceur qui m’attendrit.
—C’est sûr qu’il le veut, reprit Pierre-Louis, qui tenait à se rassurer; vois plutôt comme il dort! Pauvre fiot! ça ne sera presque rien. Faut jamais se tourmenter avec les petits; le mal les abat tout de suite, mais ça repousse comme l’herbe foulée.
Jeanne se pencha sur le berceau pour chercher une espérance. Les voisines étaient parties; on n’entendait que la respiration oppressée de l’enfant. Le saulnier resta un instant debout, roulant son feutre et tâchant de reprendre de l’assurance.
—Allons, je n’ai plus peur! dit-il enfin; ce sont ces causeries de femmes qui m’avaient brouillé le cœur. Regarde donc s’il est seulement pâle, notre chérubin.... et comme il respire fort..... Sois calme, va, pauvre fille, le bon Dieu ne nous fera pas encore de chagrin cette fois.
La saulnière joignit silencieusement les mains sur les bords du berceau; elle priait sans doute en elle-même.
Pierre-Louis ajouta encore beaucoup de remarques par lesquelles il prétendait la rassurer, et qui réussirent au moins pour son propre compte. Habitué à traverser les sensations sans s’y arrêter, il avait bientôt oublié ses craintes et se retrouvait peu à peu revenu à sa joyeuse confiance. Il se rappela alors que les mules attendaient à la porte, et il sortit pour les ramener à leurs maîtres. Je pris également congé de la jeune mère, en promettant de revenir m’informer de son enfant.
Le saulnier me montra, chemin faisant, la maison de l’hôte chez lequel j’étais attendu. M. Content (c’était le surnom donné, dans le pays, à cet excellent homme), m’accueillit à bras ouverts, et se chargea de me promener partout. Notre première excursion fut vers les salines, où nous trouvâmes les saulniers à l’ouvrage. Les chaussées de ceinture, connues sous le nom de bossis, étaient couvertes de mulons de sel déjà surmontés du toit d’argile qui devait les défendre contre les pluies de l’hiver. Régulièrement rangés autour du marais, les mulons rappelaient, par la forme et la couleur, ces tentes de poils de chameau que dressent les tribus arabes dans les plaines de l’Algérie. De grandes et belles jeunes filles, portant sur leurs têtes les jattes de bois ou gèdes chargées de sel, couraient pieds nus le long des cloisons glissantes du marais. L’efflorescence d’un blanc d’albâtre qui couronnait le sommet de la ladure devait payer leur fatigue. Une odeur de violette s’exhalait autour de nous sous la lace (rateau) des saulniers; partout retentissaient des rires, des chants, des cris d’appel; on sentait circuler dans l’air la joie qui naît de l’abondance et de l’activité.
Une partie de la récolte de sel était déposée par tas inégaux autour d’étroits placis. N’ayant point payé l’impôt, elle était là sous la garde de douaniers qui veillaient jour et nuit pour en prévenir l’enlèvement par les fraudeurs. Mon conducteur s’arrêta à quelques pas d’une de ces panthières que surveillait un des agents substitués aux commis de l’ancienne gabelle, et qui ont conservé dans le pays le nom de gabelous. C’était un petit homme à la figure chafouine, à l’œil effronté, et dont les mouvements avaient une certaine nonchalance éreintée parodiant l’allure des anciens marquis. Bien que son apparence fût chétive, on sentait en lui une vitalité nerveuse qui n’est point la force, mais qui y supplée. M. Content me le présenta sous le nom du Parisien en l’avertissant que j’arrivais de son pays. Le douanier m’adressa un de ces saluts insolemment polis, particuliers aux faubouriens de la grande ville.
—Ah! Monsieur vient de chez nous? dit-il en me regardant, comme s’il eût voulu s’assurer de la provenance: pourrait-il me dire ce que fait pour l’instant le cavalier du Pont-Neuf?
—Mais sa faction, comme vous, répliquai-je en souriant et sans prendre garde à son air ironique.
—Monsieur fait erreur, reprit-il plus poliment; je ne prends la panthière qu’à la mi-nuit, et je suis ici maintenant en amateur, à cette seule fin d’admirer les grâces de nos paludières. Ça ne vaut pas les débardeuses de l’île d’Amour; mais à la campagne on prend ce qu’on a. Monsieur doit apporter des nouvelles de là-bas.
Je lui rapportai ce que je savais de plus récent; mais le Parisien ne s’intéressait qu’aux affaires des théâtres de boulevard, dont il avait autrefois fréquenté les parterres. Pour lui, l’histoire de France se trouvait comprise entre la porte Saint-Martin et la rue de Ménilmontant. Il m’interrogea sur les pièces, sur les décorations, sur les acteurs, en entrecoupant ses questions de tirades et d’anecdotes. Il avait assisté pendant quinze années, en qualité de chevalier du lustre, à toutes les premières représentations, et en parlait comme un vétéran parle des grandes batailles de l’Empire. Je voulus savoir ce qui avait pu faire consentir l’ancien romain à cette émigration dans les marais de la presqu’île guérandaise; mais il évita de répondre en feignant de croire que je lui demandais des détails sur sa nouvelle position. Convaincu, comme tous les Parisiens de naissance, que la civilisation française n’a pu dépasser la banlieue, il me déclara, avec une sorte de philosophique indulgence, que le pays était habité par des sauvages.
—C’est honnête et pas méchant, ajouta-t-il en haussant les épaules; mais pour ce qui est des moyens, néant, comme on écrit au rapport. Ça obéit toujours au maire, ça respecte le clergé; hommes et femmes sont abrutis par la religion. Faudrait, voyez-vous, que la troupe de l’Ambigu vînt un peu leur jouer le Presbytère et l’Archevêché; mais bah! les trois quarts ne savent pas seulement ce que c’est qu’un théâtre: ils vont à l’église, et ça leur suffit. Un vrai bétail, Monsieur! A peine s’il y a dans toute la commune une demi-douzaine de malins qui essaient de la fausse saulnerie; encore finissent-ils toujours par se faire pincer.
M. Content fit observer que la faute en était surtout au Parisien, qui déjouait toutes leurs ruses.
—Oui, oui, répliqua le douanier avec une certaine fatuité, quand je suis arrivé, il croyaient me faire poser. Un Parisien, pensaient les malins, ça n’a jamais vu fabriquer le sucre des gueux, ça n’entend rien au métier, et nous pourrons faire un trou à la poche du gouvernement! Mais moi, qui devinais la chose, je m’étais dit:—C’est bon! vous verrez si on connaît les ficelles! Voilà donc qu’à la première caravane de mulets, les plus vieux gare-devant fouillent et mesurent les sommes de sel. Rien de prohibé:—mes gredins de faux-saulniers riaient en dedans et allaient repartir, quand je me rappelle le Sonneur de Saint-Paul et les papiers cachés sous le bât. Pour lors, je fais dessangler, et qu’est-ce que je trouve? partout du sel au lieu de bourre!
—Je vois que vous êtes trop fort pour ces pauvres gens! dis-je en souriant.
Le Parisien haussa les épaules.
—Mon Dieu! non, répliqua-t-il avec une modestie triomphante; mais on connaît son répertoire.
Parmi les marais couverts de travailleurs occupés à la récolte, un seul restait désert, et, comme nous approchions, j’aperçus Pierre-Louis debout sur le bossis. A ma vue, il fit un geste désespéré en me montrant la ladure, où blanchissait à peine une écume salée.
—Quand on disait à Monsieur que nous allions tomber sous le mauvais sort! s’écria-t-il; Jeanne a trouvé là-bas le petit Pierre malade, et moi je trouve ici ma saline qui échaude.
Je savais que les paludiers désignaient ainsi les marais dont la production s’arrêtait subitement, et j’avais été témoin ailleurs du phénomène. Je voulus faire comprendre à Pierre-Louis que le sel marin enlevé à plusieurs reprises, sans que l’eau eût été renouvelée, se trouvait maintenant assez peu abondant pour que les autres sels en dissolution l’empêchassent de se cristalliser. M. Content ajouta que la faute en était à ceux que Pierre avait chargés de ses saulnaisons, et qu’en faisant une nouvelle prise d’eau, son marais serait simplement retardé; mais Pierre-Louis paraissait frappé: il secoua la tête sans répondre et se mit à faire le tour des chaussées pour examiner les cobiers. Je ne pus retenir une réflexion d’étonnement sur les constantes disgrâces qu’avait eu à subir le jeune saulnier; mon conducteur me répondit en souriant:
—Il fait son apprentissage; le tour des heureuses chances arrivera; mais il faut pour cela que Pierre-Louis devienne moins prompt à entreprendre et plus lent à oublier. Jusqu’à présent les leçons ne lui ont guère profité qu’un jour; le chagrin glisse sur lui comme la pluie sur nos toits, le moindre soleil suffit pour tout sécher. Avec l’âge viendra la prudence. C’est à force de prendre garde et d’être patient que nos gens peuvent nouer les deux bouts de la vie, car entre le baptême et l’enterrement la route a bien des descentes et bien des montées. Ailleurs, Monsieur, on coupe le blé par gerbes, ici il faut le ramasser grain à grain. Une famille de paludiers ne peut soigner que cinquante œillets, qui lui rapportent un peu plus de deux cents francs pour cinq personnes. Comment vit-elle avec une pareille somme? Je ne saurais vous le dire. C’est un de ces miracles d’industrie et de sobriété qu’on ne peut expliquer, mais qui ont cessé de surprendre, parce qu’ils se renouvellent tous les jours.
Dans ce moment, le Parisien, qui avait suivi Pierre-Louis, revint vers nous avec de grands éclats de rire.
—En voilà un Cosaque! s’écria-t-il en nous montrant le saulnier qui avait repris le chemin du bourg, savez-vous qui il accuse de ses désagréments?
—Le petit charbonnier?
—Juste! Quand j’avertissais Monsieur qu’ici ils étaient tous abêtis par les préjugés! Ils ne comprennent seulement pas que chacun a une bonne ou une mauvaise destinée, ce que Napoléon appelait son étoile! moi qui vous parle, j’en ai une et du bon cru, faut croire, car deux somnambules, élèves de Mlle Lenormand, m’ont prédit un riche mariage avec une demoiselle titrée.
Je souris malgré moi. L’incrédulité du douanier ressemblait à celle de la plupart des esprits forts; ce n’était qu’un déplacement dans les superstitions; les erreurs de son prochain lui faisaient pitié, parce qu’il en avait d’autres.
En rentrant dans le bourg, nous rencontrâmes une foule endimanchée, réunie devant une maison: c’était la noce de Jean Coups-de-trique, le cousin de Pierre-Louis. Ce dernier, arrêté au passage, s’était laissé entraîner et nous l’aperçûmes attablé devant la porte avec d’autres saulniers.
A la vue du douanier, ils semblèrent se consulter, puis l’appelèrent en l’engageant à leur tenir compagnie.
—Viens trinquer, gabelou, c’est du condor, lui cria l’un des buveurs.
—Connu! répliqua le Parisien, c’est comme qui dirait le château-Margot du pays.
Et, se tournant vers moi avec une grimace narquoise:
—Ça ne vaut pas tout-à-fait le piqueton d’Argenteuil, ajouta-t-il tout bas; mais il ne faut jamais humilier ceux qui régalent.
A ces mots, il nous salua d’un air léger et alla rejoindre les saulniers.
La nuit commençait à tomber. Comme nous traversions la rue, j’aperçus une fenêtre où brillait une lumière, et je reconnus la maison de Jeanne. Avant de retourner chez mon hôte, je lui demandai la permission de visiter la saulnière et de m’informer de son fils. Rien n’était changé dans son état; mais, soit que les forces de la mère eussent cédé, soit que l’isolement eût exalté son inquiétude, elle me parut moins maîtresse d’elle-même. Ses yeux étaient rouges, sa voix brève, ses mains tremblantes.
—Le petit Pierre mourra! me dit-elle, en regardant le berceau avec un accablement égaré.
Je voulus la rassurer; elle m’écouta sans prononcer un mot, sans faire un mouvement, puis alla s’asseoir sur la pierre du foyer où elle se mit à sangloter. Lorsque ses plaintes s’arrêtaient, on entendait la respiration rauque de l’enfant, et, par intervalles, les rires de la noce ou les chants des buveurs! L’obscurité était plutôt rendue visible qu’elle n’était dissipée par la chandelle de résine posée à terre. Ce berceau d’un enfant à l’agonie, et cette femme qui pleurait accroupie dans la pénombre formaient un tableau trop naïvement douloureux pour ne pas remuer le cœur. Je fus touché de tant de tristesse et d’abandon. J’essayai de persuader à la saulnière que ses craintes tenaient surtout à sa disposition d’esprit et aux avertissements mystérieux qu’elle se figurait avoir reçus pendant la route. Elle releva vers moi son visage baigné de larmes.
—Pendant la route et depuis! me dit-elle.
—Depuis? répétai-je surpris; que s’est-il donc passé?
Elle promena autour d’elle un regard effrayé.
—Eh bien! reprit-elle plus bas, avant l’arrivée de Monsieur, je me tenais là, près de l’enfant; le soir était venu, et je n’avais pas encore allumé de clarté, car, à force de pleurer, je ne faisais plus de différence entre le jour et la nuit, quand j’ai entendu près de moi des pas, puis un soupir. J’ai relevé la tête, il n’y avait personne. J’ai cru que je m’étais trompée; mais, presque au même instant, les soupirs ont recommencé. J’ai entendu mon nom aussi clairement que je vous entends me parler, et, comme j’étais encore toute seule, je me suis dit: C’est un signe! Quelqu’un de ceux qui m’ont voulu du bien pendant leur vie s’est relevé de dessous terre, afin de m’avertir que la mort préparait une place près de lui; pour sûr, un chrétien va mourir dans la maison!
A ces mots, les larmes de Jeanne redoublèrent. J’éprouvais un véritable embarras. Les raisonnements ne pouvaient avoir aucune prise sur cette âme crédule et ébranlée. A la première expression de doute, elle répéta tous les détails de son récit avec une précision qui témoignait de la vivacité du souvenir. Les pas et les soupirs avaient semblé retentir près de la fenêtre placée au-dessus du berceau, tandis que son nom avait été prononcé à l’autre extrémité du logis. Son regard et sa main venaient même de désigner une porte ouverte, conduisant au courtil, quand, tout-à-coup, elle tressaillit, la parole s’arrêta sur ses lèvres, son œil resta fixe, et elle continuait à me montrer la porte avec un geste épouvanté. J’avançai la tête: à quelques pas du seuil et dans la demi-lueur de la nuit, une forme singulière se tenait immobile: on eût dit la silhouette confuse d’un être humain de très petite taille, appuyé sur un long bâton, le visage caché par un chapeau à larges bords.
—C’est lui! bégaya Jeanne, c’est le kourigan!
Je ne pris point le temps de lui répondre. Je m’étais glissé avec précaution le long de la muraille, et gagnant la porte, je m’élançai brusquement dans le courtil; mais quelque prompt qu’eût été mon mouvement, l’ombre avait déjà gagné l’autre bout de l’enclos, et je la vis s’échapper par une ouverture de la haie.
Je cherchais à m’expliquer cette singulière vision, quand je fus interrompu par Pierre-Louis, qui rentrait chez lui en chantant. Le saulnier paraissait avoir singulièrement fêté le condor, et les avertissements de Jeanne ne purent le décider à baisser la voix. Il était dans cette première extase de l’ivresse qui commence, alors que tout se teint aux yeux du buveur de la riche et joyeuse couleur du vin. Il ne vit ni les traits altérés de l’enfant, ni les pleurs de la mère: celle-ci voulut en vain lui communiquer ses inquiétudes, il lui frappa dans la main en riant et essaya de l’embrasser.
—Allons, Bellotte, n’aie donc pas de chagrin! s’écria-t-il gaiement, le petit Pierre guérira.... ne crains rien.... ça ira!... Je voudrais seulement des sacs.... Où sont les sacs, dis?
Jeanne montra silencieusement un coffre, le saulnier y prit ce qu’il cherchait.
—Voilà la chose, continua-t-il en se parlant à lui-même selon l’habitude des gens ivres; ça sera autant de profits pour réparer les pertes... Sois tranquille, va, nous achéterons des remèdes à l’enfant, et il faudra bien qu’il guérisse.
Il roulait les sacs et se riait à lui-même, tout en parlant; Jeanne, penchée vers le petit Pierre, ne semblait point l’entendre; il se rapprocha du berceau.
—A tout-à-l’heure, fiot, reprit-il, ne t’impatiente pas; je vais avec les autres.
—Où cela? demandai-je.
—Nulle part..... répliqua-t-il d’un air narquois; histoire de rire, voyez-vous. Les gars ont eu une idée.... Ils ont noyé le gabelou!
—Dans son verre, s’entend! reprit Pierre-Louis en riant; pour le quart-d’heure, il ne peut reconnaître sa main droite de sa main gauche...... Une bonne malice, oui... et qui pourra rapporter....
—Quoi donc?
—Rien, c’est une manière de dire.... Mais pardon... Monsieur veut-il sortir ou rester?
Il avait ouvert la porte; je pris congé de Jeanne, et je sortis avec le saulnier. Il continua sa conversation incohérente jusqu’au détour de la rue, où nous rencontrâmes les autres buveurs en compagnie du Parisien. A la vue de ce dernier, je dus reconnaître que Pierre-Louis n’avait rien exagéré. Bien que soutenu des deux côtés, le douanier décrivait, dans la rue, les plus capricieux méandres, et chantait d’une voix chevrotante des romances populaires dont il mêlait les paroles et les airs. Il me parut, au reste, que ses compagnons, tout en excitant sa gaieté bachique, en riaient sournoisement. Dès que Pierre-Louis les eut rejoint, ils échangèrent un signe et cessèrent de retenir le Parisien, qui faisait de visibles efforts pour les quitter.
—Eh bien! c’est dit, laissez le gabelou aller à sa panthière, s’écrièrent en même temps plusieurs saulniers.
—C’est ça, reprit le douanier, qui, abandonné par ses conducteurs tourna trois fois sur lui-même avant de retrouver son équilibre; le service avant tout! Au revoir, et, quand vous voudrez encore lutter de soif, cherchez-moi des gosiers plus salés que les vôtres. Hop! en route les sentinelles perdues! Si Monsieur me passait son bras, sans le commander....
Et, avant que j’eusse répondu, il m’avait pris pour point d’appui et m’entraînait vers l’extrémité du bourg. Comme c’était mon chemin, je le laissai faire, heureux, grâce à l’obscurité, de n’être pas vu en pareille compagnie. Le Parisien marcha pendant quelques minutes en trébuchant et en continuant à chanter d’une voix avinée; mais, dès que nous eûmes tourné la rue, il se redressa, s’affermit sur ses pieds et quitta mon bras.
—Que Monsieur m’excuse, dit-il de sa voix ordinaire, les malins ne sont plus là, on peut reprendre son aplomb.
Et il se mit à marcher près de moi d’un pas délibéré. Je le regardai stupéfait.
—Ce n’est rien, dit-il en riant; il fallait bien prouver ce qu’on sait à ce tas de paysans. Ils ont voulu me faire voir trouble parce qu’on leur a dit que j’étais de panthière cette nuit; à farceur farceur ennemi, comme dit le proverbe. Ils croient m’avoir endormi, mais j’aurai l’œil ouvert, et gare aux fraudeurs!
—Soupçonnez-vous donc quelque projet! demandai-je.
Il regarda autour de lui, et clignant de l’œil:
—M’est avis que le condor avait goût de faux-sel, dit-il plus bas; les drôles ont espéré se régaler en me faisant payer la consommation; mais le Parisien n’aime pas qu’on le mystifie, c’est antipathique à son tempérament. Aussi tant pis pour ceux qui voudront rire; si on entre en danse, je me charge de la musique.
A ces mots, le gabelou éclata de rire, battit un entrechat des plus hasardés; et, après avoir salué, avec une recherche grotesque, prit en courant le chemin qui conduisait aux salines.
Je demeurai un instant à la même place, incertain sur ce que je devais faire. Les mots échappés à Pierre-Louis confirmaient pour moi les soupçons du Parisien; il y avait véritablement lieu de craindre que la feinte ivresse de celui-ci n’enharît le saulnier et ses compagnons à quelque tentative dont ils pouvaient avoir à se repentir. Je redoutais l’imprudence ordinaire du mari de Jeanne et j’aurais voulu l’arrêter par un avertissement; mais où se trouvait-il à cette heure, et comment lui parler! Après beaucoup d’hésitations, je me décidai à rebrousser chemin jusque chez lui, espérant qu’un hasard aurait pu le ramener à sa demeure, ou que Jeanne du moins saurait le rencontrer; mais la nuit devenait plus sombre, je me trompai de route, et j’arrivai à la maison du saulnier par la ruelle champêtre sur laquelle s’ouvrait le courtil. Ne voulant point revenir en arrière, je poussai la petite barrière à claire-voie qui lui servait de porte, et j’entrai.
Au moment où j’allais prendre la courte allée conduisant au logis, une ombre se détacha de l’obscurité que projetait l’édifice, et traversa lentement l’espace lumineux qui m’en séparait. Sa petite taille, son large chapeau, sa démarche inégale, ne pouvaient me laisser aucun doute; c’était bien celle qui m’avait échappé quelques instants auparavant et dans laquelle Jeanne avait cru reconnaître le kourigan! L’occasion était trop favorable pour n’en point profiter. Je tournai l’allée, j’enjambai une plate-bande, et nous nous trouvâmes face à face.
A mon aspect, le prétendu lutin poussa un cri et voulut fuir; mais je le saisis par les épaules: son chapeau tomba dans l’effort qu’il fit pour m’échapper, et la faible clarté des étoiles montra le visage effrayé d’un jeune paysan chétif et contrefait. Je le secouai assez rudement en lui demandant à haute voix ce qu’il faisait là. Il m’imposa silence du geste et m’attira à l’écart. Je ne comprenais pas plus ces précautions que sa présence dans le courtil à une pareille heure, et je le sommai une seconde fois de s’expliquer. Au lieu de répondre, il s’appuya au talus qui servait de clôture, tourna les yeux vers la maison où brillait une lumière, et se mit à soupirer.
—Vous êtes là depuis le coucher du soleil? repris-je étonné de ce silence; c’est vous qui avez prononcé le nom de Jeanne?
—M’a-t-elle entendu? demanda-t-il avec une émotion naïve.
—Oui, vous l’avez effrayée; que cherchez-vous ici?
—Rien.
—Pourquoi venir alors, et qui êtes-vous?
Il jeta sur moi un regard distrait.
—On m’appelle Gratien, dit-il lentement.
—L’enfant de l’hospice de Savenay! m’écriai-je, le compagnon de Jeanne, celui dont parlait hier le vieux Michel.
Il fit de la tête un signe affirmatif.
—Alors c’est vous que la saulnière a vu l’autre soir chez son parrain, repris-je; c’est vous qui, à d’Escoublac, avez écrit son nom sur le sable, où votre pied nu et contrefait avait laissé son empreinte: ce n’est pas la première fois que vous la suivez ainsi en vous cachant. Pourquoi cela? répondez; que lui voulez-vous?
Il resta muet.
—Je vous le dirai bien, moi, continuai-je en le regardant fixement; vous cherchez la belle saulnière, parce que vous êtes amoureux d’elle!
Il se redressa tout effaré et essaya de fuir. Je le retins à grand’peine. Il fallut lui répéter que je ne l’avais dit à personne, que Jeanne ne soupçonnait rien, et qu’elle l’avait pris pour le kourigan. Je lui tenais les mains en m’efforçant de le rassurer; il céda enfin, baissa la tête, et je l’entendis qui pleurait. Mais presqu’aussitôt ses larmes s’arrêtèrent, il voulut m’échapper de nouveau. Je tâchai en vain de lui donner confiance par des paroles de sympathie et d’encouragement; il me répondit des discours sans suite, entremêlant ses divagations de malédictions, d’éclats de rire, de sanglots. Son égarement avait quelque chose qui attirait et repoussait tour à tour. Parfois c’étaient d’inintelligibles explications, dans lesquelles la folie essayait le mensonge, parfois de rapides confidences où le cœur se racontait sans le savoir. La ruse du paysan et l’ingénuité de l’enfant luttaient dans ce cerveau malade, et se trahissaient successivement par des traits ridicules ou charmants. Il parlait d’affaires de sel qui l’avaient conduit à Saillé; il nommait les gens auxquels il avait acheté, les barges qu’il devait charger; puis, il joignait les mains au-dessus de sa tête et criait qu’il allait partir pour La Meilleraie, où il voulait se faire trappiste et mourir.
Je contemplais ce misérable abandonné, à qui Dieu avait d’abord refusé la grâce, et que les hommes avaient ensuite déshérité de l’amour. Fallait il plaindre ou bénir son égarement? Quelque pénible que fût le rêve agité dont il était poursuivi, avait-il mieux à attendre de la réalité? La vie ne lui était-elle pas fermée dans tout ce qu’elle avait d’espaces éclairés et fleuris? Son mal, du moins, lui créait un monde où passaient parfois quelques mirages. La folie seule pouvait lui permettre de prendre patience.
Voyant que l’interrogation directe ne réussissait qu’à l’effaroucher, je feignis de me laisser aller au courant de ses digressions; je répondis à tout avec un air de confiance qui le rassura. Ce qu’il y avait de volontaire dans sa divagation disparut insensiblement et le laissa à la sincérité de son égarement. Il me raconta alors, en phrases sans suite, ses absences des Bryères et ses retours, sa vie errante dans les cantons autrefois parcourus avec Jeanne, ses visites secrètes aux lieux qu’elle habitait, ses mille ruses pour la voir et la suivre sans être aperçu. Tout cela était dit avec une loquacité vagabonde qui donnait plutôt l’idée d’une infirmité de l’esprit que d’une souffrance du cœur. La passion était ici dépouillée de son poétique cortége de réserve et d’exaltation; la mélancolie sans grâce ne paraissait plus qu’une maladive tristesse. A peine si, de loin en loin, un frisson de fièvre, un cri douloureux traversait les triviales confidences du boiteux. Comme les plantes délicates qu’un germe égaré a fait croître sur le chaume d’une étable, l’amour, dépaysé dans cette âme, ne pouvait ni trouver sa place, ni exhaler son parfum; la fleur rare s’était épanouie hors du vase précieux qui la réclamait.
J’écoutais ces récits entrecoupés avec un intérêt combattu, quand un coup de feu retentit dans l’éloignement; je redressai la tête: un second coup se fit entendre et cette fois il me sembla suivi d’une vague rumeur. Je posai la main sur le bras de Gratien pour lui imposer silence; mais il n’avait rien remarqué. Je restai un instant partagé entre ses confidences diffuses et je ne sais quelle préoccupation inquiète. Il me semblait que la rumeur se rapprochait; bientôt il n’y eut plus de doute, des cris perçaient la nuit; j’entendis les portes des maisons s’ouvrir; les voix devenaient plus nombreuses; des pas précipités se dirigeaient de notre côté; le nom de Pierre-Louis frappa mon oreille mêlé à des exclamations et à des clameurs. Un pressentiment funeste me saisit; je laissai là Gratien, je courus vers la maison: au moment où je poussais la porte qui donnait sur le jardin, celle de la rue s’ouvrit, et deux hommes entrèrent portant dans leurs bras le saulnier couvert de sang.
Pierre-Louis et ses compagnons avaient compté sur l’ivresse du Parisien pour tenter, près de sa panthière, un enlèvement de faux sel, et la balle du douanier venait de frapper mortellement le saulnier. Jeanne, occupée de son enfant, n’avait rien soupçonné, rien entendu; au moment où les pas retentirent sur le seuil, elle retourna la tête, et son premier regard rencontra le cadavre!
On n’essaie point de peindre de pareilles scènes. En reconnaissant le mort, la saulnière s’était élancée vers lui, les voisins accourus l’entouraient, parlaient tous à la fois. Pendant quelque temps, ce fut un chaos de plaintes, de consolations, au milieu duquel la voix de la veuve restait étouffée. Je m’approchai enfin du groupe bruyant, et je pus apercevoir Jeanne, qui semblait étrangère à tout ce qui l’entourait. A genoux près du mort, elle essuyait avec son tablier le sang qui coulait de sa blessure, elle l’embrassait et l’appelait comme s’il eût pu lui répondre. On eût dit que foudroyée par ce coup imprévu, elle ne le sentait pas encore complétement; mais peu à peu l’inutilité de ses appels et de ses embrassements parut l’épouvanter: elle se redressa d’un air égaré, et nous tendit ses mains couvertes de sang.
—Il n’est pas mort? demandait-elle en nous regardant l’un après l’autre; il ne peut pas être mort! Le médecin vous le dira; où est le médecin?
Quelqu’un répondit qu’on l’avait envoyé chercher. Je m’approchai alors pour l’encourager, et je voulus l’entraîner doucement loin du cadavre; mais elle s’y rattacha des deux mains, comme si mon effort lui eût tout révélé, et sa douleur fit explosion. Assise à terre, elle avait ramené la tête de Pierre-Louis sur ses genoux, elle le regardait avec des sanglots et des cris si éperdus, que les plus endurcis en étaient remués jusqu’aux entrailles.
Nous avions tous reculé involontairement, et personne ne trouvait de paroles pour un tel désespoir, qui, loin de s’affaiblir, semblait trouver de nouvelles forces dans son expansion. L’accent de Jeanne devenait plus rauque, ses yeux étaient plus hagards; tous ses mouvements prenaient je ne sais quoi de sauvage, et ses sanglots étaient entrecoupés par un rire nerveux qui donnait froid au cœur. Évidemment le coup avait été trop violent et trop inattendu; cet esprit, déjà ébranlé, errait sur la pente de la folie. Je me joignis en vain à ses parents et à ses amis pour la rappeler à elle-même; nos voix ne lui arrivaient plus. Accroupie près du mort, l’œil grand ouvert et les lèvres agitées d’un frisson convulsif, elle murmurait des mots insensés qui ne s’adressaient à personne. Nous nous regardions consternés. Un grand silence s’était fait autour d’elle; il fut subitement interrompu par un cri faible et plaintif: c’était l’enfant qui sortait de sa torpeur et appelait sa mère!
Cette voix frêle traversa la douleur de Jeanne; elle arrêta sa raison fuyante. La saulnière s’était retournée d’un brusque mouvement; le petit Pierre, redressé, apparaissait au-dessus de son berceau, et une de ses mains tendues semblaient implorer. La mère courut à l’enfant, et l’enveloppa dans ses bras avec un cri qui partait tellement des profondeurs de l’âme que tous les yeux se mouillèrent.
Le médecin entrait. On l’entoura et on le conduisit vers Pierre-Louis, qui avait été porté sur son lit. Il appuya sa main contre le cœur du saulnier, plaça un miroir devant ses lèvres, secoua la tête, et, sans rien dire, ramena la couverture sur son visage. Jeanne chancela, elle avait compris; mais l’enfant l’appelait de nouveau. Le médecin vint à lui, se pencha sur le berceau, et, après avoir attentivement examiné les résultats de la crise, déclara qu’il était sauvé. La saulnière ne put retenir une exclamation de joie; ses yeux, secs jusqu’alors, laissèrent jaillir un flot de larmes; elle tomba à genoux en joignant les mains; la reconnaissance de la mère avait amorti le désespoir de la veuve.
Le surlendemain, je me joignis au convoi funèbre qui conduisit le mort au cimetière. Les hommes marchaient les premiers, portant le petit manteau par dessus l’habit de toile blanche destiné au travail; les femmes venaient ensuite, vêtues de leurs camails de deuil formé d’une sombre toison; enfin, derrière elles, j’aperçus Gratien, qui suivait seul, dans son triste costume des Bryères, la tête basse et le visage voilé de ses longs cheveux. Il s’arrêta à l’entrée du cimetière, s’agenouilla sur les cailloux du chemin, et, la fosse une fois refermée, disparut derrière l’église. J’allai ensuite voir Jeanne, que je trouvai pleurant, la tête appuyée sur le petit oreiller de son enfant, qui recommençait à lui sourire et jouait avec ses larmes.
Plusieurs semaines se passèrent en excursions sur le continent et dans les îles. Je parcourus toutes les sinuosités de ces rivages, autrefois fréquentés par les vaisseaux de Carthage, et où vivait, au dire de Strabon, sur un territoire où aucun homme n’avait accès, un peuple de femmes Amnites livrées au culte de Bacchus. A mon retour de cette curieuse pérégrination, j’appris que le petit Pierre était complétement rétabli, et que Jeanne retournait habiter aux Bryères chez son parrain. Je remis au lendemain la visite d’adieu que je voulais lui faire; mais comme nous sortions pour une promenade aux étiers, mon hôte me montra la saulnière qui suivait la route de Montoir. Elle était en grand habit de deuil, assise sur la mule que je connaissais, son fils placé devant elle. Gratien tenait la bride et la conduisait. Il me sembla voir le fantôme grimaçant de sa jeunesse reconduisant Jeanne au triste lieu qu’elle avait quitté escortée de toutes les espérances de l’amour, et où elle revenait avec les souvenirs d’un bonheur détruit. Je la suivis longtemps de l’œil sur la route poudreuse. Le ciel avait un éclat monotone plus triste que les nuées, et, tandis que la veuve cheminait lentement, portant dans ses bras l’enfant orphelin, une voix de jeune fille murmurait le long des bossis la chanson du mariage, et le vent de mer apportait de loin la rumeur du flot comme un vague gémissement.
Une tradition arabe, transmise par les pâtres ou les contrebandiers, a franchi les Pyrénées et s’est conservée dans les pays basques. Les bergers qui conduisent leurs troupeaux le long des gaves de la montagne racontent encore aujourd’hui que, bien avant Jules César, il existait un bronche ou sorcier, qui s’éleva dans les airs sur un dragon qu’il avait soumis, et arriva ainsi au rocher où dormait Debrua, l’esprit du mal. Il l’entoura neuf fois d’une chaîne magique, et l’obligea à lui faire connaître le roi des talismans, qui donne plaisirs, richesse et puissance. Debrua déclara au sorcier que, pour tout obtenir sur terre, il fallait se rendre maître de la mouche jaune de safran, laquelle se montrait tous les soirs dans un port (passage) des Pyrénées qu’il nomma; il l’avertit seulement que, pour la prendre, il fallait tresser une résille avec les trois cheveux les plus près du cerveau et tremper cette résille dans la sueur et dans le sang. Le bronche fit ce qui lui avait été recommandé, et ne tarda pas à voir paraître la mouche jaune de safran. Il la poursuivit sept jours et sept nuits à travers les rocs, les halliers et les torrents, leur laissant autant de lambeaux de ses habits et de sa chair que les brebis, avant la tonte, laissent de flocons de laine aux buissons; enfin, il la vit se poser sur la cabane d’un berger qui était monté dans les pâturages. Il essaya en vain de parvenir jusqu’à elle; tous ses efforts ne purent décider la mouche à reprendre son vol. N’ayant donc plus d’autre ressource et s’étant assuré que personne ne pouvait le voir, il mit le feu à la cabane, et la mouche jaune de safran s’envola. Le bronche la suivit jusqu’à une prairie, où elle alla se poser sur une touffe de fenouil. Comme il ne pouvait s’approcher d’une plante qui fait la guerre aux sorciers, il resta à quelque distance. Alors un jeune berger, qui gardait des chevaux dans la pâture, aperçut la mouche et la prit dans son bonnet. Le bronche, hors de lui, poursuivit l’enfant, le frappa de son bâton et le tua; mais, au moment où il saisissait la mouche jaune de safran, elle lui fit une piqûre qui le rendit triste pour le reste de ses jours. Devenu plus riche que les labinas (fées) des gaves, il tomba dans la même langueur que ceux qui ont été recommandés par leurs ennemis à saint Sequayre[16]; et il mourut lentement comme si l’on eût coupé la mère racine de son cœur.
Les bergers basques ne disent pas ce qu’est devenue, depuis cette époque, la mouche jaune de safran; mais nous la retrouvons partout dans l’histoire du monde. N’est-ce pas elle que cherchaient les millions de combattants qui se précipitèrent sur la société antique, comme une avalanche d’hommes détachés du nord? N’est-ce pas elle encore que croyaient atteindre les hardis compagnons de Pizarre, de Sotto et de Cortez, lorsqu’ils s’enfonçaient au galop de leurs chevaux, dans des régions ignorées où ils fauchaient les nations comme des blés mûrs; elle que voyaient sur la mer nos fabuleux flibustiers dont les blessures et la mort étaient officiellement cotées à cette bourse sanglante de la guerre? N’est-ce pas elle enfin que poursuivent, de nos jours, les pionniers de la Californie et tous les chercheurs de trésors, depuis les orpailleurs du Mexique et les monney-diggers des Bahama jusqu’aux fouilleurs de ruines de nos campagnes? La mouche magique des traditions pyrénéennes n’a point cessé un seul instant et ne cessera jamais d’attirer ici-bas tout ce qu’il y a de sensualités avides, de vagabondes témérités. Quiconque sent en lui la puissante impulsion des désirs inassouvis la cherche des yeux, la poursuit, comme le bronche, à travers les précipices, s’efforce de la saisir dans quelque piége pour lequel il a épuisé son cerveau, sa sueur et son sang, brûle pour l’atteindre la chaumière de l’absent, brise l’existence de l’abandonné, et périt misérablement au milieu de son triomphe, consumé par l’inguérissable fièvre de la satiété.
Et que l’on ne croie pas cette avidité particulière à certains temps ou à certaines races: nous la retrouvons toujours et partout. Si les païens ont la conquête de la toison d’or et du pommier des Hespérides, les hommes du Nord la découverte du sampo, talisman souverain qui procurait toutes les richesses, l’Orient ses anneaux magiques et ses lampes d’Aladin, les chrétiens ont eu la recherche du saint Graal, ce vase divin que le sang du Christ avait rendu fée, et qui assurait à son possesseur l’accomplissement de tous ses désirs. La science elle-même a entendu, dans ses retraites austères, les bourdonnements de la mouche jaune de safran, et elle s’est oubliée, pendant plusieurs siècles, à la recherche du grand œuvre. Aussi loin que la tradition peut remonter enfin, nous trouvons cette soif de la richesse comme une maladie générale, héréditaire; et, c’est à elle qu’il faut attribuer la croyance populaire aux talismans et aux trésors.
Je faisais ces réflexions, tout en suivant la route de Mamers au Mans et me dirigeant vers le bourg de Saint-Cosme. Une butte située près de ce bourg et connue dans l’histoire sous le nom de motte d’Ygé, avait été signalée depuis longtemps dans le pays comme renfermant d’immenses richesses. Les Anglais y avaient bâti, au XIIe siècle, une forteresse où ils avaient tenu garnison jusqu’au traité de Bretigny. Forcés alors de repartir, ils avaient enfoui, dit-on, dans la colline les trésors dont ils n’osaient se charger et qu’ils espéraient reprendre à la prochaine guerre. Cette tradition avait provoqué à plusieurs reprises des recherches dans la motte d’Ygé, devenue mont Jallu. De nouvelles fouilles annoncées par les journaux en 1844 avaient éveillé ma curiosité, et j’étais parti avec le projet de voir une de ces chasses aux trésors. J’avais heureusement dans le Maine, pour me guider et m’instruire, un ami de nos plus charmants écrivains, esprit choisi, mais nonchalant, qui, afin d’éviter la fatigue de se conquérir un nom, avait pris d’avance ses invalides dans une étude d’avoué. Il y suicidait tout doucement sa belle intelligence, sans autre distraction qu’un commerce de lettres assez suivi avec d’anciens compagnons qui riaient, comme lui, tout haut de la vie et s’en attristaient tout bas. Nous partîmes ensemble pour cette Californie du mont Jallu dont il me fit l’historique en chemin.
Le premier indice du dépôt précieux avait été une plaque de cuivre trouvée à la tour de Londres, et sur laquelle se lisaient ces mots: Thesaurus est in monte salutis prope Comum. On en eut sans doute connaissance sous Louis XIII, car le régiment du Maine fut alors employé à fouiller le mont Jallu. En 1755, M. le duc de Chevreuse autorisa de nouvelles recherches aussi infructueuses que les précédentes. Après ces deux échecs, il y eut un long répit. Un parchemin trouvé à Paris en 1825, dans les démolitions d’une vieille église, ramena l’attention sur l’ancienne motte d’Ygé. Il se forma une société par actions qui recommença à bouleverser la fallacieuse montagne et y engloutit son capital. Vers la même époque, les Anglais, qui avaient déjà réclamé au XVIIIe siècle le droit d’y faire des perquisitions, renouvelèrent leur demande par l’entremise de M. de Talleyrand, et adressèrent une pétition à la chambre des députés, qui passa à l’ordre du jour. Enfin le père d’une de nos comédiennes les plus connues, M. Fay, subitement éclairé par les révélations d’une femme de chambre somnambule, acheta du propriétaire le droit de recommencer les fouilles. Les indications du sujet magnétisé étaient si précises, que les recherches eurent cette fois un résultat. Après des travaux qui lui coûtèrent une douzaine de mille francs, M. Fay découvrit cinq deniers et trois clous! Plusieurs dames reprirent après lui son entreprise, et, parmi elles, une parente du plus fécond de nos romanciers, qui espérait retrouver au mont Jallu le trésor du père Grandet. Vinrent ensuite le général polonais Milkieski, Mesdames Herpin, Hersant, et une nouvelle compagnie d’actionnaires. C’était cette dernière qui bouleversait en 1844 le mont Jallu. Comme tous les chercheurs précédents, les nouveaux actionnaires avaient à leurs gages un magnétiseur et son sujet, dont les révélations servaient à diriger les fouilles des ouvriers.
Nous étions arrivés au bas d’une côte où il fallut descendre de nos montures. Les derniers jours de novembre ont une beauté qui leur est propre; ce n’est plus l’énervante mollesse de l’automne, et ce n’est pas encore la rudesse de l’hiver. Nous jetâmes la bride sur le cou de nos chevaux, et, les laissant aller, nous nous mîmes à gravir la montée en causant. Comme nous arrivions à mi-côte, nous aperçûmes un paysan endormi sur le revers de la douve. La réserve de son attitude et le bon ordre de son costume ne permettaient point d’attribuer ce sommeil à l’ivresse. Il était assis plutôt qu’étendu, la tête un peu renversée et appuyée sur un de ses bras. Son chapeau, rabattu sur les yeux, le mettait à l’abri du soleil. Il tenait de la main droite, en guise de bâton, une petite pelle de taupier. Mon compagnon reconnut le dormeur et s’arrêta.
—Vous voyez là, me dit-il en baissant la voix, une des variétés les plus curieuses de nos campagnards. Jean-Marie tient le milieu entre le mire (médecin) et le sorcier; il a des secrets et vend des talismans. On se sert de lui pour guérir certaines maladies, chasser les animaux nuisibles, découvrir les sources. On dit qu’il apprend aux jeunes filles des formules pour attirer les amoureux, et les crédules assurent même qu’il possède l’herbe magique avec laquelle on se transporte partout en désir de femme, c’est-à-dire plus vite que la pensée. Jean-Marie, certain, que le monde vous estime toujours en proportion du pouvoir qu’il vous suppose, n’a garde de les détromper. Aussi est-il consulté par tous nos fermiers, et achète-il, chaque année, quelque lopin de terre avec leur argent. Il se rend aujourd’hui chez des pratiques, car voici près de lui sa trousse à talismans.
J’aperçus, en effet, sur les genoux de maître Jean un carnier doublé de cuir, qu’il fouillait sans doute lorsque le sommeil l’avait surpris, et qui était resté entr’ouvert. Nous pûmes faire, du regard, l’inventaire de ce qu’il renfermait. Mon compagnon me montra la baguette de coudrier pour découvrir les sources, des fragments d’aérolithes qui devaient garantir du tonnerre, une noix percée servant de cage à une araignée vivante et destinée à guérir de la fièvre, un couteau de langueyeur portant sur la lame le nom cabalistique de Raphaël. Il m’expliquait comment ce dernier nom, que les paysans du midi faisaient graver sur le soc des charrues afin de rendre les sillons fertiles, avait, dans le Maine, la propriété de guérir les porcs ladres et de les engraisser, lorsque Jean-Marie se réveilla. Bien qu’il parût d’abord surpris de nous voir et même un peu embarrassé, il fit assez bonne contenance et se redressa en nous saluant. C’était un homme encore jeune, dont le visage avait cette expression de jovialité matoise habituelle aux Normands, mais plus rare chez les paysans manceaux. L’avoué lui demanda depuis quand les chrétiens dormaient ainsi au soleil, le long des berges, comme des lézards.
—Depuis qu’ils ne trouvent pas de lits de plumes sur la grande route, répliqua le taupier.
—Maître Jean oublie que la grande route est la chambre à coucher des vagabonds.
—Monsieur l’avoué voit bien, au contraire, que c’est le rendez-vous des honnêtes gens, puisque c’est là que je le rencontre.
—Tu es, à ce que je vois, en chemin pour affaires.
—Et le bourgeois est à la cueillette des procès? dit Jean-Marie, qui retourna la question, au lieu d’y répondre.
—Pourquoi non? reprit gaiement l’avoué; ne connais-tu point le proverbe:
Nous allons voir s’il ne se prépare point quelque grabuge du côté de la Motte-Robert; mais toi, bon apôtre, où vas-tu?
—A la ferme du gros François.
—Vers Saint-Cosme?
—A peu près.
—Alors nous pouvons faire route ensemble.
—Si monsieur l’avoué trouve que je ne lui fais pas affront.
Jean-Marie s’était levé et se préparait à nous suivre. Je m’aperçus alors qu’il avait laissé tomber un petit sachet rempli de blé, que je lui rendis. Il le glissa au fond de son carnier, et nous dit que c’était un échantillon de froment pour le gros François.
—Ne serait-ce pas plutôt le grain qui sert à composer les mercuriales d’avenir? demanda l’avoué en le regardant.
Le marchand de talismans sourit sans répondre.
—Vous saurez que c’est un des mille talents de maître Jean, continua mon compagnon; il excelle à deviner ce que sera le prix du blé en consultant les grains de froment. J’ai été moi-même témoin, par hasard, de la confection d’une de ces mercuriale anticipées. On range, pour cela, sur la pierre du foyer, et devant un grand feu, douze grains de blé choisis par un homme qui a reçu le don, comme maître Jean. Ces grains représentent les douze mois de l’année, en commençant par celui de gauche, qui représente janvier. Lorsque le feu les a échauffés, les grains éclatent et sautent en avant ou en arrière. Dans le premier cas le prix du blé doit infailliblement s’élever, dans le second, il doit descendre.
Je fus frappé de ce mode d’augure, où la divination par le feu rappelait clairement l’ancien culte des éléments et dénonçait l’origine celtique. L’avoué, à qui je communiquai mon impression, se retourna vers le taupier.
—Vous voyez, maître Jean? dit-il. Votre cérémonie sent le païen, et a dû être inventée par les druides.
—Possible, dit tranquillement le paysan, la sapience est le lot des vieux.
—Et du malin. Prenez-y garde, maître Jean; c’est, dit-on, un terrible taupier de chrétiens!
Jean-Marie haussa les épaule, et, prenant un air de tolérance philosophique:
—Bah! dit-il en riant, ce sont les mal rentés en esprit qui lui en veulent d’être trop dégotté[17]. Le diable est comme les pauvres gens; chacun aboie après lui pour faire le bon chien.
Ce n’était pas la première fois que je remarquais dans nos campagnes l’expression de cette étrange sympathie pour l’ange tombé. Que ce soit facilité d’oubli ou naïveté de miséricorde, le peuple a, de tout temps, montré de la tendance à plaindre le coupable qu’il voit atteint par le châtiment. Il semble qu’à ses yeux la souffrance purifie tout, jusqu’à Satan.
Nous marchâmes ainsi assez longtemps agréablement distraits par la causerie du paysan jusqu’au moment où il nous montra, à la gauche du chemin, un amoncellement de terres bouleversées: c’était le mont Jallu.
Lorsque nous y arrivâmes, les ouvriers travaillaient aux fouilles sous la direction d’un contre-maître; mais le magnétiseur et son sujet étaient absents. L’ancienne motte d’Ygé avait été découpée par de profondes tranchées, dont les déblais étaient rejetés à droite et à gauche, et percée de puits destinés à l’épuisement des eaux; elle semblait avoir littéralement changé de place. La foi, comme le dit mon compagnon, avait transporté la montagne. Ces tas de terre jaunâtre et stérile, sur lesquels s’agitaient des travailleurs empressés, offraient un singulier spectacle au milieu des champs fertiles et alors déserts, où la nature préparait en silence ses riches moissons. C’était là comme dans la vie: l’homme abandonnait les biens réels pour courir après des songes.
Nous interrogeâmes vainement le contre-maître sur la direction des travaux et sur les espérances des nouveaux chercheurs de trésors; soit ignorance, soit discrétion, il ne sut rien nous apprendre. Maître Jean nous conseilla de continuer jusqu’à l’auberge de Saint-Cosme, quartier-général des entrepreneurs, où l’on pourrait, selon toute apparence, nous renseigner plus exactement. Nous nous décidâmes à y aller dîner, et, après avoir pris congé du taupier, qui devait quitter là le grand chemin pour s’engager dans la traverse, nous nous remîmes en selle et nous gagnâmes le bourg au galop.
L’arrivée de deux voyageurs bourgeois eût produit dans beaucoup de villages une certaine sensation; mais les habitants de Saint-Cosme étaient blasés sur de pareils événements. Le bruit de nos chevaux n’attira même pas l’aubergiste sur le seuil; il fallut l’appeler. Il vint recevoir la bride de nos montures avec une dignité indifférente. Mon compagnon, qui voulait nous relever dans son opinion, passa à la cuisine, et fit main basse sur tout ce qu’il y avait de présentable dans le garde-manger. L’effet de réaction ne se fit pas attendre. L’hôte, convaincu que des gens qui dînent si bien devaient avoir droit à ses respects, mit le bonnet à la main et nous fit entrer dans un salon où le couvert était mis. Comme les préparatifs culinaires demandaient un peu de temps, il voulut bien, pour adoucir les ennuis de l’attente, nous accorder les agréments de sa conversation. Nous apprîmes par lui que les directeurs des fouilles du mont Jallu devaient arriver dans quelques jours. Il ajouta que, par malheur, il n’y avait point de dames, partant pas de bals, de collations ni de cavalcades. L’aubergiste de St-Cosme ne pouvait perdre le souvenir des fêtes données par les entrepreneuses précédentes, dont il nous parla avec des élans d’admiration et des soupirs de regret. J’en vins à demander quels avaient été les résultats des premières fouilles? Le flot de paroles s’arrêta, et, comme le contre-maître du mont Jallu, notre hôte s’enveloppa dans une prudente discrétion. Je voulus plaisanter les folles espérances des chercheurs d’or; l’aubergiste prit aussitôt l’air d’une vieille prude devant qui on parle d’amour; j’insistai, il rompit l’entretien en prétextant quelques additions à faire au couvert. Je fis remarquer cette singulière réserve à mon compagnon.
—Vous la trouverez, me dit-il, chez tous les habitants du pays auxquels vous parlerez des trésors du mont Jallu. Ils connaissent trop bien les avantages d’une pareille croyance pour aider à l’ébranler. Personne ne tourne en ridicule la montagne qui l’enrichit. Ce qui est d’ailleurs une fiction pour les autres et pour eux une vérité. La motte d’Ygé contient réellement un talisman sans prix: c’est cette ombre de trésor qui attire ici les écus des spéculateurs crédules, comme la fameuse montagne d’aimant des Mille et une nuits attirait autrefois les vaisseaux. Tout compte fait, cette colline a déjà rapporté aux gens de Champaissant et de Saint-Cosme plus de deux cent mille francs. Le moyen de traiter légèrement une pareille voisine!
—Ses bienfaits sont encore peu apparents, repris je en m’accoudant à la fenêtre, qui était ouverte. Voyez ces ruelles fangeuses, ces maisons lézardées, ces pauvres enfants qui courent nus pieds sur les cailloux du chemin! Je ne connais rien de plus propre à faire mentir les idylles qu’un village de France. Pas d’arbres pour ombrager les seuils, pas une fleur pour égayer les fenêtres, aucun témoignage de cet amour de l’homme pour sa demeure, qui est le premier symptôme du bonheur domestique. Ici, la vie est une halte dans la misère et dans la laideur.
—C’est un côté de l’aspect, dit mon compagnon en riant; mais il y en a un autre comme pour toute chose. Vous connaissez le mot de Mme de Staël, qui entendait faire une remarque pleine de justesse: «Oh! que cela est vrai! s’écria-t-elle, cela est vrai..... comme le contraire!» Nos villages français sont inhabitables sans doute, mais en revanche ils sont presque toujours pittoresques. Si la civilisation y perd, le paysage y gagne, et je connais beaucoup d’artistes qui pensent encore que le monde a été fait surtout pour être peint. Otez-en les maisons croulantes, les rues en zig-zag et les enfants en haillons: ils crieront que l’art est perdu! A leur point de vue, cette place de village est une magnifique étude flamande, et ils donneraient tous les cottages de l’Angleterre pour le seul coin de grange où vous voyez ce chaudronnier ambulant.
Mon regard se tourna vers l’homme que l’avoué me désignait: il se tenait assis presque sous nos fenêtres, à l’entrée d’un appentis en ruine; ses outils étaient dispersés autour d’un grand bassin qu’il venait de réparer pour l’aubergiste, et il se préparait à dîner d’un morceau de pain noir et d’un oignon. Son costume était pauvre et usé; ses cheveux gris, coupés carrément au-dessus de ses sourcils noirs, descendaient des deux côtés d’un visage bistré auquel ils servaient de cadre. Maigre, agile et visiblement endurci par la pauvreté, le chaudronnier avait, dans toute sa personne, quelque chose d’âpre, de persistant qui appelait et retenait l’attention. Nous allions quitter la fenêtre après avoir observé pendant quelques instants son étrange figure, lorsque, tout à coup, nous le vîmes tressaillir, se relever d’un bond, courir vers une ruelle qui s’ouvrait à quelques pas et s’y élancer. Nous cherchâmes en vain des yeux ce qu’il avait pu apercevoir: la ruelle semblait silencieuse et déserte. Le chaudronnier en atteignit l’extrémité, regarda à droite et à gauche, monta sur le mur d’appui d’un petit jardin pour mieux voir, puis revint, d’un air pensif, s’asseoir sous le hangar où nous l’avions remarqué d’abord. En ce moment, l’aubergiste entra. Nous lui demandâmes quel était cet homme.
—Pardine! dit-il, après avoir jeté un regard vers l’appentis, il faudrait le demander au diable! Plusieurs fois j’ai voulu l’interroger; mais, quand on lui parle, c’est comme si on criait dans un puits: rien ne répond. Tout ce que je puis vous dire, c’est qu’on le nomme Claude et plus souvent le Rouleur, parce qu’il court toujours le pays. On est certain de le voir arriver ici toutes les fois qu’on fouille la butte; aussi le regarde-t-on comme un chercheur de trésors. Il paraît même que, l’an dernier, il s’est laissé payer à boire par les gars du Chêne-Vert, et, comme le cidre lui a desserré les dents, il leur a raconté des merveilles.
L’avoué et moi nous échangeâmes un coup-d’œil. La même idée nous était venue en même temps: il fallait faire parler Claude à tout prix. Nous sortîmes sous prétexte de visiter nos chevaux, et, après avoir traversé l’écurie, nous nous approchâmes sans affectation du chaudronnier. Plongé dans une sorte de rêverie chagrine, il ne s’aperçut point de notre approche. Mon compagnon le salua avec cette aisance joviale qui est le privilége de certains caractères; le Rouleur ne répondit point tout de suite, et quelques instants se passèrent avant que la question qui avait, comme un vain bruit, frappé son oreille, parût arriver jusqu’à son esprit: il se retourna alors et rendit le salut avec réserve.
—Eh bien! les affaires vont-elles, mon brave? demanda l’avoué; y a-t-il beaucoup de chaudrons percés dans le pays?
—Monsieur voit qu’il y en a assez pour faire vivre un homme, répondit froidement l’ouvrier.
—Parbleu! vous êtes le premier à qui j’entends faire un pareil aveu, reprit mon compagnon; d’habitude, les rouleurs crient toujours misère.
Claude garda le silence.
Je lui demandai s’il ne trouvait pas bien rude de vivre ainsi, toujours errant par les routes solitaires, subissant tous les caprices du ciel et changeant d’hôte chaque soir.
—Quand on n’a personne nulle part, on est chez soi partout, répondit-il.
—Ainsi vous voyagez toujours?
—Les pauvres gens sont obligés d’aller où il y a la pâture et le soleil.
—Mais quand vient la vieillesse ou la maladie?
—On fait comme le loup: on se couche dans un coin et on attend!
Les réponses de Claude avaient une brièveté pittoresque qui n’était point nouvelle pour moi; j’avais déjà remarqué cette poétique originalité de langage sur nos montagnes, sur nos dunes, dans nos forêts, en interrogeant les pâtres, les gardiens de signaux et les bûcherons. C’est un caractère commun à tous les hommes habitués à vivre dans la solitude, sans autres interlocuteurs qu’eux-mêmes. Il semble qu’alors leurs pensées, comme ces vagues recueillies dans les creux de nos rochers, se condensent lentement en cristaux. Leur parole, selon l’expression des matelots, apprend à naviguer au plus près, et non sans profit; car, si les frottements qui naissent des relations sociales aiguisent l’intelligence et lui arrachent de fréquentes étincelles, ils servent rarement à la rendre plus nette ou plus vigoureuse. Notre improvisation de toutes les heures sème les idées à peine écloses comme ces fleurs stériles que le vent secoue des pommiers, tandis que le silence laisse aux idées du solitaire le temps de s’épanouir sur chaque rameau de l’esprit, d’où elles ne se détachent que parfaites et comme un fruit mûr.
Claude semblait être un de ces parleurs discrets qui n’ouvrent la bouche que pour dire quelque chose, et, bien que son langage ne fût point dépourvu d’une certaine prétention sentencieuse, il avait éveillé assez vivement notre intérêt pour nous donner le désir de prolonger la conversation. L’avoué la soutint quelque temps avec sa verve ordinaire; mais le rouleur continua à répondre rigoureusement, sans fournir aucune occasion de la détourner vers le sujet dont nous désirions surtout l’entretenir. L’arrivée d’une voisine qui venait s’acquitter envers Claude et jeter quelques sous dans le chaudron posé près de lui offrit enfin à mon compagnon une transition inattendue.
—Si c’est là toute votre recette à Saint-Cosme, dit-il au rouleur, vous serez quelque temps avant de faire fortune, et votre chaudron ne vaut pas celui de la croix de la Barre.
Je demandai ce que c’était que cette croix.
—Encore une des cassettes du diable! répliqua-t-il; il paraît qu’en creusant sous le sol, au coup de minuit, on trouve une grande bassine pleine de pièces d’or; mais comme elle est attachée à la terre par des racines magiques, personne jusqu’ici n’a pu l’enlever. Le Rouleur doit en avoir entendu parler?
Celui-ci fit un signe affirmatif.
—C’est, du reste, la vieille histoire qui se raconte partout, continua mon guide. Si l’on en croit la tradition, nos mendiants meurent de faim sur des millions, et maître Claude a, sans doute, trouvé les mêmes croyances dans ses montagnes d’Auvergne.
—Je ne suis pas né en Auvergne, dit laconiquement le chaudronnier.
—Où donc alors? demandai-je.
—Dans le Berri.
L’avoué, qui avait longtemps habité cette province, fit un mouvement.
—Vous êtes Berrichon! s’écria-t-il; j’aurais dû le deviner à votre accent. Par ma fiou! mon poure home, topez-là; moi aussi, j’sommes quasi Morvandiau.
Le Rouleur, qui épluchait son oignon, tressaillit et s’arrêta.
—Monsieur parle la lingue! dit-il en reprenant, sans y penser, la prononciation du pays.
—Oui, bin, fiston, répliqua l’avoué en riant.
Et, afin d’appuyer son dire, il se mit à chanter sur un air de bourrée, avec les portées de voix et les cadences prolongées des bergères du Morvan:
Le Rouleur avait relevé la tête; son front plissé s’épanouit, une lumière sembla passer au fond de ses yeux sombres, et ses lèvres se détendirent. A la fin de l’air, il se leva, comme emporté par les souvenirs qui se réveillaient en lui, et poussa le ioup national qui termine toutes les bourrées.
—Vous ne vous saviez pas en pays de connaissance, lui dis-je, enchanté du hasard qui venait de rompre la glace entre nous.
—Le diable m’estringole si je l’aurais cru! s’écria-t-il. Et où donc Monsieur avait-il son accoutumance dans le Morvan?
—J’ai habité deux années entre Mont-Renillon et Gacogne, reprit l’avoué, dans une de ces fentes de montagnes que vous appelez des serres, tout près l’Huis-André.
—Ah! yé! c’est juste où je suis né, interrompit le Rouleur.
—Et nous allions passer l’un près de l’autre sans parler des brandes de là-bas, ajouta mon compagnon.
—J’en aurais eu grand rancœur, dit Claude.
—Alors à table! m’écriai-je; voici l’hôte qui nous prévient que le dîner est servi, et l’on cause toujours mieux entre la fourchette et le verre.
Le chaudronnier hésita d’abord: soit embarras, soit défiance, il voulut s’excuser; mais nous refusâmes de l’écouter.
—Ah! sang! vous viendrez, s’écria l’avoué; je veux repater et bagouter, comme on dit à l’Huis-André. Marchons, mon vieux, et s’il vous faut de la musique, je vous redirai la romance du seigneur de Saint-Pierre de Moutier à la jolie gardeuse de moutons qui faisait, comme vous, la paquoine:
Cette bergerie, chantée comme la précédente, avec l’accent des pâtours du Berri, acheva de mettre en joyeuse humeur le chaudronnier, qui nous suivit enfin en riant et prit place à table entre nous deux. Une fois arrivé là, ce ne fut plus le même homme. Les premiers soupçons dissipés, Claude passa, comme tous ceux qui se sont d’abord tenus sur la réserve, de l’extrême contrainte à l’extrême expansion. Les souvenirs du Morvan et le vin de l’aubergiste aidèrent surtout à cette métamorphose. Ce fut le Sésame, ouvre-toi! devant lequel tombèrent tous les verrous qui avaient auparavant fermé les portes de cet esprit. Là où j’avais seulement espéré un conteur, je trouvai un type aussi intéressant que singulier. Les aveux, d’abord entrecoupés de réticences, se complétèrent insensiblement. A chaque couplet de l’avoué, la bonne humeur du Rouleur semblait se transformer en une confiance attendrie. Enfin nous sûmes toute son histoire.
Claude était un pauvre champi, ou enfant trouvé dans les champs. Adopté par un paysan de la montagne, il avait passé ses premières années dans les brandes à garder les brebiailles. Là, accroupi avec les autres petits pâtours, devant un feu de ronces, il avait entendu parler sans cesse de la poule aux œufs d’or qui se cachait dans les traînes avec ses douze poussins et des épargnes enfermées par les fées sous les grandes pierres druidiques. Dès qu’il avait pu comprendre, ces opulentes visions avaient hanté sa pauvreté. Pieds nus et vêtu d’une biaude en lambeaux, il errait dans les friches, insensible à la pluie, au vent, à la froidure; il frappait de sa houlette ferrée les touffes de bruyères, il retournait les pierres moussues, il regardait au jour failli vers les ravines qu’habitaient les fades, espérant toujours qu’un hasard bienfaisant lui apporterait la richesse.
Enveloppé dans ce songe d’or, il atteignit le moment où les fils de son maître, devenus assez grands pour garder le troupeau, le forcèrent à chercher fortune ailleurs. Un chaudronnier nomade s’était offert à le recueillir, et Claude avait parcouru avec lui les campagnes, apprenant son métier tellement quellement, et retrouvant partout cette même histoire de trésors cachés, rêve éternel de la misère qui ne veut point désespérer. Ainsi entretenues, ses impressions d’enfance s’étaient fortifiées, agrandies. Lorsque la mort de son second maître le laissa encore une fois seul, il continua sa vie vagabonde et s’enfonça de plus en plus dans les recherches qui l’avaient préoccupé tout enfant.
Les explications dans lesquelles Claude entra à la suite de ce récit jetaient un singulier jour sur l’espèce de mission qu’il s’était donnée à lui-même. Le Rouleur n’était point le vulgaire quêteur de trésors que j’avais cru d’abord, mais une sorte d’alchimiste populaire qui, à l’exemple des poursuivants du grand œuvre, avaient soumis la recherche des richesses cachées à un art cabalistique. Je fus singulièrement étonné de la force de cerveau qu’il avait fallu à cet homme ignorant pour systématiser les traditions et en faire un corps de science. Ce travail lui avait coûté vingt ans d’enquête, de réflexions et d’essais. Il y avait mis cette patience passionnée des vrais fidèles, dont le courage, loin de se briser aux obstacles, s’y fortifie et s’y aiguise. Voici rapidement l’idée de sa théorie, née de la comparaison des différentes croyances populaires.
Il y avait trois espèces de trésors: ceux qui appartenaient au vilain (c’était le nom que Claude donnait au démon), ceux qui appartenaient à un trépassé, et ceux que gardaient les génies, les fées ou les morts ajournés, c’est-à-dire destinés à une résurrection terrestre. Les premiers comprenaient toutes les richesses enfouies sous la terre et restées cent années sans voir l’œil du ciel; les seconds, celles qu’on avait cachées en égorgeant un être vivant et qui étaient gardées par le fantôme de la victime; les troisièmes enfin, celles que des esprits ou des hommes puissants avaient autrefois entassées dans de mystérieuses retraites. La recherche et la conquête de chacun de ces trésors étaient soumises à différentes conditions. Pour ceux que possédait Satan, il fallait un pacte. On se rendait pour cela dans un carrefour hanté, où l’on évoquait Robert au moyen de certaines conjurations. S’il venait à paraître, il fallait lui adresser aussitôt la parole, sous peine d’être emporté par lui. Les conventions du pacte se réglaient ensuite, et on les signait de son sang.
Quant aux dépôts précieux que gardaient des fantômes, ils étaient en petit nombre et difficiles à enlever. Tout être vivant qui y touchait devait mourir inévitablement dans l’année. Il fallait, pour s’en emparer, plusieurs précautions et certaines formules destinées à relever l’ombre de sa faction forcée et à lui ouvrir la région des âmes.
Restaient les trésors appartenant aux génies, aux fées et aux morts ajournés. Ceux-ci s’ouvraient plus aisément; il suffisait souvent, pour y puiser, d’un hasard, d’une heureuse rencontre, ou d’un caprice des possesseurs. La science des chercheurs de trésors indiquait au reste plusieurs moyens de trouver et d’acquérir les dépôts précieux. Le premier était la magie et l’étude des incantations; malheureusement, cette branche de l’art était depuis longtemps négligée: Claude nous avoua qu’il y avait peu de chose à en attendre. On pouvait encore vaincre les charmes qui nous dérobaient l’argent caché en faisant consentir un prêtre à dire une messe à rebours; mais tous se refusaient à ce sacrilége. Le plus sûr était donc de mettre à profit ce que l’on appelait, dans certaines provinces, la trève de la nuit de Noël. Une tradition répandue dans la chrétienté avait fait du moment où naquit le Sauveur une sorte de suspension à toutes les lois du monde connu et du monde invisible. Il y avait une halte universelle dans la méchanceté, dans l’impuissance et dans les châtiments. Le cœur de l’univers n’était plus oppressé de son immense angoisse; la création entière poussait un soupir de bonheur. Cette trève de Dieu durait pendant tout l’évangile de la messe de minuit. C’était alors que les menhirs (pierres-fées) allaient boire à la mer et laissaient à découvert leurs trésors, que les vouivres et les dragons déposaient l’escarboucle qui les couronne pour se baigner aux fontaines, que les bons et les mauvais esprits oubliaient l’exercice de leur puissance, que les animaux eux-mêmes, sortant du silence infligé par Dieu depuis la trahison du serpent, recouvraient la parole. Les cavernes les plus secrètes montraient leurs entrées, la mer laissait voir au fond de ses abîmes, les montagnes ouvraient leurs flancs, et la terre, tressaillant d’allégresse, offrait aux hommes tout ce qu’elle renferme, comme un festin de réjouissance. Le chercheur de trésors devait profiter de ce moment pour puiser aux mille sources des richesses cachées; mais il lui fallait, pour cela, outre la connaissance des opulentes cachettes, beaucoup d’audace, de promptitude et d’adresse, car, au premier son de la clochette qui se faisait entendre après l’évangile, la trève expirait; c’était le canon de la messe de minuit qui annonçait la reprise de la grande bataille du monde. Les esprits malfaisants retrouvaient toute leur colère, et malheur à qui se laissait surprendre par eux, car il devenait leur proie jusqu’au jugement.
Depuis vingt années, Claude cherchait à profiter de cette trève de Dieu sans avoir pu trouver encore l’occasion favorable; mais cet insuccès n’avait point ébranlé sa foi. A chaque Noël perdue, il ajournait ses espérances jusqu’à la Noël suivante, et attendait patiemment en comptant les jours. Certain d’arriver à une de ces fabuleuses opulences que la pauvreté seule sait rêver, il supportait ses privations avec une sorte de dédain inattentif; sa misère ne lui semblait qu’une attente. C’était la nuit passée dans la cabane du charbonnier par le roi qui va prendre possession d’un trône.
Je voyais pour la première fois un de ces hommes qui marchent enveloppés dans leur idée comme dans un nuage: monomanes dignes de pitié ou d’admiration, suivant le but auquel ils tendent, mais toujours faits pour saisir l’âme, parce qu’ils la glorifient. Qu’est-ce, en effet, que leur folie, sinon une victoire de la volonté sur les instincts? S’abandonner au courant des jours en profitant de ce que chaque vague vous apporte, c’est jouer, simplement, sur l’océan humain, le rôle d’une épave; mais choisir sa direction sur cette mer et cingler vers un seul but, c’est imiter le vaisseau qui obéit à une intelligence et surmonte, par elle, tous les efforts des flots.
Le chaudronnier nous raconta plusieurs de ses tentatives, dont quelques-unes, suivant lui, avaient failli réussir. Il nous parla de ses projets, de ses espérances. En nous les détaillant, son œil sombre avait des scintillements, ses lèvres souriaient d’une joie anticipée, un frémissement parcourait ses doigts, comme s’ils eussent déjà senti le contact de l’or.
—Faut savoir attendre l’occasion, ajouta-t-il en ayant l’air de penser haut; tout à l’heure encore, j’ai eu un signe...
—Quand vous ayez couru vers la ruelle?
Il fit un mouvement.
—Vous étiez-là, s’écria-t-il. Alors vous savez s’il a pris par la petite sente avant de disparaître?
—Qui cela?
—Vous n’avez donc rien vu?
—Rien que votre empressement à poursuivre un objet invisible.
Il se mordit les lèvres et quitta brusquement la table. J’allais lui demander l’explication de ses paroles; l’entrée de l’aubergiste nous interrompit. L’heure que nous avions indiquée pour notre départ était arrivée, et notre hôte venait demander s’il fallait brider les chevaux. Cette apparition acheva de rompre le charme qui nous avait gagné la confiance de Claude, car il en est des cœurs fermés comme des trésors dont il venait de nous raconter l’histoire; pour y lire, il faut le hasard de l’heure et de la rencontre; ouverts un instant, ils se referment bientôt tout à coup et sans retour. Le chaudronnier parut se réveiller: il se leva en nous jetant un regard inquiet comme un homme qui s’aperçoit qu’il a rêvé tout haut. Nous essayâmes de le retenir, mais il nous déclara qu’il s’était déjà trop attardé, et voulait arriver avant la nuit à un hameau qu’il nous désigna. L’avoué, qui devinait mon désir de prolonger l’entretien, prétexta quelques ruines à visiter de ce côté, et, décida que nous prendrions la traverse avec le chaudronnier. Celui-ci ne put faire aucune objection, mais il fut aisé de voir que notre compagnie l’embarrassait. Il revint à sa réserve défiante et reprit le ton bref de notre première entrevue.
La route que nous suivions n’était tracée que par de profondes ornières, indiquant la direction des villages qu’elle desservait. Elle traversait tantôt des terres cultivées, tantôt des friches, bordées çà et là par de vieux ormes ou quelques touffes de houx. De temps en temps, nous apercevions, dans les champs, des femmes occupées aux semailles; derrière elles volaient des nuées d’oiseaux cherchant la pâture et que chassait la herse des laboureurs. Ceux-ci s’arrêtaient pour nous voir passer; quelques-uns nous jetaient un souhait de bienvenue, puis nous les voyions reprendre leurs travaux. On n’entendait ni bêlements de troupeaux, ni chants de pâtres, ni bourdonnements d’abeilles, rien enfin de cette rumeur de vie qui, dans les jours d’été, fait bruire la campagne. Cependant ce silence ne ressemblait nullement à la mort; c’était la beauté du calme et du repos après celle du mouvement et du bruit. Nous cédâmes insensiblement, mon compagnon et moi, à l’influence de cette grave sérénité, nos questions au Rouleur devinrent plus rares, et nous avions laissé tomber la conversation, lorsque nous arrivâmes près d’une ferme que l’avoué reconnut pour celle du gros François. Un groupe de paysans armés de bêches et de pioches était arrêté à l’extrémité du petit terrain qui faisait face à l’habitation. Parmi eux s’en trouvait un qui semblait écouter des demandes et des indications. Il tenait à la main une baguette de coudrier à deux branches qu’il présentait aux différentes aires du vent, comme s’il eût voulu reconnaître une direction.
—C’est le taupier, m’écriai-je en reconnaissant maître Jean.
—Non, pas pour l’heure, répliqua ironiquement Claude; il vient de changer de métier. Ne voyez-vous pas qu’il tient une baguette d’Aaron.
—Il va chercher une source?
—A moins que nous ne lui fassions peur! dit le chaudronnier.
Je lui imposai vivement silence de la main. Maître Jean ne nous avait point aperçus, et nous nous trouvions derrière une haie de buis où il était facile de se cacher. Je me baissai de manière à tout voir sans être vu; mes compagnons en firent autant.
Le sourcier prit la baguette par les deux branches de la fourche, et, la tenant devant lui, il s’avança lentement de notre côté. Les paysans suivaient, attentifs à tous ses mouvements. Après avoir fait quelques pas, Jean s’arrêta.—La baguette a-t-elle parlé? demandèrent-ils.—Non, dit le sourcier en continuant sa route, c’est la branche droite qui a tourné dans ma main; les branches n’annoncent que le métal: la droite est pour le fer, la gauche pour l’or. Et comme les paysans surpris regardaient autour d’eux sans rien voir et semblaient douter, il entrouvrit, avec le pied, une touffe d’herbe, et y montra un fer de cheval. Tous se regardèrent émerveillés.
—Maître Jean ne néglige rien, me fit observer l’avoué, il a d’avance préparé, la mise en scène et les accessoires.
Cependant le sourcier s’était remis en marche, il arriva à quelques pas du lieu où nous nous trouvions cachés, sembla hésiter, puis s’arrêta. Les paysans l’entourèrent avec une attention anxieuse; la baguette de coudrier sembla osciller, se tordit lentement et finit par se tourner vers un tapis de plantes grasses qui veloutaient les alentours d’un buisson d’osier.
—Creusez ici, les gas, s’écria Jean en frappant le sol du pied, il y a de l’eau sous mon talon.
Les bêches et les pioches se mirent aussitôt à l’œuvre, et nous entendîmes bientôt les travailleurs pousser un cri de joie; l’eau commençait à sourdre dans la tranchée. Nous pensâmes qu’il n’y avait plus d’inconvénient à nous montrer, et nous rejoignîmes le sourcier, auquel j’adressai mes félicitations. En apprenant que nous avions tout vu, il parut d’abord embarrassé; mais il se remit aussitôt, et nous répondit sur le ton demi-plaisant dont j’avais été déjà frappé lors de notre première rencontre. Quant à Claude, il avait tout observé sans rien dire, et continuait à garder un silence railleur.
—Voilà un talisman dont vous ne nous aviez point parlé, lui dis-je à demi-voix en montrant la baguette que le sourcier tenait encore.
—Il est aisé de cacher un vieux fer dans une touffe d’herbe et de trouver de l’eau où poussent les osiers, répondit le chaudronnier.
—Ainsi vous ne croyez pas à la verge de coudrier! repris-je en souriant.
Il haussa les épaules.
—Quoiqu’on soit un pauvre rouleur, on a pourtant une raison! reprit-il avec dédain.
Cependant Jean-Marie avait aperçu Claude, qu’il salua par son nom. Il me sembla même que son ton avait un accent de déférence presque respectueuse, et je me demandai si, pour compléter ces exemples de contradictions, l’exploitateur ironique de tant de superstitions partageait, par hasard, celle de la foule à l’endroit des trésors.
Nous continuâmes à suivre la traverse avec nos deux compagnons. Maître Jean avait réclamé les services du chaudronnier ambulant pour quelques réparations indispensables, et il le conduisait à sa closerie, peu éloignée de la motte Ygé, dont nous commençâmes à revoir les sommets écrêtés.
Le vent venait de se lever brusquement du côté de l’ouest, chassant devant lui de gros nuages plombés qui s’entassaient au-dessus de nos têtes. Nous étions menacés d’un de ces orages de pluie qui remplacent, dans nos provinces occidentales, les orages neigeux de l’Ecosse. Je connaissais par expérience ces espèces de trombes, nommées dans le pays accats d’eau, et j’avertis mon compagnon, qui, depuis un instant, regardait aussi l’horizon avec inquiétude. Il était douteux que nous pussions éviter tout l’orage; mais, en faisant diligence, nous avions l’espoir de sortir bientôt de la région pluvieuse, qui n’embrasse souvent qu’un espace assez rétréci, et d’en être quittes pour un grain. Nous nous hâtâmes, en conséquence, de repasser la bride sur le cou de nos montures et de nous remettre en selle; par malheur, au moment de partir, le cheval de l’avoué refusa de prendre le galop, et nous nous aperçûmes qu’il boitait du pied droit. Examen fait par maître Jean, il se trouva qu’il était déferré et assez blessé pour ne pouvoir marcher qu’au pas.
Pendant que, désappointés par ce contre-temps, nous délibérions sur ce qu’il fallait faire, quelques gouttes de pluie, emportées par la rafale, nous fouettèrent le visage.
—Il n’y a plus à songer à se mettre en route, dit le taupier; faut que ces messieurs viennent à la closerie.
—Est-ce bien loin? demandai-je.
—Là, tout contre, au bout de la chênaie.
—Nous ne pouvons choisir, dit-il; allons provisoirement à la closerie.
—Alors, sauve qui peut! s’écria Jean, voici l’accat!
A ces mots, il rentra la tête dans ses épaules, arrondit le dos, cacha ses mains sous ses aisselles et se mit à courir vers la chênaie. Au même instant, toutes les cataractes du ciel semblèrent s’ouvrir. Les gouttes de pluie étaient si larges et si pressées, qu’elles paraissaient se continuer l’une l’autre et formaient un véritable voile liquide dont nous étions enveloppés. L’eau qui tombait sur nous à flots rejaillissait en cascades le long de nos montures. La surprise et le bruit de cette inondation nous avaient étourdis; nous ne commençâmes à nous reconnaître qu’en atteignant le bois de chênes. Là, grâce au feuillage touffu, la pluie, qui frappait obliquement, n’avait pénétré que dans la lisière tournée à l’ouest. Au bout de quelques pas, nous nous trouvâmes presque complétement à l’abri. Maître Jean s’arrêta en se secouant.
—Eh bien! en voilà une arrosée! s’écria-t-il avec un éclat de rire; faut que tous les moulins du bon Dieu aient ouvert leurs écluses du même coup!
—Je suis percé jusqu’aux os! dit mon compagnon, à qui ce déluge subit avait donné le frisson.
—La closerie est au bout de la futaie, fit observer le taupier, et une flambée de fagots nous aura bientôt séchés.
L’avoué demanda s’il ne serait pas plus sage de regagner Mamers par la route de traverse.
—Ah! bien oui, dit maître Jean, faudrait qu’il y eût encore une route! mettez-moi un peu la tête à la fenêtre pour voir!
Il nous indiquait une percée par laquelle on apercevait la campagne. Tout y était noyé. L’eau coulait à travers les sillons comme dans des canaux, et dégorgeait de toutes parts dans les douves débordées. Les chemins avaient été transformés en lits de torrents. L’inondation emportait les chaumes flétris, les bois épars, les arbustes déracinés, et roulait ses vagues jaunâtres avec mille rumeurs, tandis que la chênaie, ébranlée par le vent, gémissait sourdement dans ses profondeurs. Le retour à Mamers était évidemment impossible; il fallait accepter l’hospitalité du taupier.
Nous apercevions déjà sa closerie, placée à mi-côte. La maison, comme l’eût dit Virgile, pendait au flanc du coteau. Elle était précédée d’une petite aire à battre; derrière, s’étendait un jardin de forme irrégulière qu’enfermait une haie de cityse et de sureau. Le tout nous apparaissait au bout de l’avenue de chênes que nous suivions, encadré dans les derniers rameaux, comme la vignette de quelque églogue illustrée par le burin anglais.
La briéveté de l’accat avait été proportionnée à sa violence. Il semblait déjà toucher à sa fin, et quelques lueurs du soleil couchant rayaient l’horizon. Un de ces jets lumineux tomba, tout à coup, sur la closerie, qui, encore baignée des eaux de l’orage, scintillait sous ce rayon inattendu. Je ralentis le pas, malgré moi, pour contempler le charmant aspect qu’offrait la maisonnette rustique à moitié sortie du déluge; mais mon regard, en se promenant du toit rongé de mousse à la vieille touffe d’aubépine qui ombrageait la porte, s’arrêta sur un objet qu’il ne put d’abord bien définir. C’était une forme humaine, immobile et accroupie sur le seuil. Je reconnus enfin une femme dont les cheveux pendaient en désordre, et qui, assise sur la terre, effleurait de ses pieds nus les petites flaques d’eau formées par l’égout des toits. Dès que je pus apercevoir ses traits, je reconnus une de ces pauvres idiotes qui n’ont presque rien conservé de l’espèce humaine. Jean-Marie avait remarqué la direction de mon regard et me dit sans aucune apparence d’embarras.
—C’est la sœur Marthe qui m’attend.
—Vous osez donc la laisser seule à la garde de la maison? demanda mon compagnon.
—Et la maison ne sera jamais mieux gardée, ajouta le taupier; il n’y a pas comme ces innocentes pour être fidèles au logis. Quand je suis parti, qu’il vente ou qu’il neige, Marthe ne quitte jamais le seuil, et celui qui voudrait le passer sans moi serait étranglé comme une mauvie. Regardez plutôt, voilà qu’elle nous a entendus.
L’idiote venait, en effet, de redresser la tête. Elle sembla aspirer le vent de notre côté, et fit entendre une sorte de glapissement. Son front déprimé, ses yeux obliques, son menton en fuite, sa peau boursoufflée et d’un jaune plombé lui donnaient quelque chose de la bête fauve. En nous apercevant, elle se releva d’un bond, comme si elle eût été mue par un ressort, poussa un cri menaçant et avança vers nous les deux poings fermés; mais à la voix du taupier, elle s’apaisa subitement, et courut à sa rencontre en exprimant sa joie par des cris discordants et des gestes désordonnés. Elle tourna plusieurs fois autour de lui avec des gambades, approcha la tête de sa poitrine et de son épaule, comme un chien qui caresse, courut en avant, puis revint, les bras levés en signe d’allégresse. Pendant tous ces mouvements sa figure restait impassible et sauvage. La sensation semblait comme enfouie dans le chaos de ces traits confus; on eût dit le visage d’une statue mutilée dont l’expression avait disparu sous le marteau.
Jean-Marie lui adressa quelques mots affectueux, l’écarta doucement du seuil où elle s’était replacée, et nous fit entrer. Il nous invita à nous approcher du foyer, en se hâtant d’y jeter une bourrée de traînes, dans lesquelles le feu courut aussitôt avec des pétillements. A la vue de la flamme, Marthe poussa un grognement de joie, et alla s’accroupir au coin le plus reculé de l’âtre. Incrustée, pour ainsi dire, dans le mur noirci et à demi voilée par le nuage de fumée qui commençait à dérouler ses spirales bleuâtres, cette figure ébauchée avait une apparence presque fantastique. L’avoué s’étonna que maître Jean eût pu s’accoutumer à une pareille compagnie.
—C’est tout ce qui me reste de parents, répondit le taupier. Assoltée comme vous la voyez, elle me rappelle encore ceux que j’ai perdus, et le proverbe dit qu’une veuve trouve toujours assez beau son dernier enfant. Puis, quand on rentre tout seul, sur le soir, et qu’on ne trouve chez soi aucune créature vivante, les quatre murs de la maison vous pèsent comme si vous les portiez. Marthe, du moins, fait que je ne crois pas le monde fini; elle me reconnaît, elle me parle à sa manière. Même de penser qu’elle est mauvaise avec tous les autres, ça me fait lui vouloir plus de bien. Ça n’a pas de raison, mais chacun a ainsi, dans le cœur, sa fantaisie.
On eût pu croire que l’idiote comprenait ce qui se disait, car elle s’approcha en rampant sur la pierre du foyer et vint s’asseoir près de son frère, la tête appuyée à ses pieds, comme un animal domestique. Je regardais avec un mélange d’intérêt et de dégoût cet être difforme chez qui, à défaut des clartés de la raison, brillaient encore quelques fugitives lueurs de sentiment. Mon attention fut détournée par le chaudronnier, qui, en attendant qu’on lui remît les ustensiles à réparer, avait voulu établir son atelier portatif dans l’aire. Il rentra pour nous annoncer que le vent avait cessé, mais qu’un épais brouillard couvrait l’horizon. Aux torrents d’eau qui nous avaient submergés quelques instants auparavant, venait de succéder une pluie fine et tiède, qui tombait silencieusement.
—Alors, dit le taupier, nous aurons la brouillasse jusqu’à demain matin; faudra le coup de balai du vent de six heures pour tout nettoyer là-haut.
—Eh bien! mais en attendant, s’écria l’avoué, qu’allons-nous devenir, nous autres?
—Vous resterez sous mon pauvre toit, si ça ne vous fait pas affront, répliqua le taupier.
—Il n’y a jamais d’affront à être au sec, maître Jean; seulement, je crains que nous ne soyons pour vous une grande gêne.
—J’ai à côté un lit de pèlerin, comme on dit: c’est un peu champêtre pour de grosses gens; mais, faute de froment, les allouettes font leur nid dans le seigle.
En parlant ainsi, il nous ouvrit une porte conduisant dans une petite pièce voisine, dont les murs lézardés disparaissaient sous un rideau de plantes potagères conservées pour graines, et dont les touffes desséchées flottaient çà et là, suspendues à des os de mouton fichés dans la muraille en guise de clous. Une huche à blé, deux barriques défoncées, un banc et un lit complétaient l’ameublement. Comme il n’y avait point à choisir, nous remerciâmes le taupier en déclarant que nous acceptions son hospitalité, et nous sortîmes pour visiter nos chevaux dans le petit hangar qui leur servait d’écurie. Jean-Marie les avait débridés et leur avait déjà apporté une partie de l’herbe coupée pour sa vache. Nous y joignîmes quelques poignées d’orge et deux bottes de paille pour litière; des fagots dressés à l’une des ouvertures de la grange, du côté du vent, les mirent à l’abri.
Pendant que nous achevions ces préparatifs de campement, la nuit était venue. L’épais brouillard qui avait tout envahi ne laissait briller aucune étoile, la campagne apparaissait comme un abîme obscur, au milieu duquel des taches plus sombres indiquaient les bois. On n’entendait que le bruit monotone et presque imperceptible de la bruine sur les feuillages. Tout cet ensemble voilé et silencieux avait un caractère de tristesse pour ainsi dire harmonieuse. L’air était plein des âcres parfums qui s’exhalent de la terre humectée et des végétations meurtries par l’orage. Nous restâmes quelque temps appuyés à l’un des piliers de l’appentis, les regards plongés dans ces ténèbres, au fond desquelles on sentait encore la création. Jean-Marie vint enfin nous prévenir que le souper était servi. Le chaudronnier, qui avait terminé son travail, devait nous tenir compagnie, et nous nous mîmes tous à table dans les meilleures dispositions.
La vie réglée de notre vieille société nous condamne à courir presque constamment, comme les wagons sur la voie ferrée, et le moindre caprice est un déraillement qui a son danger. Aussi, lorsque le hasard vient nous enlever, un instant, aux ornières de l’habitude, trouvons-nous à cet imprévu toute la saveur de le nouveauté. Tandis que pour le trappeur américain la descente d’une cataracte paraît une simple circonstance de voyage, et la rencontre des Indiens scalpeurs un incident vulgaire, pour nous, voyageurs civilisés, une averse qui nous surprend sans manteau est une aventure, la nuit passée au foyer d’une closerie un roman complet. C’est qu’à vrai dire ce peuple de paysans qui entourent nos villes nous est presqu’aussi inconnu que l’Indien peau-rouge au touriste qui se rend en poste de New-York à Boston. Nous l’avons bien aperçu en passant courbé sur sa faucille ou sur ses sillons; peut-être même nous sommes-nous arrêtés pour esquisser son toit de chaume doré par le soleil couchant; mais quel citadin pénètre dans sa vie intérieure, apprend sa langue, comprend sa philosophie, écoute ses traditions? Nos campagnes ressemblent aux manuscrits d’Herculanum qu’on n’a point encore déroulés. A peine en connaît-on de courts fragments copiés, en passant, par quelques curieux; le poème entier reste à traduire.
Je m’étais placé à table près du chercheur de trésors, espérant obtenir de lui de nouvelles confidences; mais il était rentré dans son laconisme comme dans une forteresse inexpugnable. Il fallut se rabattre sur le sourcier, qui avait heureusement gardé sa gaieté communicative, et qui continuait de répondre à toutes mes questions. A la vérité, ces réponses n’étaient pas toujours directes: Jean-Marie était né trop près de la Normandie pour ne pas connaître l’art des phrases qui, comme le Janus antique, ont deux visages contraires; par cela même cependant que la conversation était avec lui une sorte de colin-maillard où l’on cherchait toujours à tâtons la vérité, il en résultait plus d’excitation et de mouvement.
Pendant le repas, Marthe vint s’asseoir, par terre, à côté de lui, une main posée sur ses genoux et la tête appuyée à cette main comme un enfant qui dort. Elle l’avertissait de temps en temps par un petit cri plaintif, et Jean lui tendait sa part du souper. En l’observant, il me sembla qu’elle ne mangeait point avec la brutale avidité ordinaire aux idiots, et que sa joie venait moins de la nourriture que de la main qui la lui offrait. Par instants, elle relevait la tête vers son frère, et, à travers l’hébétement de son grand œil bleu, passait je ne sais quelle lueur de tendresse; on surprenait encore, sous ces traits et dans ces mouvements, où le jeu des muscles avait remplacé l’intelligence, un vestige confus des grâces de la femme; le vase détruit et souillé avait conservé quelque imperceptible senteur du parfum évaporé.
Jean-Marie nous apprit que l’idiotisme de Marthe ne remontait point à sa naissance. D’esprit lent et faible jusqu’à l’âge de douze ans, elle regagnait par le cœur ce qui lui manquait en intelligence. On n’avait jamais pu l’appliquer à aucun travail, ni lui confier aucune responsabilité; mais, pour Jean-Marie et pour sa mère, qui vivait encore, elle eût gravi les rochers, percé les haies, traversé les rivières. Son attachement ressemblait à celui du chien: il était silencieux, spontané et, pour ainsi dire, involontaire. L’incendie de la maison qu’elle habitait avec sa famille ébranla son faible cerveau; son intelligence baissa de jour en jour, comme l’eau fuyant du vase qu’un choc a fêlé. Les années se succédèrent, et, au lieu de monter, comme les autres enfants de son âge, du crépuscule au plein soleil, elle descendit toujours et s’enfonça de plus en plus dans les ténèbres. Enfin, elle en était arrivée où nous la voyions. Cependant le taupier ne paraissait point avoir renoncé à la guérison. Son ignorance soutenait son espoir. Il nous apprit que Marthe avait parfois des retours, sinon de raison, du moins de souvenir: habituellement muette, elle retrouvait alors le nom de son frère, et l’appelait avec le même accent qu’autrefois; mais des circonstances extrêmes pouvaient seules provoquer ces éclairs de mémoire.
Claude, qui avait paru prendre peu d’intérêt à ces explications, continuait à manger sans rien dire. Deux ou trois fois, son œil s’était porté sur l’idiote, et je n’y avais pas même surpris cet intérêt ordinaire du paysan pour ceux que l’on désigne dans nos campagnes sous le nom de saints innocents. Absorbé dans sa distraction méditative, il semblait suivre d’un regard persistant quelque image invisible à tous les yeux. Le souper fini, il se leva le premier et alla sur le seuil examiner le temps. Nous nous étions approchés du foyer, où mon compagnon avait allumé un cigare dont la fumée nous enveloppait déjà de son âcre parfum, lorsque le rouleur revint à nous et se mit à réunir les différentes pièces de son atelier portatif. Je lui demandai s’il allait partir.
—Tout à l’heure, répliqua-t-il en apprêtant les bretelles de sa hotte.
—Malgré la pluie! reprit l’avoué.
Il haussa les épaules en lui indiquant du regard ses mains desséchées auxquelles les injures de l’air avaient donné la teinte du bronze de Florence, et qui semblaient en avoir l’imperméabilité.
—Ce cuir-là ne craint rien, dit-il brièvement.
—Et où allez-vous? demandai-je.
Il nomma un village éloigné de deux lieues. Jean-Marie fit observer qu’il trouverait les routes noyées, il répondit qu’il prendrait par les champs. Le taupier secoua la tête.
—C’est un chemin plus commode pour les lièvres que pour un homme chargé, dit-il; si le fils de votre mère avait un peu de sens, il me demanderait deux bottes de paille pour passer ici la nuit.
—Le fils de ma mère a son idée, répliqua sèchement Claude, qui achevait ses préparatifs.
Le taupier parut ni surpris, ni blessé de cette brusque réponse; il regarda son hôte avec l’espèce de déférence qu’il m’avait paru lui montrer dès l’abord.
—Vous êtes votre maître, rouleur, reprit-il tranquillement; mais on ne se sépare point comme ça avant d’avoir bu le coup de soleil.
A ces mots, il ouvrit une armoire d’où il tira une bouteille d’eau-de-vie presque pleine, et il en versa dans chaque verre. Nous trinquâmes, en adressant à Claude un souhait d’heureux voyage. Mon compagnon répéta pour lui la prière populaire de saint Bon-Sens, demandant à Dieu de le préserver «des hommes de la cour, des femmes de la ville et des loups des champs.»
—Monsieur veut rire, dit Jean-Marie à l’avoué; mais que je devienne Normand, si je n’ai pas cru hier voir un loup tout près de la closerie. Je suis rentré prendre mon fusil, j’ai suivi la bête tout le long de la grande haie, et j’allais lui envoyer mes chevrotines, quand elle a aboyé.
—D’une espèce que je n’ai jamais vue dans le pays.
Une sorte d’interjection étouffée me fit retourner la tête, le rouleur était immobile à quelques pas, un bras passé dans la bretelle de sa hotte et l’autre en avant.
—Un chien!..... fauve!.... répéta-t-il avec une sorte d’hésitation.
—A oreilles droites, ajouta le taupier.
—Le museau effilé?
—La queue balayant la terre.
—Et vous dites que vous l’avez rencontré hier?
—Puisque je l’ai suivi.
—Alors vous savez ce qu’il est devenu?
—Je l’ai vu se terrer dans la grande butte.
Claude baissa la tête sans répondre; mais son bras se dégagea lentement de la bricole, et il alla s’asseoir au foyer d’un air pensif.
—Vous ne partez donc plus? lui demandai-je.
—Tout à l’heure, répondit-il en s’asseyant sur l’âtre et étendant machinalement ses mains vers la flamme mourante.
Jean-Marie fit alors observer que la bruine serait peut-être balayée par le vent de minuit, et le rouleur ne parut pas éloigné de retarder son départ jusqu’à cette heure. Notre hôte voulut remplir une seconde fois les verres; mais nous nous hâtâmes de poser la main sur les nôtres, et, afin d’échapper à de nouvelles instances, nous nous décidâmes à nous retirer.
L’humidité de nos vêtements, imparfaitement séchés par la flamme du foyer, commençait d’ailleurs à nous faire éprouver un malaise qui se traduisait par un invincible besoin de sommeil. Heureusement notre lit, qui n’était composé que d’une paillasse et d’une couette de balle, était assez large pour deux. Nous résolûmes de nous y étendre tout habillés, après avoir fraternellement partagé les couvertures vertes qui l’enveloppaient. Au moment de refermer la porte de communication que nous avions laissée ouverte pour profiter de la lumière, je jetai un regard vers le foyer. Jean-Marie et Claude étaient assis en face l’un de l’autre; le premier, bien nourri, bien vêtu et le visage fleuri, vidait son verre à petits coups en fredonnant la ronde des noces; le second, maigre, déguenillé, le front plissé, avait tout bu d’un trait, et regardait à ses pieds d’un air sombre. Je fis remarquer ce contraste à mon compagnon.
—Ne vous en étonnez pas, me dit-il; vous avez là le chasseur de sottises et le chasseur de chimères. Celui-là moissonne dans le champ fécond de la crédulité humaine, celui-ci est à la recherche de cette terre promise où l’on n’arrive jamais. Celui qui chante et qui savoure est le soldat du mensonge, toujours vainqueur et joyeux; celui qui se tait est le pèlerin de l’idéal, toujours haletant et trompé.
Bien que chacun de nous se fût roulé dans sa couverture, le froid nous empêcha pendant quelque temps de dormir. J’entendis enfin la respiration de mon compagnon prendre ces intonations sonores et régulières qui annoncent le sommeil, et moi-même je ne tardai pas à l’imiter. Mais une espèce de fièvre avait insensiblement succédé au froid. Les lassitudes douloureuses que j’éprouvais dans tout le corps se traduisirent, comme d’habitude, en un rêve destiné à les justifier. Mon imagination mêla le souvenir de la réalité aux plus folles inventions. Il me sembla que je m’étais égaré dans un pays inconnu, que j’étais recueilli dans une maison dont les hôtes méditaient quelque projet sinistre. J’entendais verrouiller ma porte en dehors; un pan de mur s’ouvrait et laissait passer des ombres qui s’avançaient silencieusement vers moi; je voulais appeler, une main s’appuyait sur mes lèvres; je voulais m’élancer du lit, des bras m’y retenaient enchaîné. Je m’épuisais en efforts désespérés, jusqu’à ce qu’un redoublement d’énergie me fit enfin pousser un cri qui me réveilla. Je me redressai sur mon séant: j’étais seul; mon compagnon continuait à dormir paisiblement, ce n’était donc qu’un rêve! Je poussai un soupir de soulagement. Tout à coup un bruit de pas se fit entendre à la porte. Je prêtai l’oreille..... Quelqu’un était là. J’entendis distinctement la voix du sourcier qui disait:
Celle du rouleur répondit plus bas:
—N’importe.
Puis la clé fut tournée, le pêne glissa dans la serrure, et les pas s’éloignèrent.
Je me laissai couler à terre, et je me dirigeai à tâtons vers la porte. Ma main rencontra le loquet, qu’elle leva; mais, je ne m’étais pas trompé, nous étions enfermés. Un jet de lumière, filtrant à travers les planches mal jointes, me fit trouver une fissure à laquelle j’appliquai l’œil, et je pus voir tout ce qui se passait dans la pièce voisine.
Les deux paysans s’étaient rassis à la même place, le visage éclairé par la flamme. Jean-Marie avait à ses pieds une bourrée déliée dont il brisait les branches en menus brins; la bouteille d’eau-de-vie presque vide était à ses côtés, et il me sembla que son teint s’était allumé de couleurs plus vives. Quant au rouleur, penché en avant, il lui parlait à demi-voix et d’un ton d’expansion persuasive. Je ne saisis d’abord que des mots entrecoupés, mais je pouvais juger de l’importance de la confidence par le redoublement d’attention du sourcier; enfin, les voix s’élevèrent insensiblement, quelques lambeaux de phrases arrivèrent jusqu’à moi!..... Il s’agissait du chien mystérieux suivi par Jean-Marie, et que le rouleur lui-même avait aperçu deux fois. Je crus comprendre que ce dernier l’avait reconnu pour le chien de terre préposé par les fantômes à la garde des trésors. Le sourcier laissa échapper une exclamation de surprise, mais qui n’exprimait aucun doute.
—Par mon baptême! alors notre fortune est faite, s’écria-t-il.
—Pour ça, faut pas que les hommes de loi s’en doutent, dit Claude en jetant un regard vers la porte de communication, et voilà pourquoi j’ai mis les bourgeois sous clé. A cette heure, le gibier est à nous, et il n’y a point de part pour le roi.
—Partons, Rouleur, dit Jean-Marie, qui s’était levé.
—Minute! reprit Claude, il faut d’abord s’entendre. Tu es sûr de reconnaître l’endroit où le chien s’est terré?
—C’est à la petite Pierrière; mais le trésor sera caché?
—Je sais la conjuration qui le rendra visible; il ne faudra plus que quelques coups de pioche....
—J’ai notre affaire, dit le sourcier en saisissant un hoyau derrière un tas de bourrées; en route, vieux, mais surtout pas de tours de Normand!
—Ne crains rien, répliqua Claude.
—Si on trouve le magot, on ne se quittera pas?
—Non.
—On n’y regardera qu’au retour?
—Ce sera toi qui le tireras du trou et qui l’apporteras.
—Convenu, dit Jean-Marie, qui jeta le hoyau sur son épaule et fit un pas pour sortir; mais, se ravisant tout à coup:
—Un moment! s’écria-t-il, j’avais oublié, moi.... Le premier qui touche au trésor des trépassés doit mourir dans l’année.
—Ah! tu sais ça? dit Claude en tressaillant.
—Et tu espérais m’y prendre, mauvais brigand! reprit le taupier avec emportement.
—Faut que quelqu’un se dévoue, objecta le rouleur d’un accent convaincu.
—Que le diable me brûle si c’est moi! s’écria Jean-Marie; ah! tu voulais me faire manger de la mort pour avoir ensuite part à toi seul? Hors d’ici, vagabond, j’aime encore mieux ma peau que ton trésor.
—A ta fantaisie, dit le rouleur, qui savait sans doute que le plus mauvais moyen de ramener un homme en colère était de lui donner des raisons.
Et il rechargea sa hotte avec une sorte d’indifférence, prit son bâton et se dirigea vers la porte.
Jean-Marie qui l’avait laissé faire en grommelant, le regarda sortir; il parut hésiter un instant, puis finit par le suivre.
J’avais cessé de les voir, mais le bruit de leurs voix m’avertit bientôt que tous deux s’étaient arrêtés au-delà du seuil. Je fis inutilement un nouvel effort pour ouvrir la porte de communication. Ma curiosité était excitée outre mesure. Je ne pouvais douter que le taupier et Claude n’eussent repris la question du trésor, et, à tout prix, j’aurais voulu entendre le débat; mais je prêtais en vain l’oreille: aucune parole ne parvenait jusqu’à moi. Je pouvais seulement reconnaître à la voix chaque interlocuteur, et préjuger par l’intonation ce qu’ils disaient.
Cette espèce d’interprétation, dans laquelle l’imagination avait la plus grande part, finit par m’absorber complétement. L’accent du taupier avait été d’abord presque menaçant, celui de Claude bref et absolu; mais insensiblement le premier s’était adouci, et le second avait perdu sa cassante sécheresse. Maintenant le rouleur parlait longuement, du ton d’un homme qui veut persuader. Il avait sans doute trouvé quelque expédient qu’il s’efforçait de faire accepter. Le sourcier répondait de loin en loin, comme pour opposer des objections; mais celles-ci devenaient à chaque instant plus rares et plus courtes. Claude gagnait certainement du terrain. J’écoutais sa voix, qui prenait des intonations toujours plus persuasives, et je supposais le plaidoyer que je ne pouvais entendre. Il entretenait son interlocuteur de la découverte du trésor, et évoquait, pour le séduire, un de ces rêves que chacun de nous tient caché dans les derniers replis de sa pensée. Il lui montrait, peut-être, la closerie transformée en ferme à deux charrues, l’enclos d’entrée devenu une aire bordée de grande meules de froment, la haie du verger reculée de plusieurs vols de chapons. Il lui faisait entendre le meuglement des vaches revenant le long des sentes vertes, les grelots des attelages qui ramenaient du marché les charrettes vides, et le sifflement cadencé des garçons de labour dispersés dans les guérets. Mais quelle était la condition imposée à cette espérance? Il fallait qu’elle fût bien périlleuse ou bien dure, car le sourcier résistait toujours. Parfois cependant le débat cessait, comme s’il eût consenti; j’entendais le rouleur se rapprocher du seuil. Alors Jean-Marie l’arrêtait tout à coup par un nouveau refus, et la discussion reprenait. Enfin, l’obstination de Claude l’emporta; son interlocuteur parut céder, et tous deux rentrèrent.
—Ainsi c’est dit? murmura le rouleur.
—Oui, répliqua Jean-Marie d’une voix troublée.
—Alors, plus de retard, ou nous manquons l’affaire.
Le sourcier traversa la pièce, alla droit à un renfoncement où j’avais remarqué une paillasse, et appela Marthe.
—Elle n’entendra pas, elle dort, fit observer le rouleur.
Jean-Marie se pencha pour secouer l’idiote, dont le grognement me prouva bientôt qu’elle était réveillée.
—Debout, Marthe! viens avec nous, dit précipitamment le sourcier, nous avons besoin de toi.
Je compris enfin le sujet du débat mystérieux qui s’était prolonge si longtemps. Pour obtenir la possession du trésor, il fallait que quelqu’un se dévouât, ainsi que l’avait déclaré le rouleur, et il avait décidé Jean-Marie à sacrifier sa sœur! Cette longue habitude de tendresse dont le témoignage nous avait touchés un instant auparavant, n’avait pu tenir contre le rayonnement d’une chimérique richesse.
Je demeurai saisi, comme si le danger qu’allait courir l’idiote eût eu quelque chose de réel. Quoi qu’il arrivât désormais, le frère avait, en effet, échangé la vie de la sœur contre l’espérance d’un peu d’or. J’aurais pu tout arrêter en faisant connaître que j’étais là; je ne sais quelle fièvre de curiosité me retint. Je voulus voir jusqu’au bout cette amère épreuve des affections humaines. Je tenais d’ailleurs à jouir du désappointement qui devait punir les deux meurtriers d’intention.
Ils avaient réussi à faire lever Marthe et à l’emmener à moitié endormie. Dès qu’ils eurent disparu, je courus réveiller mon compagnon, à qui je racontai rapidement ce qui s’était passé.
—Vite, suivons-les, dit-il en se jetant à bas du lit.
Je lui fis observer que la porte était fermée.
—Voyons la fenêtre, s’écria-t-il.
Nous la cherchâmes dans l’obscurité; elle était garnie d’un fort treillis. Il fallut revenir à la porte et réunir nos efforts contre la serrure; mais ce fut peine inutile. L’avoué se mit à faire le tour de la pièce en suivant le mur, dans l’espoir de découvrir quelque issue. Tout à coup je l’entendis s’écrier:
—Nous sommes sauvés!
—Vous avez trouvé une seconde fenêtre? lui dis-je.
—Mieux que cela; j’ai un levier.
Il vint me rejoindre, plaça la barre de fer sous le battant, et, en deux ou trois secousses, l’enleva de ses gonds. Je l’aidai à le ranger de côté, et nous gagnâmes la porte extérieure. Toutes ces opérations avaient demandé du temps; lorsque nous arrivâmes dans la petite cour d’entrée, nous ne vîmes plus personne, et nous cherchâmes en vain à reconnaître la direction prise par l’idiote et ses deux conducteurs. Ils avaient bien parlé des petites pierrières, mais mon compagnon n’en connaissait pas mieux que moi la position. Nous nous consultions depuis quelques instants sur ce qu’il fallait faire, lorsqu’un sourd retentissement ébranla tout à coup la colline et fut suivi de deux cris de détresse.
—Qu’est-ce que cela? demandai-je en tressaillant.
—Il m’a semblé reconnaître la voix du rouleur et celle de Jean-Marie, dit l’avoué.
Nous courûmes dans la direction que les cris nous indiquaient, mais nous fûmes bientôt arrêtés par une haie. Il fallut revenir sur nos pas et faire un long détour. Enfin nous aperçûmes un chemin creux dans lequel nous nous engageâmes rapidement. A peine avions-nous fait quelques centaines de pas, qu’une forme étrange apparut dans la nuit, au détour de la route, et nous reconnûmes le sourcier portant l’idiote dans ses bras. Nous lui demandâmes ce qu’il y avait.
—La pierrière!.... bégaya-t-il haletant; nous avons voulu... élargir l’entrée.... tout a croulé sur Marthe..... Place! place!
Il continuait à courir vers la closerie aussi vite que son fardeau le lui permettait. Nous le suivîmes sans pouvoir obtenir d’autre explication. En arrivant à la maison, il déposa l’idiote près de l’âtre; et se hâta d’allumer une chandelle de résine; alors nous pûmes apprécier la gravité de l’accident. Arrachée de dessous les décombres qui l’avaient ensevelie, Marthe était inondée de boue et de sang. Une plaie hideuse lui partageait le front. Ses vêtements en lambeaux laissaient voir les épaules marbrées de contusions, et un de ses bras pendait brisé. Jean-Marie, penché sur elle, la regardait pétrifié d’horreur. La chandelle qui tremblait dans sa main laissait tomber sur le visage de l’idiote des gouttes de résine fondue. L’avoué courut chercher de l’eau, et nous nous mîmes à laver la plaie avec nos mouchoirs. L’idiote poussa un soupir.
—Elle vit encore? s’écria mon compagnon; relevez-lui la tête, et tâchez de la faire boire.
Nous exécutâmes sa double prescription. Après les premières gorgées d’eau, Marthe parut se ranimer. Je tenais un mouchoir mouillé sur la blessure, afin d’empêcher le sang de l’aveugler; elle ouvrit les yeux et nous regarda. Je fus frappé de l’expression d’intelligence qui se réflétait dans sa prunelle contractée. Tous les muscles de la face semblaient se raidir dans un suprême effort. Son œil s’arrêta enfin sur le sourcier. Un inexprimable sentiment de joie épanouit subitement ses traits, et elle appela distinctement: Jean-Marie!
A ce nom, celui-ci se redressa comme si un fer aigu l’eût frappé.
—Avez-vous entendu? s’écria-t-il épouvanté.
—Elle vous a nommé, dit mon compagnon.
—C’est qu’elle va mourir, reprit Jean-Marie avec une conviction si profonde, que nous en fûmes saisis.
Je cherchai à le dissuader en demandant s’il n’était pas possible de se procurer un médecin. Le sourcier ne me répondit pas. Assis sur l’âtre, les deux mains jointes, il regardait Marthe d’un air effaré, en répétant:—Elle va mourir!—impatienté, j’adressai ma demande à l’avoué. Celui-ci secoua la tête.
—Les médecins n’ont plus rien à faire ici, dit-il, n’entendez-vous pas le râle?
La respiration de l’idiote s’était, en effet, changée en un sifflement rauque et pressé. Son agonie se prolongea environ un quart-d’heure, puis la tête retomba en arrière dans une dernière convulsion.
En nous voyant reculer de quelques pas, Jean-Marie comprit que tout était fini; mais il ne quitta ni sa place, ni son attitude. L’idiote était entre nous, étendue à terre, la tête appuyée sur la pierre de la cheminée. Ses cheveux humides de sang roulaient épars jusque dans les cendres du foyer. Quelques lueurs dernières, qui se ranimaient par instants, puis s’éteignaient, faisaient passer tour à tour, sur son visage des jets de lumière et d’ombre. Il y avait dans ce spectacle quelque chose de si cruellement sinistre, que, saisissant par le bras mon compagnon, je l’entraînai hors de la closerie.
Nous tombâmes d’accord que nous ne pouvions être d’aucune utilité au sourcier, et que le mieux était de lui envoyer quelque parent ou quelque ami que nous avertirions à notre passage dans le hameau voisin. Lorsque l’avoué rentra, Jean-Marie lui même le pressa de partir. Peut-être la crainte de nos questions, jointe au sentiment de sa faute, lui faisait-elle désirer notre éloignement. De mon côté, j’éprouvais une sorte d’oppression entre la douleur du frère et le cadavre de la sœur. Nos chevaux furent bientôt sellés, et, après avoir pris rapidement congé, nous nous engageâmes dans une route de traverse que notre hôte nous indiqua.
Le vent de minuit avait nettoyé le ciel, dont la voûte, d’un bleu sombre, apparaissait alors parsemée d’étoiles. La nuit avait cette transparence veloutée particulière aux lueurs crépusculaires. A chaque rafale de la brise, les arbres secouaient leurs têtes humides et faisaient pleuvoir de courtes ondées qui grésillaient sur les buissons. J’avais le cœur serré et la tête en feu: cet air frais me soulagea; je respirai plus à l’aise. Nos chevaux marchaient de front dans l’herbe d’un chemin désert, sans que l’on entendît le bruit de leurs pas. Nous-mêmes, nous gardions le silence, encore émus du spectacle que nous quittions. Arrivés à un carrefour, nous tournâmes à droite, selon la recommandation du taupier, en nous rapprochant de la colline; mais tout à coup les chevaux tendirent le coup puis s’arrêtèrent: un éboulement récent barrait le chemin.
—C’est sans doute la petite pierrière, dit mon compagnon.
Et il toucha sa monture de l’éperon pour la forcer à s’approcher; mais au bruit des fers contre les cailloux, une ombre s’élança de la crevasse qui éventrait le coteau, rencontra un rayon de la clarté stellaire, et nous distinguâmes les traits inflexibles du Rouleur. Il nous aperçut, se jeta dans un sentier qui traversait la friche, et disparut.
—L’avez-vous reconnu, m’écriai-je en me tournant vers mon compagnon.
—C’est Claude.
—Que pouvait-il faire encore là?
—Il cherchait le trésor.
—Dites à cause d’elle; n’était-elle pas une des conditions de la découverte? Vous ne connaissez pas l’implacable ténacité de ces chasseurs de rêves! Pour arriver au but qui fuit devant eux, ils ne regardent point si leurs pieds marchent dans les ruines ou dans le sang. Livrés à une seule idée, comme les possédés du démon, ils ne voient rien autre chose. Eclatants ou obscurs, vous les trouverez toujours les mêmes, le nom seul changera, et, selon qu’ils voudront poursuivre l’unité, l’égalité, la gloire ou la richesse, vous les entendrez appeler Torquemada, Marat, Erostrate ou le rouleur.
Il en est des races comme des individus; le hasard leur donne parfois, dans l’histoire, un rôle subit auquel rien ne semblait les avoir préparés. Des peuples de laboureurs et de bergers deviennent, par rencontre et sans préparation, des armées héroïques, comme le pâtre du village des Grottes devint un Sixte-Quint. De là des contrastes singuliers entre la physionomie historique d’une population et son aspect réel.
On est surtout frappé de cette observation quand on traverse la Vendée. En touchant cette terre qui dévora cinq armées républicaines, le voyageur s’attend à trouver une race ardente et batailleuse, labourant le fusil en bandoulière, à la manière des Américains de l’ouest; à sa grande surprise, il ne voit qu’une population lente, calme, silencieuse, qui semble, comme les attelages de ses bœufs gigantesques, sommeiller dans sa force et n’aspirer qu’au repos.
Cette physionomie est particulièrement celle des anciens Poitevins, aujourd’hui compris dans le département de la Vendée. Si, vers la plaine, des allures plus vives, une gaieté plus avisée, vous rappellent la finesse matoise de l’Anjou, partout ailleurs vous retrouvez le peuple soumis dont la force est surtout dans sa patience. Il fallut des croyances blessées, l’horreur de l’exil militaire créé par la conscription, le respect voué à leurs nobles et à leurs prêtres, pour entraîner les Vendéens dans cette insurrection qui coûta à la France près de trois cent mille combattants. Leur élan fut terrible comme celui de tous les hommes paisibles violemment arrachés au repos. Ils y apportèrent l’énergie des ardeurs qui se ménagent et des volontés habituellement contenues.
Au reste, si le caractère des populations de la Vendée ne diffère que par des nuances, il en est tout autrement du pays lui-même. Rien de plus varié que ses productions, de plus opposé que ses paysages. Sur le rivage occidental, tout est aride et menaçant; mais remontez au nord, et vous ne trouverez plus que métairies cachées dans la verdure, que clochers pointant dans les feuilles, et chemins creux serpentant sous les coudriers. Là, tous les champs sont enclos de haies vives; au-dessus desquelles s’élèvent des arbres émondés dont les troncs hérissés de branches présentent l’aspect d’un taillis suspendu dans les airs. Les frênes, les ormes, les chênes, les érables mêlent leurs rameaux, et forment un immense rideau de verdure que bordent les touffes jaunâtres du châtaignier sauvage et les blanches étoiles du cerisier. Si, de loin en loin, le bocage s’ouvre pour laisser voir quelques clairières, ce ne sont que des landes couvertes d’ajoncs fleuris ou de bruyères roses. Gagnez la plaine au contraire, et, sur-le-champ, tout feuillage disparaît. En juillet, vous croiriez voir la Beauce avec ses océans de blés qui ondulent et ses villages terreux cuits par le soleil; mais en septembre, après les moissons coupées, c’est une Arabie pétrée, et vous n’apercevrez plus, jusqu’à l’horizon, qu’une immense étendue de grois, terrains livides parsemés de calcaires blanchâtres que l’on prendrait pour des ossements. Cependant ne vous découragez pas de cette aridité, continuez vers le sud, et, en atteignant le Marais, vous verrez encore l’aspect changer. La terre n’y est plus qu’un accident, une œuvre artificielle. La contrée tout entière semble une Venise champêtre, où les moissons ont l’air de mûrir sur pilotis, et les troupeaux de brouter des prairies flottantes. Nous parlons ici du Marais mouillé; quant à la partie connue sous le nom de Petit-Poitou, dont le Flamand Humfroy Bradléi commença le desséchement sous Henri IV, c’est une miniature de la Hollande, avec ses mille canaux d’écoulement, ses booths et ses contre-booths[20].
Je ne connaissais le Marais vendéen que par quelques lignes des Mémoires de Mme de Larochejaquelein, lorsque l’occasion de le visiter me fut offerte. Il s’agissait de s’entendre avec le fils d’un des cabaniers du Petit-Poitou[21] pour l’exploitation d’un étang nouvellement desséché où l’on désirait l’établir. J’écrivis à Guillaume Blaisot pour lui donner rendez-vous à Marans, et, comme je désirais voir les bords de l’Autise et de la Sèvre niortaise, je me rendis directement à Maillezais, d’où je comptais descendre, par eau, vers le lieu désigné à Guillaume dans ma lettre.
J’étais debout sur le seuil de l’auberge, attendant que l’on eût pu me procurer un bateau, lorsque je vis arriver un voyageur, qu’à son petit chapeau de toile et à sa jambe de bois, je reconnus sur-le-champ pour Nivôse Bérard, surnommé Fait-Tout.
Bérard était un de ces industriels équivoques, vivant de métiers sans noms et généralement connus dans nos campagnes sous le nom de coureurs de bois. Notre première rencontre avait eu lieu environ huit jours auparavant dans des circonstances qui méritent d’être racontées.
Je venais de visiter le bassin de ce grand lac qui couvrit autrefois une partie des cantons des Essarts, de Châtonnay, de Sainte-Hermine et de la Châtaigneraye. En côtoyant la rive gauche de la Mère, petite rivière qui traverse la forêt de Vouvant, j’avais atteint la large brèche par où les eaux semblent s’être subitement déchargées dans l’Océan, et à laquelle la tradition a conservé le nom de Déluge. Je m’étais arrêté là, saisi par la sauvage grandeur du paysage. De tous côtés se dressaient des rocs bouleversés, les uns revêtus d’une mousse veloutée, les autres presque cachés sous un manteau de ronces et de chèvrefeuilles. Ici l’eau roulait, en bouillonnant, à travers les schistes verdâtres que brillantait la mica; là, retenue comme dans un cercle magique par des touffes d’aulnes, elle formait des réservoirs sombres que l’on eût crus destinés à quelque divinité mystérieuse. Tel était le silence de ce désert qu’on y entendait la chute d’une feuille desséchée et le froissement de la branche sur laquelle se posait l’oiseau. Par instants seulement, une brise s’engageait dans l’étroite coulée, et tout résonnait comme un orgue. Alors commençaient ces dialogues du feuillage et du vent, du glaïeul et des eaux, qui remplissaient la solitude de chœurs ineffables.
Je m’étais longtemps oublié au milieu des rochers et des bois, écoutant les mélodies de la création entrecoupées par de sublimes silences, et je venais de m’arracher avec effort à cette fascination, lorsqu’en tournant un des fourrés appelés gîtes, je me trouvai tout à coup à l’entrée d’un étroit placis. Il était dessiné par des roches tachetées de lichens jaunâtres; quelques ajoncs sans fleurs et des houx rabougris perçaient çà et là le sol de leur verdure métallique. Au milieu de cette espèce de carrefour se tenait un homme revêtu d’un costume de cuir fauve qui l’enveloppait tout entier, et ne permettait de voir que ses yeux. Devant lui, sur un brasier ardent, bouillait une chaudière dont la vapeur eût suffi pour révéler le contenu, alors même que la terre n’eût point été imbibée de lait fraîchement répandu. L’homme tournait sur lui-même, en regardant à ses pieds avec une attention inquiète. Bientôt je le vis se baisser, saisir une couleuvre, attirée par le parfum du lait, et la jeter dans la chaudière. A ses sifflements furieux, les touffes d’herbe commencèrent à s’agiter vers le pied des rochers, et plusieurs reptiles accoururent. L’homme au vêtement fauve leur écrasait la tête sous son talon, et les plongeait dans un petit tonneau fermé par une soupape. Pendant une de ces évolutions, il tourna la tête de mon côté et m’aperçut.
—Au large! me cria-t-il d’une voix qui retentissait étrangement sous son masque de cuir, ne voyez vous pas que ce sont des vipères?
Je reculai d’un bond, et j’allai me placer à trente pas sur une petite éminence complétement dépouillée, d’où je pouvais suivre les mouvements de ce singulier chasseur. Il recommença à plusieurs reprises ce que je l’avais vu faire, et finit par répandre à terre tout le lait de la chaudière. Enfin, sûr de ne pouvoir attirer aucune nouvelle proie, il cloua la soupape du baril, qu’il suspendit à son épaule par une courroie, prit la bassine, et gagna le pied de la butte où je m’étais réfugié. Ce fut là seulement qu’il se dépouilla de son surtout de cuir.
J’aperçus alors un vieillard à physionomie joviale dont le costume complexe laissait le jugement indécis. Tandis que la forme de sa veste brune aurait pu le faire prendre pour un paysan vendéen, sa jambe de bois et ses cheveux blancs coupés en brosse, contrairement à l’usage, lui donnaient l’apparence d’un soldat, et son chapeau de toile goudronnée rejeté en arrière, celle d’un matelot. Voyant la forte position que j’avais prise pour échapper aux vipères, il se mit à rire:
—Il paraît que Monsieur n’aime pas la vermine à venin, dit-il en meilleur français que celui du pays; à vrai dire, il est plus sûr de piper des merles, et ceci n’est pas un gibier pour des bourgeois.
Je lui demandai ce qu’il voulait en faire.
—Monsieur ne sait donc pas? reprit-il; c’est pour les apothicaires; ça entre dans le remède royal.
—La thériaque! on en fabrique encore? demandai-je.
—Bien petitement! dit le chasseur de vipères; autrefois cette vermine-là me valait un champ d’escourgeon, mais maintenant c’est à peine si j’en vends de quoi m’entretenir de pipes.
—Vous faites donc ce métier depuis longtemps?
—Depuis l’an VI de l’une et indivisible, répliqua-t-il, pas bien longtemps après avoir perdu mon moule de guêtre à Aboukir. Ah! c’était le bon temps pour nous autres! (je ne dis pas par rapport aux venins, qui s’étaient mieux vendus sous l’ancien régime, quand le remède royal guérissait toutes les maladies); mais par compensation il y avait eu tant de morts, que les vivants étaient partout à l’aise. Celui qui voulait un gîte pouvait pousser la première porte qu’il voyait fermée; la moitié des maisons avaient leurs maîtres en paradis. Puis, de s’être acharné si longtemps à la chasse des hommes, ça avait fait profiter le gibier; on prenait les perdrix à la main et les lièvres à coups de bâton! moi, qui vous parle, j’en ai apporté jusqu’à douze, d’une fois, au marché. A cette heure, si vous tuez seulement un loriot sans papier, on vous traite de braconnier, et vous payez l’amende. Il n’y a plus ni liberté ni profit pour les malheureux; allez à droite, allez à gauche, vous trouvez que tout est à quelqu’un. Il y a trop de gens autour du blé qui mûrit, voyez-vous; faudrait un peu de canon pour faire de la place et desserrer les coudes.
Tout cela ne fut point dit d’une haleine, mais à plusieurs fois et souvent interrompu par mes questions. Le chasseur de vipères et moi nous nous dirigions vers Fontenay. Naturellement très communicatif et d’ailleurs excité par l’évidente bonne volonté de son auditeur, mon compagnon m’eut bientôt mis au courant de son histoire. J’appris qu’il s’appelait Nivôse Bérard, mais que la variété de ses industries lui avait valu le surnom de Fait-Tout. Il avait été élevé à l’hospice des Sables-d’Olonnes, d’où il était parti à seize ans pour s’embarquer, comme mousse, sur les escadres de la République. Revenu en Vendée après la pacification, il y avait commencé la vie errante qu’il menait depuis. Autant que j’en pus juger à cette première entrevue, Fait-Tout avait contracté, dans sa courte carrière maritime, certaines habitudes d’esprit fort, démenties par les plus étranges crédulités. La philosophie du gaillard d’avant lui avait ôté ses croyances en lui laissant toutes ses superstitions; il doutait de Dieu, mais non des fades, et, s’il riait de l’enfer, il ne parlait point sans inquiétude des fantômes. Elevé sur les limites de deux mondes, celui de la négation et celui de la foi, il n’avait pris de chacun que les préjugés.
En le retrouvant à Maillezais, je me souvins que, lors de notre rencontre, il m’avait parlé d’une prochaine excursion dans le Marais-mouillé. Il m’expliqua comment il y était principalement attiré par la pêche des sangsues qui avait avantageusement remplacé la chasse aux vipères. Lui-même cherchait une place dans quelque bateau pour descendre vers Marans; enchanté du hasard qui me permettait de faire une ample connaissance avec mon bohémien, j’offris de le prendre dans celui qu’on venait de m’amener.
A peine sorti de Maillezais, nous nous trouvâmes en plein Marais-mouillé. Je ne pouvais me lasser de promener les yeux sur cet étrange spectacle. Aussi loin que la vue pouvait s’étendre, l’eau paraissait l’objet principal et comme la base du paysage. Çà et là, on voyait des îlots entourés de verdure, c’étaient les mottées. On distinguait les plus grandes à la culture du chanvre et du lin, les plus petites, à celle des frênes et des saules. Ceux-ci, rangés par plates-bandes, comme les légumes de nos jardins, poussaient, les pieds dans l’eau, avec une vigueur furieuse; chaque tronc semblait porter un taillis. De temps en temps, notre barque longeait quelques-unes de ces-forêts de pavas[22] connues sous le nom de roselières, et dont le produit surpasse celui de la terre la plus féconde. Aux tiges de roseaux se balançaient les nids de tire-arraches dont les cris rauques retentissaient de toutes parts. Des milliers de canards domestiques couvraient le Marais. Notre quille effleurait par instants des prairies flottantes de nénuphars. Sur les plus hauts atterrissements s’élevaient des huttes construites comme les ajoupas des sauvages, avec des fascines de roseaux liées par des harts d’osier. Au milieu même de cette espèce de ruche sans cheminée, on voyait briller la flamme du foyer dont la fumée s’échappait par tous les pores de la hutte et l’enveloppait d’un limbe nuageux. C’est là que vivent les huttiers, descendants de ces Colliberts que les vieux chroniqueurs nous représentent comme des idolâtres, adorateurs de la pluie et exerçant leurs brigandages jusque sur les eaux dormantes. Ils cultivent les fèves de marais sur les mottées, nourrissent quelques vaches et élèvent des nuées de canards qu’ils vont vendre, avec le produit de leur pêche, à Maillezais ou à Marans. Mais leur véritable domaine est le Marais-mouillé lui-même. C’est là qu’ils tendent les milliers d’engins dont les canaux sont embarrassés jusqu’à ne pouvoir dégorger leurs eaux. La pêche la plus abondante est celle des anguilles à ventre jaune, appelées pibeaux. Le huttier, toujours dans les marais, ne revient guère chez lui que pour dormir. Quand les inondations d’automne envahissent la hutte, il y fait entrer son bateau, et celui-ci devient l’habitation de la famille entière.
La réputation des huttiers n’est guère meilleure que celle des Colliberts, leurs ancêtres. Les habitants de la plaine les accusent d’avoir une idée confuse du respect que l’on doit à la propriété; mais, à en juger par Fait-Tout, il me sembla que la plaine, sur ce point, ne le cédait guère au Marais. Chaque fois que mon compagnon à jambe de bois apercevait une corde attachée à quelque tronc de saule, il la tirait à lui, amenait une fascine qu’il secouait dans la barque et d’où tombaient des sangsues. Je lui objectai que cette pêche était un larcin fait à ceux qui avaient posé les fascines; mais il haussa les épaules en riant.
—Bah! bah! dit-il, le renard dont on prend la peau ne fait que vous rendre le prix de vos poules! Ce qu’on vole à un huttier est toujours une restitution. Quand je courais les booths avec une balle de mercier, les femmes m’ont gouriné (volé) assez de lacets ferrés et de cents d’épingles; ils ont beau faire le signe de la croix, voyez-vous, ce sont de vrais catholiques de Mouchamp[23].
Jusqu’alors, nous n’avions fait qu’apercevoir en passant les cases de roseaux. J’étais singulièrement curieux de les voir a l’intérieur, et je fis aborder la barque près d’une hutte dont la construction, à en croire l’apparence, devait remonter au commencement du siècle. Le limon dont on s’était servi pour mastiquer les fascines du toit avait fini par le transformer en une sorte de terrasse verdoyante. La joubarbe y fleurissait, et un jeune saule épanouissait vers la cîme ses pousses argentées. La porte était une brèche de forme irrégulière, haute seulement de quatre pieds. Au milieu de la hutte se dressaient deux poteaux réunis par une traverse: c’était le foyer. La fumée, privée d’issue, avait tout recouvert d’une sorte de vitrification noire et brillante. Au fond de la case, trois vaches ruminaient, couchées sur une litière de pavas, et devant leur ratelier pendait une branche de coux-laurier destinée à les préserver des dartres[24].
Tout l’ameublement se bornait à quelques vases de terre grossiers, à un escabeau et à une claie recouverte d’un matelas de mousse. Sur ce lit était étendue une femme malade de la fièvre de consomption que donne l’atmosphère des marais. Elle était seule et grelottait sous une couverture verte. L’une des vaches avançait par instants la tête, fixait un grand œil vague sur le pâle visage de la malade, et l’enveloppait de la vapeur de sa puissante haleine. Fait-Tout s’approcha du lit:
—Eh bien! maraichaine, dit-il, la maladie nous a donc fauché les jambes? Nous ne pouvons plus aller trequegner[25] sur les mottées, et le pauvre homme doit peiner pour deux?
La malade rouvrit les yeux, nous regarda l’un après l’autre, mais ne répondit pas.
—Le maître du logis est sans doute aux filets? demanda de nouveau mon compagnon.
—Il est allé chercher le prêtre, répliqua la femme très bas.
Je m’approchai à mon tour pour demander s’il ne ramènerait pas un médecin. La maraichaine secoua la tête.
—Il n’y a que faire de guérisseurs, dit-elle d’une voix brève, mon moment est venu!
—Laissez donc! c’est ce qu’on dit à chaque mauvais mal, fit observer Nivôse Bérard; mais l’espérance, ma bonne amie, c’est comme la poulette de rivière, ça ne va au fond que pour revenir sur l’eau.
Elle le regarda d’un air fiévreux.
—J’ai eu un avertissement! murmura-t-elle; j’ai vu la niole (nacelle) blanche!
Ce mot produisit une impression visible sur Fait-Tout, et sur le maraîchain, qui nous accompagnait.
—L’avez-vous bien reconnue? demanda celui-ci.
—Oui, oui, reprit la malade d’un accent entrecoupé, il y a de ça trois jours; mes pieds pouvaient encore marcher. Je revenais de couper des fraîches pour la rougette, quand là-bas, près des trois mottées, j’ai vu sortir du petit contre-brooth, la niole d’angoisse recouverte de son drap mortuaire. Le tousseux jaune[26] était à l’arrière. Quand il a passé, j’ai entendu son râle; un mauvais souffle est arrivé jusqu’à moi, et je suis tombée. L’homme m’a trouvée à terre, il m’a portée à la hutte, d’où je ne sortirai plus que dans ma bière.
Mes deux compagnons se regardaient sans répondre; j’essayai de persuader la maraichaine qu’elle avait été trompée par quelque illusion de mirage ou par les visions de la fièvre; mais, retombée sur son traversin de mousse, elle ne paraissait plus m’entendre. Nous retournâmes à la barque et nous nous remîmes en route.
J’appris alors de Fait-Tout qu’il en était de la niole blanche, dans le Marais, comme du char de la mort dans le reste de la France; quiconque l’avait aperçue devait mourir dans l’année. Je retrouvais sous cette forme particulière une croyance acceptée par tous les peuples et dans tous les temps. Depuis le génie en deuil de Brutus jusqu’au petit spectre rouge des Tuileries, il y avait toujours eu partout des fantômes d’avertissement, témoignage d’une bonté suprême qui ne voulait livrer l’homme à la mort que bien préparé.
A en juger par la manière dont il avait reçu les confidence de la maraichaine, Fait-Tout partageait les croyances communes; mais, lorsque je voulus l’interroger, il se tint sur la réserve. Il savait les gens de la ville peu crédules et craignait évidemment mes railleries; tout ce que je tentai pour lui donner confiance fut inutile; mon philosophe de grands chemins semblait éprouver quelque honte à montrer son scepticisme en défaut. Ne pouvant rien obtenir de ce côté, je voulus au moins le questionner sur le pays et sur les gens que j’allais voir. Au nom du cabanier Jérôme Blaisot, dont le fils m’avait été recommandé, il releva la tête.
—Jérôme Blaisot, répéta-t-il; eh bien! ce n’est pas d’hier que je le connais, celui-là. Quand je suis arrivé dans le pays, il était sixtain[27] devers les marais de Vix.
Je demandai quelle était sa réputation.
—Dame! c’est pas un grand guerrier, répondit Fait-Tout en riant; il a vu dans sa jeunesse les commissaires et les municipaux envoyer tant de monde à la guillotine, qu’à cette heure il tremble devant le garde champêtre. Aussi a-t-on coutume de dire que si le père Jérôme rencontrait le baudet de saint Juire, il le saluerait par respect pour l’autorité[28].
—Et comment tient-il sa cabane?
—En meilleur état que toutes celles du Petit-Poitou, grâce à la Loubette, qui est la plus fière fille du Marais.
—Mais n’a-t-il pas également un fils?
—Faites excuse, le grand Guillaume.
—C’est lui surtout que je veux voir.
Bérard ouvrit la bouche pour me répondre, puis parut se raviser et s’arrêta. Je lui demandai si le grand Guillaume n’était pas un vaillant travailleur.
—Faudrait donc qu’il ne fût pas frère de la Loubette, me répondit-il.
—Et vous pensez que je le trouverai à la cabane?
—Personne ne peut dire qui va ou qui vient.
Il y avait dans le ton de Fait-Tout une subite réserve que je remarquai, mais à laquelle je ne m’arrêtai pas.
L’originalité du paysage que nous traversions me donnait d’ailleurs de continuelles distractions. Perdus parfois dans un dédale de frênes, de saules ou de roseaux, et n’entendant autour de nous que les cris des oiseaux aquatiques, nous pouvions nous croire sur un de ces affluents des grands fleuves américains où n’a jamais flotté que le canot d’écorce du sauvage; d’autres fois une percée, qui se faisait subitement, nous laissait voir des prairies, des cultures et des villages. Nous passions devant des criques pleines de barques, puis tout disparaissait derrière une touffe d’arbres, et nous commencions à côtoyer quelques levées ombreuses que suivaient de longues files de doublons conduits par un muletier dont la voix nous arrivait, par instants, accompagnée du bruit des sonnettes, et répétant un vieux noël. J’écoutais avec un ravissement involontaire cette rustique pastorale où de vrais bergers du Poitou faisaient parler les bergers de la Judée, m’associais à leur crédule joie devant l’enfant qui venait finir les guerres, je suivais pas à pas cette scène villageoise, où rien n’était oublié, ni le don fait par Guillot, ni le pauvre luminaire de saint Joseph éclairant l’intérieur de la crèche, jusqu’à ce dernier couplet, prière naïve que le chanteur répétait tête nue:
La nuit était close lorsque nous arrivâmes à Marans. Je me fis conduire à l’auberge que j’avais désignée à Blaisot, où je devais le trouver; mais, quand je m’informai près de l’hôtelier, j’appris qu’il n’était venu personne. Ma lettre était pourtant partie de Fontenay depuis plusieurs jours, et avait certainement été reçue. Je ne pus cacher mon étonnement.
—C’est bien Jérôme que Monsieur attendait? demanda l’aubergiste.
—Eh non! c’est son fils Guillaume! répliqua vivement Fait-Tout.
—Le grand Guillaume? dit l’hôtelier, qui me regarda d’un air étrange.
—Connaissez-vous donc quelque raison qui ait pu l’empêcher de venir? demandai-je.
—On ne sait pas les affaires des autres, répondit-il avec hésitation; mais c’est demain marché, et il viendra certainement quelqu’un de chez Blaisot.
Ceci me donna de l’espérance. Averti par ma lettre que j’arrivais le soir, Guillaume avait pu remettre notre entrevue au jour où ses propres affaires l’appelaient à Marans. Je fus seulement frappé de l’espèce d’embarras avec lequel on me parlait du jeune cabanier. Après sa réponse, l’aubergiste avait tourné sur ses talons comme pour éviter une nouvelle question, et Fait-Tout, lui-même, s’était éclipsé. Je remis au lendemain l’éclaircissement de ce mystère.
Marans est aujourd’hui le port d’embarquement de tous les produits de la Vendée; aussi fus-je réveillé, dès le matin, par le bruit et le mouvement du marché. La ville se remplissait de huttiers apportant leur pêche et leur chasse, de cabaniers qui venaient vendre leur laine ou leur chanvre. Je voyais passer de lourds chariots attelés de douze bœufs conduisant aux bateaux les blés de la plaine et les bois de frêne connus sous le nom de Cosses de Marans. J’attendais toujours le grand Guillaume; mais le temps s’écoulait sans que personne parût. Je me décidai enfin à prendre des informations dans les cabarets des faubourgs où avaient coutume de s’arrêter les gens du Petit-Poitou; toutes mes recherches furent inutiles. Dans la dernière auberge, je trouvai Fait-Tout entouré de mariniers et dans l’exercice d’une de ses mille industries. Il traçait sur l’avant-bras d’un jeune paysan un de ces tatouages indélébiles gravés avec une pointe d’acier et colorés par la poudre à canon. L’ancien marin m’appela pour me faire admirer son œuvre, alors presque achevée.
Celle-ci appartenait évidemment à l’école chinoise, non pour la finesse du trait, mais par le laisser-aller de la forme et la naïveté de la perspective. On voyait d’abord une sorte de parallélogramme au pointillé, représentant un autel, au-dessus duquel voletait quelque chose qu’on me dit être deux colombes. A droite se dessinait une croix nimbée; à gauche, une fleur de lis; au-dessous, une tête de mort avec les os en sautoir. Nivôse Bérard me fit admirer chacune de ces illustrations.
—Monsieur voit que tout y est, dit-il; le Fier-Gas n’aurait rien de mieux, fût-il vrai roi de France.
—On peut exiger du bon quand on paie un écu blanc! fit observer, avec une certaine emphase, celui que l’on appelait le Fier-Gas.
—Aussi t’ai-je donné le grand jeu, répliqua l’ancien marin, l’autel d’amour, la religion, la fleur royale et la mort! Qu’est-ce que tu veux de plus? Dans tout le pays, vous ne serez que deux à les avoir, toi et Sauvage, le Bien-Nommé.
—Alors je suis déjà seul, reprit le Fier-Gas, vu qu’à cette heure le Bien-Nommé est sous l’eau.
—Qu’est-ce que tu dis là, s’écria Tout-Fait stupéfait.
—On n’a pas eu son corps, dit le paysan, mais on a trouvé sa niole chavirée, et, depuis, Sauvage n’a plus reparu.
—Comment-donc la chose est-elle arrivée?
—Personne ne peut savoir; seulement, il y en a qui disent que le Bien-Nommé aura rencontré la dame de l’étier (étang).
—Celle qui revient sous forme de fantôme?
—Et qui noue sa chevelure aux nioles pour les attirer au fond.
Quelques-uns des assistants secouèrent la tête, comme s’ils doutaient; mais aucun ne combattit la supposition du Fier-Gas. L’un d’eux seulement fit observer que, depuis quelque temps, il y avait un mauvais sort sur les familles du Petit-Poitou. Ces derniers mots semblèrent rappeler à Fait-Tout mon désappointement de la veille; il me demanda si j’avais enfin vu quelqu’un de chez le cabanier. Je lui racontai mes recherches inutiles, et plusieurs des paysans qui se trouvaient là m’affirmèrent qu’aucun des Blaisot n’avait paru à Marans. Il ne me restait plus d’autre ressource que de me rendre moi-même dans cette partie desséchée du Marais qu’on nomme le Petit-Poitou; mais, privé du compagnon sur lequel j’avais compté et ne connaissant point le pays, j’éprouvais un véritable embarras. Fait-Tout me proposa spontanément de louer un char-à-bancs dans lequel il me conduirait au desséchement. J’acceptai sans balancer; il me demanda une heure pour finir, et je retournai dîner à mon auberge, où je lui donnai rendez-vous.
Je m’aperçus, lorsqu’il arriva, que le peintre ordinaire du Fier-Gas avait trop multiplié les toasts à la glorification de son chef-d’œuvre. Il m’amenait ce qu’il avait trouvé de plus confortable. C’était une petite charrette peinte que traversaient deux planches en guise de bancs. J’y montai sans observation, et nous prîmes le chemin de Chaillé.
Jusqu’alors je n’avais vu que le Marais-mouillé, dès que nous eûmes atteint le booth de Vix, le Marais-desséché commença à se dérouler sous nos yeux. Il occupe tout l’espace compris entre l’Autise et le canal de Fontenelle, remontant jusqu’à la Ceinture des Hollandais, un peu au-dessous de la route qui conduit de Fontenay à Luçon. Commencés, comme nous l’avons dit, par le gentilhomme brabançon, Humfroy Bradléi, ces desséchements furent multipliés par de riches seigneurs, par les Bénédictins et par les Templiers. Des digues défendent les terres contre les eaux, qui sont recueillies dans des contre-booths et conduites vers la mer. De loin en loin, des espèces d’étangs soigneusement enclos reçoivent le trop plein des eaux pendant l’hiver, et deviennent, en été, des réserves pour l’irrigation des prairies. Chaque champ est de plus entouré d’une douve profonde ombragée de frênes et communiquant avec les contre booths. C’est de ce vaste système circulatoire que dépendent la fertilité et l’existence même des marais desséchés. Les propriétaires se réunissent annuellement pour nommer un maître des digues, qui veille aux travaux d’art, un syndic chargé de faire exécuter les délibérations, et un caissier archiviste préposé à la comptabilité et à la garde des titres.
Le sol des desséchements est une glaise bleuâtre, appelée bri, que recouvre une couche limoneuse tellement féconde, que l’usage des engrais est inconnu dans tout le Marais. La mer a autrefois recouvert ces terrains, comme le prouvent les quilles de vaisseaux enfouies dans les champs et les montagnes d’huîtres hautes de quarante-cinq pieds, qui se dressent aux environs de Saint-Michel-en-l’Herm.
Nous étions à la fin du mois de septembre; le soleil couchant illuminait le chaume des sillons, qui, déjà entremêlé d’une herbe courte et verte, s’étendait à droite et à gauche, comme un tapis rayé. Les nuages, chassés par une brise d’est, projetaient à chaque instant, de grandes ombres sur ces espaces lumineux, tandis qu’un brouillard transparent, et pour ainsi dire tamisé, estompait l’horizon. Le desséchement entier était partagé en larges compartiments dont l’eau et le feuillage dessinaient les contours. Çà et là, des laboureurs fendaient péniblement le bri des guérets, au moyen d’une lourde charrue sans avant-train. Les friches étaient couvertes d’innombrables troupeaux de chevaux, de bœufs et de moutons. Fait-Tout m’assura que la plupart de ces troupeaux n’avaient jamais eu d’autre toit que le ciel. Quand les hivers étaient rigoureux et que l’herbe disparaissait, on leur apportait du fourrage à la friche. Mon œil cherchait, parmi ces chevaux galopant librement au milieu des roseaux, le coursier de Mazeppa, «farouche comme le daim des forêts et ayant la vitesse de la pensée;» mais leurs formes lourdes et leur sauvagerie pacifique s’opposaient à toute poétique illusion.
Nous étions arrivés à une chaussée, du haut de laquelle mon compagnon me montra la cabane de Blaisot, bâtie au bord d’un grand canal; de l’autre côté s’élevait celle du Fier-Gas. Le chasseur de vipères avait promis de passer à cette dernière pour avertir que le jeune homme serait retenu à Marans jusqu’au lendemain.
—Je vois justement quelqu’un, ajouta-t-il, qui, pendant ce temps-là, vous conduira chez Jérôme.
Il m’indiquait une friche où j’aperçus un vieillard et un enfant gardant un troupeau de moutons.
Le premier était debout, les épaules couvertes d’une peau de mouton et les deux mains appuyées sur un bâton recourbé. Son regard avait l’expression vague que donne l’habitude de la solitude et des grands espaces; sur ses traits se réflétait un calme intérieur qui leur communiquait une sorte d’épanouissement. Devant lui broutait une brebis tellement gigantesque, qu’on eût pu la prendre pour une de ces petites vaches noires perdues dans les landes de la Bretagne.
—C’est une flandrine, me dit Fait-Tout: on ne peut en avoir plus de quatre ou cinq dans une cabane, à cause de la dépense; mais chacune fournit autant de lait que trois chèvres et plus de laine que trois moutons. C’est la brebis du vieux Jacques, vu que le grand berger a toujours, de droit, la première bête du troupeau.
Le vieillard, qui avait entendu la fin de l’explication, sourit.
—Oui, c’est la Bien-Gagnée, dit-il, et elle ressemble au roi de France, elle ne peut jamais mourir, car, si on la perd, la plus belle la remplace.
—Celle-ci est bien la même que j’ai vue à mon dernier tour, fit observer Bérard.
Le vieux berger abaissa sur la brebis un regard d’affectueuse sollicitude.
—Si Dieu le veut, j’espère bien que tu la retrouveras encore à ton prochain voyage, reprit-il; je tiens à la flandrine, vu qu’elle ne ressemble point aux autres brebiailles; celle-ci sait écouter et comprendre.
Depuis que Jacques parlait, la Bien-Gagnée avait, en effet, relevé la tête; et penchait l’oreille comme si elle eût écouté.
—Veille! veille! dit à demi-voix le vieillard.
A l’instant même, la flandrine bondit de côté, s’élança vers des moutons qui broutaient au penchant du canal, au risque de tomber, et les força à rejoindre le gros du troupeau.
—Comment ayez-vous pu la dresser ainsi à vous obéir? demandai-je tout surpris.
Le grand berger remua la tête d’un air pensif.
—Les ouailles ne demandent qu’à être averties, dit-il: il y a en elles quelque chose du bon Dieu; mais nous le leur-ôtons en voulant les conduire à notre caprice. On oublie toujours, voyez-vous, que le troupeau n’a pas été fait pour le berger, et que c’est le berger qui doit se faire au troupeau.
—Ainsi, pour apprivoiser la flandrine, vous avez surtout étudié son instinct?
—Et cet instinct lui fait voir des choses que les chrétiens ne voient pas, reprit Jacques avec une sorte de ferveur; elle a le don, comme tous les animaux qui se rappellent le paradis terrestre. Aussi, n’ayez souci que la flandrine soit gaie quand il doit arriver un malheur à la cabane; elle sent venir le mauvais sort.
—Alors il n’y a rien à craindre pour aujourd’hui, dit Fait-Tout en riant, car la bête a bon appétit, et Monsieur peut aller chez les Blaisot. Seulement comme il faut que je le quitte ici, vous lui donnerez bien le petit berger pour le conduire.
Jacques appela l’enfant, qui prit la place de Bérard et conduisit le char-à-bancs devant la porte de la cabane.
Un paysan, que je jugeai être Jérôme, accourut au bruit; en m’apercevant, il s’arrêta court, tira vivement son chapeau et se mit à appeler Loubette. Je sautai à terre et je voulus entrer en explication; mais il ne m’écoutait pas et continuait à crier toujours plus fort, jusqu’à ce que la jeune fille parût sur le seuil.
Au premier coup-d’œil, je ne fus frappé que de sa laideur. Elle avait la haute taille et la corpulence boursoufflée ordinaire aux habitants du Marais. Ses traits, engorgés par la lymphe, ressemblaient à ceux d’une statue ébauchée dans le tuffeau. Il fallait un long examen pour distinguer, au fond de l’œil à demi-voilé par d’épaisses paupières, une étincelle d’énergie et d’intelligence, comme une étoile pointant dans le brouillard. Ma vue parut la surprendre plutôt que l’effrayer, et elle m’invita à entrer. Alors même que Fait-Tout ne m’eût point averti, j’aurais aisément deviné que la fille était le vrai chef de la famille. Je lui expliquai, en peu de mots, le but de ma visite. Quand je nommai Guillaume, le vieux cabanier laissa échapper une exclamation, mais Loubette lui imposa silence du regard.
—Ainsi c’était de Monsieur la lettre qu’on a apportée avant-hier? dit-elle.
—Vous l’avez reçue? demandai-je.
—Faites excuse, reprit Loubette un peu embarrassée, l’homme de la poste l’a remportée.
—Pourquoi cela?
—Parce que celui dont le nom était sur l’adresse ne se trouvait point au Petit-Poitou.
—Que dites-vous! Guillaume?....
—C’est aussi vrai qu’il n’y a que trois personnes dans la Trinité! interrompit Jérôme.
—Mais vous savez au moins où je pourrai le trouver?
—Nous ne savons rien! reprit le cabanier avec précipitation; ceux qui ont dit le contraire l’ont fait par mauvaiseté. Le grand Guillaume est parti de sa seule volonté; nous n’y sommes pour rien; j’en jurerai par la Vierge et par tous les grands saints!
—Allons, ne reniez pas votre fils parce qu’il n’a pu rester près de nous, interrompit la jeune fille avec une fermeté calme; vous voyez bien que Monsieur ne le demandait que pour son bien.
Je ne pouvais encore comprendre ni la cause du départ de Guillaume, ni l’effroi de son père. Je regardai Loubette, d’un air interrogateur, mais elle prévint de nouvelles questions en m’offrant de me rafraîchir. J’acceptai surtout par curiosité.
Jérôme était allé tirer un pot de cidre qu’il plaça devant moi. La réflexion l’avait un peu enhardi; il revint de lui-même au motif de ma visite. Au nom de maître Le Normand, le notaire qui m’avait recommandé Guillaume, la jeune fille s’approcha et voulut avoir de ses nouvelles. Mes explications achevèrent de dissiper toute défiance; le cabanier mit la nappe, et je vis que l’on s’apprêtait à servir le souper.
J’avais une trop longue expérience des habitudes de nos campagnes pour opposer aucune objection à ces dispositions hospitalières. Je savais qu’en les acceptant, je ne faisais qu’user de mon droit d’étranger, et qu’une sérieuse inquiétude pouvait seule justifier l’espèce d’embarras que j’avais cru remarquer dans l’accueil de mes hôtes. J’espérais d’ailleurs que, s’il fallait définitivement renoncer au fils du cabanier, celui-ci pourrait me désigner quelque autre maraîchain capable de diriger l’exploitation de l’étang desséché.
Pendant ces pourparlers et ces préparatifs, la nuit était venue; mais je m’en étais à peine aperçu: mes yeux, progressivement accoutumés à l’obscurité, continuaient à distinguer les objets dans la pénombre de la cabane. Le feu de pavas, fréquemment ravivé par Loubette, n’y jetait pourtant que des clartés intermittentes qui dansaient le long des solives enfumées et se reflétaient au mur sous mille formes bizarres. Les ténèbres avaient exercé leur influence ordinaire. Nous gardions tous trois le silence, moi sur le banc où j’étais assis, les bras croisés, Jérôme devant la cruche de cidre qu’il vidait à petits coups, Loubette, près du foyer, dont elle contemplait pensivement les lueurs vacillantes. On n’entendait que le grésillement des roseaux et le murmure monotone de l’eau bouillonnant sur l’immense trépied. Par instant, un souffle de vent nocturne, chargé de rumeurs incertaines, arrivait des friches, entrait par mille crevasses invisibles, semblait traverser la cabane et se perdait au loin comme un soupir.
Tout le monde a pu remarquer ces espèces d’influences mélancoliques dont les âmes se trouvent subitement atteintes. Soit action des objets extérieurs, soit dispositions communes et mystérieuses de l’être intérieur, il est des heures où je ne sais quelle contagion de tristesse nous gagne, comme si nous la respirions dans l’air. Quelque chose de semblable agissait sans doute alors sur la Loubette, sur son père et sur moi, car nous demeurions tous trois à la même place, toujours immobiles et silencieux. La flamme continuait à lutter contre l’humidité des roseaux qui se tordaient en gémissant; bientôt elle s’abattit tout à fait, rampa le long des tiges à demi vertes, puis s’évanouit, et l’on eût pu croire le feu éteint sans la frêle spirale de fumée blanchâtre qui continuait à s’élever. Loubette, avertie par la disparition de la lueur qui avait jusqu’alors éclairé l’âtre, repoussa les roseaux vers le centre du brasier, et dit à demi-voix, comme si elle se parlait à elle-même.
—Les pavas pleurent, c’est mauvais signe pour les absents.
—Et ce n’est pas meilleur signe pour les présents, reprit le cabanier, qui me sembla assombri plutôt qu’animé par le cidre; Dieu seul pourrait dire ce qu’il nous garde à tous.
La jeune paysanne soupira.
—Monsieur apportait le bonheur de Guillaume, dit-elle presque bas: une fois établi là-bas dans un défrichement, il aurait oublié ce qu’il n’est pas bon qu’il se rappelle; il aurait pris une femme, et Dieu lui aurait donné des enfants pour ses vieux jours, tandis que maintenant....
Elle s’arrêta; Jérôme frappa la table avec la cruche qu’il tenait à la main.
—Non, non, s’écria-t-il, la chance tournera toujours à sa perte; il n’y a point de bonheur pour celui qui a été bercé sur les genoux d’une morte.
—Je demandai au cabanier ce qu’il voulait dire.
—Ce que j’ai vu? reprit-il d’un accent qui révélait à la fois une certaine exaltation et une réminiscence de terreur; demandez à tous les gens de Vix, ils vous diront l’histoire de la berceuse.
—C’était donc au temps où vous étiez sixtain, repris-je.
—Oui, répliqua Jérôme; je venais de me marier; mais la grande guerre, voyez-vous, ça ne forme pas les jeunes filles à l’économie; à force de misère, on s’habitue à ne prendre souci de rien. Aussi la Sillette (que Dieu apaise son âme!) avait les mains croisées plus souvent qu’à l’ouvrage, et notre fiot Guillaume demandait longtemps avant d’avoir sa suffisance. J’avais beau lui dire que les enfants qu’on laisse crier la nuit éveillent les vieux parents dans le cimetière, elle s’enfonçait sous la couverture pour ne pas entendre. La vieille Calotte, qui couchait à l’étable, s’était offerte pour prendre le petiot; mais Sillette avait refusé par mauvaise gloire. Aussi Guillaume dépérissait que c’était pitié. Une nuit, dans mon somme, il me parut que j’entendais son râle. Je me redressai à moitié endormi. Le bruit continuait; mais c’était le ronflement du rouet. J’avançai la tête pour voir au bout de la cabane, et alors, que Dieu ait pitié de nous! je vis, dans le clair des étoiles, la mère-grand, morte depuis sept années, qui filait en berçant le fiot sur ses genoux.
Le cabanier s’arrêta, épouvanté du souvenir qu’il venait d’évoquer; la Loubette fit un mouvement; je demandai à Jérôme s’il avait bien reconnu la berceuse.
—C’était elle! c’était elle! reprit-il plus bas; ses cheveux blancs pendaient hors de sa coiffe, son tablier avait le coin relevé, comme quand elle se mettait au travail; la vieille femme avait entendu de dessous la terre les cris de son petit-fils.
—Mais l’avez-vous revue? demandai-je.
—Revue! dit le cabanier, j’aurais donc voulu ma perte? Non, non; les enfants de douze ans savent que celui qui regarde deux fois un défunt n’a qu’à commander son drap mortuaire. J’ai entendu seulement le rouet jusqu’à ce que Guillaume soit devenu bien portant et fort.
—Et vous pensez que cela doit lui porter malheur?
—Celui qu’a touché un trépassé garde toujours un mauvais don, car il reste en lui quelque chose de la mort. Les troupeaux qu’il soigne tombent malades, le blé qu’il sème ne gaiffe[29] jamais, et les gens qu’il aime tournent leurs cœurs d’un autre côté. Nous l’avons trop bien vu par Guillaume le Triste-Gas! Qui sait où son mauvais sort l’a conduit à cette heure, et s’il n’y a pas en route pour nous quelque nouvelle de malheur?
En ce moment, un cri d’oiseau perçant, mais isolé, se fit entendre au dehors. Le cabanier et sa fille redressèrent la tête en même temps, le premier tout surpris, la seconde avec une exclamation de saisissement.
—As-tu entendu? s’écria Jérôme; on dirait un tire-arrache?
Un second cri, puis un troisième retentirent dans la nuit.
—C’est bien l’oiseau de rivière, reprit le cabanier; par le Dieu tout-puissant! je ne l’avais jamais entendu chanter si tard.
—Quelque niole en passant l’aura effrayé, dit la Loubette, dont la voix me parut trembler; mais si c’est l’heure où les oiseaux dorment, c’est celle où les chrétiens soupent, et la table est servie.
Elle avait allumé une clarté qu’elle posa sur la nappe en me montrant mon couvert. Je pris place vis-à-vis du cabanier, et il se mit à faire les honneurs de son souper avec plus d’entrain que je ne lui en aurais supposé. Une fois enhardi, Jérôme ne manquait ni de conversation ni de bonne humeur.
C’était le type complet, quoique un peu exagéré, du maraîchain méridional. Mélangé de crédulité, d’égoïsme et de timidité, il avait besoin d’une complète confiance pour être lui-même. Au moindre soupçon, toute liberté d’esprit disparaissait, une circonspection peureuse reprenait le dessus, et l’on retrouvait le Prusias campagnard, toujours tremblant de se brouiller avec la république.
Je me sentis d’autant plus à l’aise pour l’étudier, que dès le commencement du souper la Loubette avait disparu.
Je n’y pris d’abord pas garde, tout occupé que j’étais de mon hôte. A force d’ambages et de précautions oratoires, j’avais réussi à ramener la conversation sur Guillaume. Le cabanier me parlait d’une jeune fille avec qui il avait échangé les anneaux de promesse et qui s’était mariée depuis à un autre, quand il fut subitement interrompu par des pas lourds, accompagnés de cliquetis d’armes. Au même instant, un uniforme galonné s’encadra dans la baie de la porte, et le brigadier de la gendarmerie de Chaillé entra.
| Pages. | |
| Avant-propos. | 5 |
| Premier Récit.—Le Sorcier du Petit-Haule. | 7 |
| Deuxième Récit.—La Fileuse. | 49 |
| Troisième Récit.—Les Bryérons et les Saulniers. | 99 |
| Quatrième Récit.—La Chasse aux Trésors. | 175 |
| Cinquième Récit.—La Niole Blanche. | 255 |
Angers.—Imprimerie de Cosnier et Lachèse.
NOTES:
[1] D’après sa version, le premier homme s’était écrié, en sentant qu’une partie du fruit défendu lui restait à la gorge: A tam (le morceau), et la première femme lui avait répondu: Eve (bois), d’où étaient venus pour tous deux les noms d’Adam et d’Eve.
[2] Ce chant a été publié, mais défiguré, dans un ouvrage de M. Vaugeois: Antiquités de la ville de l’Aigle et de ses environs.
[3] La joubarbe (sempervivum tectorum) est regardée, dans le Midi, comme une plante protectrice. L’arracher de dessus les toits porte malheur.
[4] Moisson d’Arbanie, le moineau friquet, en patois normand.
[5] Logane, case.
[6] Per jou! jurement en usage en Normandie et dans le Bocage. C’est évidemment le per Jovem des Latins.
[7] Grecque, avare.
[8] J’ai été témoin d’un phénomène du même genre aux Quinze-Vingts, où j’ai vu converser avec un aveugle en traçant du doigt, entre ses deux épaules, les mots qu’on voulait lui communiquer.
[9] Puisses-tu la voir belle enfant, puisses-tu la voir belle épousée!
[10] La camada rodona consiste à passer le pied droit par-dessus la tête de sa danseuse; l’espardanyeta, à battre rapidement le talon contre le cou-de-pied.
[11] Cos coumte Ramoun, cela est comte Raymond, c’est-à-dire cela est juste. Ce proverbe s’est établi par suite des souvenirs de droiture et d’équité qu’a laissés dans le Languedoc Raymond V, comte de Toulouse, qui vécut au XIIe siècle.
[12] Barque d’une forme particulière.
[13] On appelle la pélette la première couche de tourbe. Les Bryérons l’enlèvent au hoyau, au commencement de l’été, et la réservent pour leur usage personnel. La couche du dessous fournit la tourbe marchande.
[14] Chariot dans lequel on place les enfants pour leur apprendre à marcher.
[15] On appelle mielles les grèves sablonneuses du département de la Manche.
[16] Saint Sequayre, saint populaire du pays basque. On lui recommande ses ennemis pour qu’il les fasse sécher.
[17] Dégotté, fin, rusé, qui n’est pas got.
[18] Vire, tourne; garelle, bariolé.
[19] Ce couplet a été recueilli par M. le comte Jaubert près de Saint-Pierre de Moutier. Plaisant signifie agréable; aubrelle désigne des peupliers. Paquoine signifie mijaurée; repater et bagouter, faire un repas, bavarder; rancœur, chagrin.
[20] On appelle booths les levées qui défendent les desséchements contre l’inondation, et contre-booths, les canaux qui longent les booths.
[21] Dans les desséchements, les fermiers sont appelés cabaniers. Le Marais du Petit-Poitou est situé près de Chaillé.—Les habitants du Marais-mouillé s’appellent huttiers.
[22] C’est le nom donné dans le pays à la massette ou typha latifolia, qui abonde dans le Marais autant que le roseau ordinaire, arundo phragmita.
[23] Catholiques de Mouchamp, c’est-à-dire protestants, parce que c’est à Mouchamp que l’on trouve le plus grand nombre de calvinistes; cette désignation est injurieuse.
[24] Cette superstition existe dans toute la Vendée: le coux-laurier est l’ilex aquifolium.
[25] Trequegner, c’est le nom que l’on donne à l’action des femmes qui vont trépigner sur la terre grasse des prairies afin de faire sortir les achées qui servent d’appât pour la pêche de leurs maris.
[26] Le tousseux jaune, le fantôme de la fièvre catarrhale bilieuse qui décime la population du Marais.
[27] Le sixtain est un fermier qui cultive au profit du maître et perçoit, pour salaire, le sixième des récoltes.
[28] La procréation des mulets est une des industries importantes de la Vendée; on y entretient, à cet effet, des baudets pour étalons, et celui du haras de Saint-Juire est renommé dans le pays.
[29] On dit que les blés gaiffent quand, après avoir été coupés tout jeunes, ils épaississent et annoncent ainsi une abondante moisson.
End of Project Gutenberg's Les derniers paysans - Tome 1, by Émile Souvestre
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES DERNIERS PAYSANS - TOME 1 ***
***** This file should be named 49312-h.htm or 49312-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/9/3/1/49312/
Produced by Laurent Vogel, Chuck Greif and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.